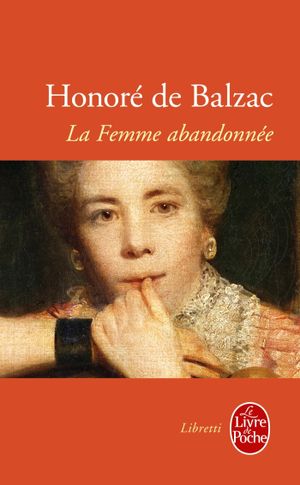Il y a dans la Comédie humaine plusieurs de ces petits récits méconnus, à mi-chemin – j’allais dire à mi-pente – entre les histoires tragiques des alentours de 1600 et les nouvelles d’un Barbey d’Aurevilly. Et, de même qu’il faut bien relever dans les premières des éléments précurseurs des intrigues romantiques, et chez le second quelque chose comme un post-romantisme noir, de même force est d’admettre que la Femme abandonnée justifie que l’on tienne aussi Balzac pour un romantique.
En fait, romantisme et réalisme sont mêlés dès la première phrase : « En 1822, au commencement du printemps, les médecins de Paris envoyèrent en Basse-Normandie un jeune homme qui relevait alors d’une maladie inflammatoire causée par quelque excès d’étude, ou de vie peut-être » (p. 463). Le fringant Gaston de Nueil et Mme de Beauséant finiront par s’aimer, précisément parce qu’il ne devaient pas s’aimer, qu’il ne fallait pas qu’ils s’aimassent. Et Gaston parvient à ses fins intuitivement, presque malgré lui, là où des plus roués que lui eussent échoué. Sa jeunesse l’aide, comme elle aide la plupart des héros romantiques – et comme elle aide la plupart des héros balzaciens.
Entre l’arrivée de Gaston en Basse-Normandie et son idylle avec Mme de Beauséant, on trouvait le tableau d’une province étouffante et étouffée, bien sûr brossé au présent de l’indicatif : « Autour de ces éléments principaux de la gent aristocratique se groupent deux ou trois vieilles filles de qualité qui ont résolu le problème de l’immobilisation de la créature humaine. Elles semblent être scellées dans les maisons où vous les voyez : leurs figures, leurs toilettes font partie de l’immeuble, de la ville, de la province ; elles en sont la tradition, la mémoire, l’esprit » (p. 465).
Et c’est peut-être un trait du romantisme balzacien : en complément des paysages à la Caspar David Friedrich, de la nature et des ruines représentatifs du romantisme première génération, on a des paysages sociaux, et des pré-ruines humaines. Tel est le décor de la passion amoureuse, évidemment fatale, qui constitue le moteur de la Femme abandonnée. Je ne reviens pas en détails sur cette liaison, d’une part pour ne pas déflorer l’intrigue à d’éventuels lecteurs de cette critique qui n’auraient pas lu la nouvelle, mais surtout parce que pour être honnête, elle n’est pas ce qu’il y a de plus réussi dans le roman.
Et si le récit n’est pas raté non plus, c’est parce que l’auteur prend parfois soin de laisser le lecteur faire son travail de lecteur – c’est-à-dire combler les blancs entre les lignes. J’écris bien parfois : il faut avouer que le texte n’est pas toujours exempt de ces redondances par lesquelles Balzac approfondit ses analyses morales et sentimentales.
Prenons un passage comme « Il existe un prestige inconcevable dans toute espèce de célébrité, à quelque titre qu’elle soit due. Il semble que, pour les femmes comme jadis pour les familles, la gloire d’un crime en efface la honte. De même que telle maison s’enorgueillit de ses têtes tranchées, une jolie, une jeune femme devient plus attrayante par la fatale renommée d’un amour heureux ou d’une affreuse trahison. Plus elle est à plaindre, plus elle excite de sympathies » (p. 470).
Ce qui m’y paraît marquant, c’est ceci : quelque variété formelle – analogies, modalisation – que Balzac y introduise, chacune des quatre phrases de ce passage reprend le motif des trois autres. (Le propos me paraît aussi absolument vérifiable, et pas seulement pour 1832 – mais là n’est pas la question.) On ne trouve ce genre de lourdeurs que sous la plume de Balzac narrateur, pas dans la bouche de ses personnages. Et elles me semblent beaucoup plus regrettables que les fameuses descriptions balzaciennes dans lesquelles il n’y a finalement pas un mot de trop.