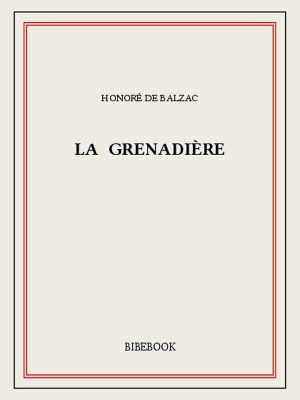La Grenadière a un charme fou, mais exactement le type de charme auquel je suis insensible. Un genre de charme dix-huitième ? Assez peu pour moi, les épanchements balzaciens sur la tendresse maternelle et la piété filiale. (C’est fou : la plupart des mères balzaciennes sont soit des bigotes au cœur de pierre, soit des madones embaumant d’amour. Ça change de l’alternative vierge ou putain, est-ce préférable ?) « Tout dans ces enfants était un éloge pour leur mère » (p. 429), certes c’est très beau, mais certes aussi, les deux chérubins Louis Gaston et Marie Gaston (oui, celui des Mémoires de deux jeunes mariées) ne sont pas un éloge de la nuance.
L’aîné, surtout, manifeste à treize ou quatorze ans un amour filial et fraternel qui ferait pâlir d’envie la Caroline d’Une double famille, et surtout – quoique inexprimée – une acuité sentimentale et psychologique qu’un Rastignac, par exemple, n’aura toujours pas acquise à vingt. Il me semble que les enfants ne pullulent pas dans la Comédie humaine – dans mes souvenirs, Louis Lambert, et qui d’autre ? Et je crois que Balzac n’excelle pas dans les portraits d’enfants : « Le pauvre enfant était encore trop jeune pour comprendre la mort. » (p. 442), à propos d’un gosse de neuf ans, ça corrobore l’image d’un Balzac enfant lui-même particulièrement balourd (1).
Et puis la Grenadière est fleurie. Très fleurie. D’après l’éditrice de la nouvelle en « Pléiade », les fleurs chez Balzac traduisent la présence souterraine de Mme de Berny. (Les fleurs d’Honorine seront artificielles : Mme de Berny sera morte.) Toutes ces fleurs me font surtout penser à un Paul et Virginie de Touraine. Et là, c’est vraiment le genre de romans auxquels je suis insensible.
Mais voilà : Balzac est Balzac, et quand Balzac fait du Balzac, Balzac vous présente en bonne et due forme la maison des personnages principaux, un travelling parfait – les coteaux de la Loire, le jardin, l’intérieur de la maison – en un seul plan, quatre pages qui coulent comme la Loire elle-même. Mais à la fin du travelling « N’offrez pas de prix ! La Grenadière ne sera jamais à vendre ! » (p. 425) : on pourrait en conclure que Balzac, c’est l’agent immobilier qui vous fait visiter la maison qu’il n’a jamais mise – ni ne mettra jamais – en vente, parce que cette maison est la sienne. Je préfère voir en lui le jardinier subtil qui cultive amoureusement ses fleurs et finit par vous dire en sanglotant que même ça s’achète, avec d’autant plus d’amertume que s’il aime l’argent au point d’en faire un pivot de son œuvre, l’argent ne l’aime pas.
Je parlais plus haut de la Loire qui coulait. Il n’y a pas qu’elle qui coule dans la Grenadière. Il y a aussi les larmes, bien sûr, mais surtout le récit lui-même : alors qu’il n’y a pas vraiment d’événements, tout s’enchaîne. Même les tics balzaciens (« La propreté, l’accord régnant entre l’intérieur et l’extérieur du logis en firent tout le charme », p. 425), même cette sorte de panneau À vendre planté dans le jardin, donc, ne rompent pas l’exemplaire fluidité de l’ensemble.
Tout est feutré, au point que la cause de la mort d’Augusta Willemsens n’est pas explicitement dévoilée. On se retrouve loin du Balzac maladivement réaliste que présentent les manuels, et c’est peut-être là que réside le caractère enfantin de la nouvelle : tout y est impression, équivalent littéraire de ce « sens merveilleux, qui n’est encore ni l’égoïsme ni la raison, qui est peut-être le sentiment dans sa première candeur, [et qui] apprend aux enfants s’ils sont ou non l’objet de soins exclusifs, et si l’on s’occupe d’eux avec bonheur » (p. 430).
(1) L’idée que la mort soit incompréhensible à quelque âge que ce soit me paraît tout à fait défendable par ailleurs. Mais alors à quoi bon cette précision, « trop jeune » ?