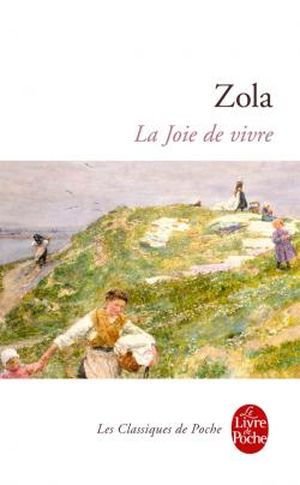Étrange roman que cette "Joie de vivre". La chute est percutante et sublime, bouclant la boucle avec un panache insolent dont Zola a le secret. Son personnage de Lazare, obsédé par la mort, quasi littéralement rongé par elle, s'étonne avec naïveté d'un suicide - acte désespéré qui lui semble ridicule. En quelques mots, on est un peu réconcilié avec le brouillon de quatre-cent pages qu'on vient d'explorer.
Mais alors juste un peu. Malheureusement, la conclusion, organique, suffisamment intelligente pour laisser songeur, ne rattrape pas les nombreuses tares de l'oeuvre. La joie de vivre commence pourtant très bien, et j'étais prêt à le ranger dans mes Zola préférés, sachant que j'ai un faible pour certains de ses romans marginaux, ceux qui n'ont pas eu un grand succès postérieur mais qui l'auraient mérité (surtout le diptyque La conquête de Plassans / La faute de l'abbé Mouret).
Un début prometteur, disais-je donc, qui laissait présager une bonne dose de romanesque après un Au bonheur des dames magnifique dans son genre, mais qui forcément reléguait son intrigue au second plan pour laisser le magasin grossir d'un trait de plume à l'autre. À une prolifération de vendeurs, de clients, de marchands laissés et d'opportunistes succède une petite famille perdue aux confins de la Normandie ; Zola renoue avec le côté confiné de ses premiers romans, sans la démesure - ou alors celle de la mer qui gronde.
Mais se concentrer sur une petite famille ne suffit pas - encore faut-il avoir quelque chose à en dire et, de ce côté-là, Zola semble avoir peiné. Le personnage de Lazare fait office de distributeur à réflexions métaphysique. Pauline fait bien pâle figure à côté d'autres personnages féminins de la saga, accumulant les bourdes et les inepties naïves. Madame Chanteau disparaît trop tôt, cassant une certaine dynamique romanesque qui aurait pu être mieux exploitée. Les autres personnages n'ont pas beaucoup plus d'intérêt : de mon point de vue en tout cas, la maladie du bougon Chanteau, les sautes d'humeur de la bonne ou les allers-retours de Louise n'ont pas grand intérêt.
Et que dire de la mer ? Sans vouloir tomber dans des interprétation à là "Fais mes devoirs à ta place.com", elle semble symboliser la mort qui détruit tout, forte et imbattable, fière et cruelle.
Sauf que Zola ne la mentionne que trop rarement, qu'elle disparaît souvent, et que le potentiel de sa nature destructrice me semble gâché.
Il n'y a donc pas d'étincelles du côté des destins individuels, pas plus qu'au large des cotes. Le long des quatre-cent pages, Zola semble chercher une force qu'il ne trouve pas, ou trop peu.
Dommage.