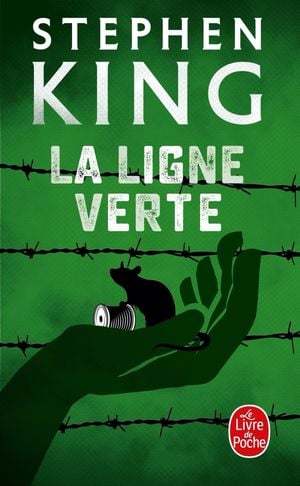La Ligne Verte est un peut-être le roman de Stephen King le plus connu des non-fans, probablement parce-qu’il est paru à l’époque sous forme de feuilleton, aussi surement parce-que son adaptation cinématographique reste à ce jour d’une excellente réputation et l’histoire une des plus belles que l’auteur a écrites. Par cette histoire Stephen King démontre, s’il était nécessaire, qu’il n’est pas cet écrivain de romans simplement fantastiques auxquels ceux qui le connaissent mal (ou qui le méprisent), tentent de le réduire, mais qu’il est aussi et surtout ce formidable raconteur et analyste psychologique capable en quelques mots de bouleverser aux larmes ceux qui le lisent.
Si le début de la carrière de Stephen King est surtout fait de romans fantastiques dans lesquels l’horreur avait une plus grande place, on y sentait déjà cette capacité que lui seul possède de si bien comprendre les rouages des comportements humains. Peu à peu, cette part de fantastique a reculé pour ne devenir la plupart du temps qu’un prétexte à quelque chose de bien plus profond et finalement, peut-être que l’objectif de l’écrivain est aujourd’hui de psychanalyser la race humaine.
Paul Edgecombe est gardien-chef dans le couloir où il voit défiler depuis des années les pires des criminels que comporte la race humaine. Certains restent pendant leur cours passage dans ce bloc les criminels qu’ils ont été, d’autres se révèlent des êtres totalement différents, parfois touchants quand ils retrouvent cette humanité qui semblait les avoir fuit. C’est ainsi que débarque un jour John Caffey, colosse noir impassible aux yeux qui pleurent et qui semble douté d’un incroyable pourvoir de guérison et surtout, qui semble innocent du crime dont on l’a déclaré coupable.
Voilà quel est le prétexte de Stephen King, confronter un homme reconnu coupable de meurtre à ses geôliers qui ont eux-mêmes tué plusieurs dizaines de leurs semblables. Confronter ces hommes à un sentiment d’injustice qui les déchire d’autant plus lorsqu’ils découvrent que ce condamné possède un don qu’ils attribuent immédiatement à leur Dieu. Cette équipe de gardiens, sous la responsabilité de Paul Edgecombe se retrouve écartelée entre le devoir d’homme et le devoir de citoyen. Stephen King analyse finement ce moment où chacun se retrouve confronté tout d’abord à l’incompréhensible face au don de John, puis face à la prise double prise de conscience de l’exécution prochaine d’un innocent et, comme ils le disent, d’un don de Dieu.
Stephen King dénonce, sans vraiment avoir l’air d’y toucher, un univers carcéral aveugle qui accepte de composer avec l’erreur judiciaire, quand bien même elle entraine la mort d’innocents. Il revient magnifiquement sur cet éternel débat sur la différence entre la justice et la vengeance, sur ce besoin d’un coupable qui apaiserait les familles de victimes. Il touche aussi à l’arrivisme et à l’opportunisme de certains qui semblent sévir encore dans un pays qui dit défendre depuis toujours le mérite de chacun face aux relations des autres.
C’est avec une énorme boule au ventre qu’on dévore les dernières pages, les larmes au bord des yeux persuadé de la cruauté définitive de l’auteur qui n’hésite pas à nous secouer de sanglots. Il ne prend certainement aucun plaisir à maltraiter ainsi ses personnages et ses lecteurs, mais il devient presque évident que Stephen King ne se contente pas d’analyser ses personnages, mais que c’est bien et surtout nous qui sommes devenus ses sujets favoris. Il s’adresse à nous, à notre vision de nos nous-mêmes et de nos contemporains, à notre vision de la justice et à notre capacité de donner gratuitement de nous-mêmes dans un monde où tout est à vendre.