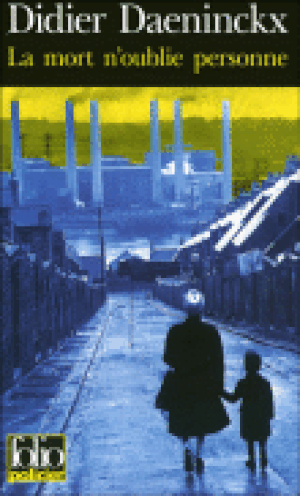C’est du Didier Daeninckx : des personnages d’une richesse psychologique poussée à l’extrême, un regard particulièrement nuancé porté sur l’histoire, des situations ambiguës et surtout une recherche littéraire permanente… Bon, désolé, l’ironie est facile, mais il y a déjà plus d’humour dans la première phrase de cette critique que dans les deux cents pages de La mort n’oublie personne. C’est dire.
Le roman n’est pas mal construit : l’idée de mêler les souvenirs d’enfance du narrateur principal aux souvenirs d’un jeune résistant, et l’instauration d’un va-et-vient entre les années 1980 (l’enquête) et quelques mois de la fin de la Deuxième Guerre mondiale (les mésaventures de Jean Ricouart), permettent, peut-être paradoxalement, de gagner en rythme et d’alléger la sauce d’un récit qui sans cela n’aurait plus été lourd, mais obèse. Mais par ailleurs, comme souvent avec Daeninckx, les idées politiques c’est du sérieux. Or, tout sympathique qu’il soit, l’auteur en devient lassant, à toujours vouloir montrer qu’il est du côté des gentils – lesquels sont irréprochables au moins du point de vue des idées, tout comme les méchants sont ignobles à tous les niveaux. Et le Pas-de-Calais sous l’Occupation n’est pas précisément un terrain propice à la nuance idéologique.
Mais Daeninckx semble taillé pour ça : les idées. Or, même lorsqu’il cherche à faire naître des paradoxes, ils sont pesants : « J’avais connu la Milice, la Gestapo, les S.S., mais c’était la première fois que je me trouvais face à la justice ordinaire et démocratique » (p. 186), déclare le narrateur secondaire lorsqu’il raconte comment cette justice l’a bafoué. Et dès qu’il cherche à étoffer ses personnages, par exemple en leur donnant une intimité, ça patauge – lire à cet égard un récit de dépucelage, au chapitre 3, qui est probablement l’un des passages les plus grotesques que j’aie lus depuis longtemps. Oui, même dans le racolage, Didier Daeninckx est maladroit – ça ne le rend pas antipathique, vraiment.