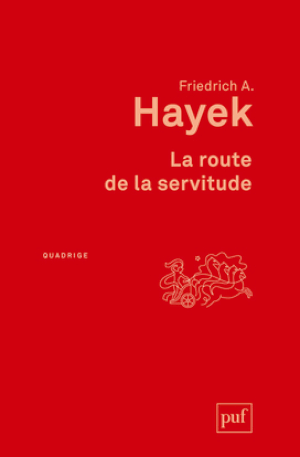La Route de la servitude par Blèh
Dans ce traité de philosophie politique écrit en 1945 alors que la guerre est sur le point de se terminer, le philosophe et économisme Friedrich August Hayek explique qu'il n'y a aucune différence de nature entre les deux régimes totalitaires que sont le nazisme et le communisme : Tous deux rejettent la démocratie libérale, l'individualisme, et la libre-entreprise, et cherchent à planifier et organiser la vie collective d'une société dans un but déterminé. Seul ce but diffère et permet de distinguer les fascistes des communistes.
Alors que la social-démocratie commence à faire son apparition à visage découvert, Hayek dénonce ces "totalitaires parmis nous", qui condamnent lentement l'individualisme et le laissez-faire à une mort lente au profit d'un planisme, démocratique, mais tout aussi erratique que celui imposé par la force et la violence en Allemagne ou un URSS.
Dans le fond, Hayek retourne l'argument collectiviste qui consiste à plaider pour une entité supérieure capable de décider pour l'ensemble de la société dans les domaines les plus complexes qu'elles n'est pas en mesure de comprendre (dilemme du prisonnier). Pour lui en effet, si la situation réclame un immense savoir et fait preuve d'une complexité inégalée, aucun guide suprême ou cartel d'experts éclairés autoproclamés n'est en mesure de la saisir dans son ensemble. Il convient au contraire de s'appuyer sur l'individualisme et l'Etat de Droit, où chaque individu possède une petite partie de savoir et trouve son intérêt à collaborer avec d'autres pour que la situation trouve son équilibre et sa résolution d'elle-même (sinon, regardez http://tinyurl.com/36zogq9 il explique mieux que moi).
A ce titre, Hayek rappelle que l'individualisme libéral n'est pas une défense de l'égoïsme (égoïsme que soutiendra par exemple Ayn Rand plus tard), mais bien une une méthode d'analyse, en faveur d'une philosophie qui reconnaît et "encourage" dans son laissez-faire l'association volontaire, la coopération, et donc l'action collective.
Pour Hayek, toute démocratie qui s'engage dans la voie du planisme est condamnée à grignoter peu à peu les libertés individuelles, et si l'on en croit la citation suivante : "Aussitôt que l'Etat entreprend de diriger toute la vie économique d'après un plan, l'encadrement et l'organisation des différents groupements et individus deviennent le problème politique central. [...] Toute question économique ou sociale sera, en même temps, une question politique. Sa solution dépendra principalement de la personnalité de celui qui exerce le pouvoir coercitif, de l'opinion des hommes influents.", les questions économiques et sociales seront des enjeux politiques laissés aux mains des dirigeants, et donc à la merci de l'arbitraire. Cela vous semble familier ? C'est normal. Les démocraties ont alors selon lui deux options : un planisme qui tend vers un idéal - La route de la servitude, ou un Etat qui garanti l'égalité en droit de ses citoyens et les laisse, dans ce cadre, agir comme bon leur semble.
Quelques bémols cependant. Certains arguments font un peu tâche dans cet humanisme un peu dégoulinant. Quelques illustrations un peu maladroites : "les Allemands sont un peuple obéissant, qui aime l'ordre", etc. peut-on trouver au détour d'une explicitation. L'argumentation et la réflexion ne repose pas sur ce point qui n'est ici que pour donner un exemple, mais il reste que cela fait un peu tâche au vu de la rigueur du reste de l'ouvrage. De même, le chapitre "les totalitaires parmi nous" explique (en 1945, donc) que la vie politique anglaise ressemble beaucoup à l'Allemagne de 1890-1900 et que les nazis vont bientôt (d'ici 30-40 ans) venir frapper aux portes pour manger des enfants. On peut, de nos jours, se permettre d'en douter.
Pour le reste, un ouvrage percutant qui avance les principaux arguments que défendra Hayek pour le restant de sa vie. Un livre, pour qui ne rejette pas en boule l'économiste autrichien, que je recommande simplement à tous. Où tous signifie "tous ceux qui sont capables de se fader un bouquin de philosophie politique - de 150 pages environ".