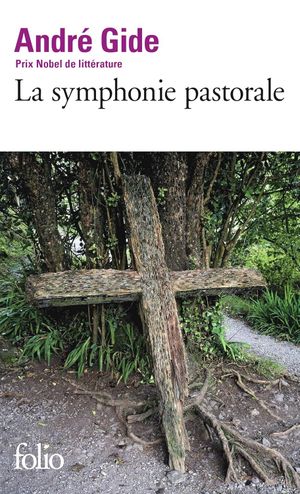André Gide met la foi d’un pasteur à l’épreuve dans ce roman où l’amour et le drame le disputent à la bonté. Le pasteur recueille une jeune fille aveugle et se charge de son éducation sous le regard méfiant de son épouse qui voit l’amour que l’homme porte à l’enfant.
C’est l’occasion pour l’auteur d’exprimer quelques idées sur l’éducation : « Bien des choses se feraient facilement, sans les chimériques objections que parfois les hommes se plaisent à inventer. Dès l’enfance, combien de fois sommes-nous empêchés de faire ceci ou cela que nous voudrions faire, simplement parce que nous entendons répéter autour de nous : il ne pourra pas le faire… » Un constat pratique qui tranche, à l’époque, sur les conventions chrétiennes d’une Europe où les enfants ne sont pas encore reconnus responsables, qui tranche aujourd’hui encore sur les propres pratiques familiales de beaucoup : il semble toujours plus aisé d’interdire que d’accompagner. « Tu veux commencer de construire, me dit-il, avant de t’être assuré d’une terrain solide », l’éducation ne s’improvise pas. C’est la réponse aux besoins précis de chaque enfant, de chaque être. Ainsi il n’y a pas une réponse, mais des milliers, aussi innombrables qu’il y a d’élèves et de maîtres.
Ici l’élève est aveugle, et André Gide utilise l’infirmité pour séparer les êtres. Là où le pasteur et son épouse, leurs enfants, sont gênés de la laideur du monde, il est facile pour l’aveugle de s’en protéger. Plus exactement, il est facile, malgré les difficultés d’appréhender certains concepts, d’en protéger l’aveugle : « Le rôle de chaque instrument dans la symphonie me permit de revenir sur cette question des couleurs. Je fis remarquer à Gertrude les sonorités différentes des cuivres, des instruments à cordes et des bois, et que chacun d’eux à sa manière est susceptible d’offrir, avec plus ou moins d’intensité, toute l’échelle des sons, des plus graves aux plus aigus. Je l’invitais à se représenter de même, dans la nature, les colorations rouges et orangées analogues à la sonorité des cors et des trombones, les jaunes et les verts à celles des violons, des violoncelles et des basses ; les violets et les bleus rappelés ici par les flûtes, les clarinettes et les hautbois. Une sorte de ravissement intérieur vint dès lors remplacer ses doutes :
- Que cela doit être beau ! répétait-elle. »
Un monde fantasmé pour la garder innocente : « Je ne lui répondis pas aussitôt, car je réfléchissais que ces harmonies ineffables peignaient, non point le monde tel qu’il était, mais bien tel qu’il aurait pu être, qu’il pourrait être sans le mal et sans le péché. Et jamais encore je n’avais osé parler à Gertrude du mal, du péché, de la mort. »
Entre amour et bonté, bientôt le pasteur s’y perd. Troublé par les sentiments de son fils autant que par les siens, la foi n’assied plus tant ses certitudes et le doute s’empare de lui. C’est d’abord la bonne conscience qui guide l’homme, le serviteur de Dieu et de ses contemporains, c’est ce qu’il croit. Ceux qui l’entourent ne sont pas dupes : « J’ai souvent éprouvé que la parabole de la brebis égarée reste une des plus difficile à admettre pour certaines âmes, qui pourtant se croient profondément chrétiennes. Que chaque brebis du troupeau, prise à part, puisse aux yeux du berger être plus précieuse à son tour que tout le reste du troupeau pris en bloc, voici ce qu’elles ne peuvent s’élever à comprendre. Et ces mots : « Si un homme a cent brebis et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s’est égarée ? » – ces mots tout rayonnants de charité, si elles osaient parler franc, elles les déclareraient de la plus révoltante injustice. » Son épouse sait de quoi il retourne et pourtant c’est elle qui fait le plus preuve d’amour et de charité, malgré la vision qu’en a le pasteur : « Sa charité même est réglée comme si l’amour était un trésor épuisable. » Ce qu’il ne voit pas, c’est la douleur de l’autre. Les sentiments. Aveuglé par sa condition d’homme de prière et de bonté, il n’imagina à aucun moment les conséquences de ses actes de dévotions, les conséquences de l’inconnue en son foyer.
Pour terminer, les années ont passées et la jeune aveugle est guérie. Elle voit. Elle voit la beauté des paysages montagnards, elle voit la bonté des hommes et l’espoir qui les porte. Mais elle voit finalement, comme elle le pressentait, tout ce qu’on lui cachait : « Je ne veux pas d’un pareil bonheur. Comprenez que je ne… Je ne tiens pas à être heureuse. Je préfère savoir. Il y a beaucoup de choses, de tristes choses assurément, que je ne puis pas voir, mais que vous n’avez pas le droit de me laisser ignorer. (…) je crains, voyez-vous, que le monde entier ne soit pas si beau que vous me l’avez fait croire, pasteur, et même qu’il ne s’en faille de beaucoup. » Une réalité qui la dépasse, la dégoûte et la déçoit. Qui lui fait prendre son existence en main…
Ce n’était pas elle l’aveugle. C’était le pasteur. Gorgé de principes il ne voyait plus les hommes dans leur simplicité, dans leur dénuement. Il ne voyait que la parole à répandre. Ce que la jeune aveugle lui enseigne, c’est de retourner à l’essentiel, au cœur de l’homme : « le péché reprit vie, et moi je mourus ». La fin de l’innocence pèse car elle amène la fin du rêve, implique de s’attaquer à la réalité, de la saisir, de la comprendre. Et de vivre avec.
Trois mouvements courts dans ce roman bref. Trois mouvements pour la symphonie, la bonté, l’amour et la désillusion. André Gide signe un texte humaniste, et malgré le poids qu’y occupe la religion, n’enjoint personne à prier, bien au contraire. La Symphonie Pastorale extirpe le cœur des croyances, l’amour, et raconte les rêves des hommes et ces saintes passions qui les emportent loin de là où ils croyaient aller, loin de leur simple condition d’hommes uniques mais semblables toujours parmi les autres.
Matthieu Marsan-Bacheré