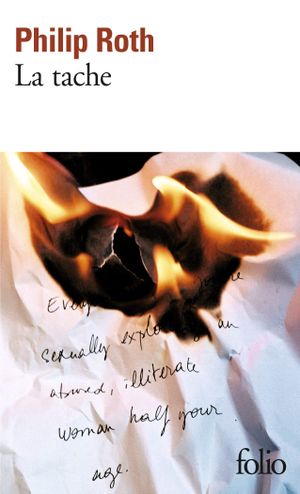Chronique vidéo https://www.youtube.com/watch?v=0Szzp8ePFD4
De quoi ça parle ?
Coleman, spécialiste des lettres classiques de 71 ans, est le doyen de l’université d’Athéna. Il estime qu’il a été victime d’injustice lorsqu’il est renvoyé de l’université après avoir été accusé de racisme, ce qui aurait selon lui précipité la mort de sa femme Iris. A côté de cela, il entretient une liaison quelques temps plus tard avec Faunia, une femme de ménage de 34 ans. Elle est divorcée de Les, un vétéran de la guerre du Vietnam menaçant et rongé par les souvenirs de la guerre. Mais le livre ne parle pas que de ça, car on retourne dans le passé de Coleman pour voir comment il est devenu l’homme qu’il est. On s’intéresse aussi au cas de Delphine Roux, que toute désigne comme le corbeau de cette affaire. Et pleins d’autres choses.
Comme je vous dis souvent plus le livre me plait, plus il est difficile pour moi de bien en parler, voire d’en parler tout court. C’est comme sortir d’une rêverie, je me sens embrumée, émerveillée, paresseuse. Mais je vais essayer quand même. Il va falloir pour analyser au mieux que je révèle le ressort principal du roman, donc attention aux spoils, même si pour moi, un bon livre peut être apprécié dans ces conditions. Surtout que quand j’ai recopié les citations du roman, après l’avoir terminé, je me suis aperçue de tous les sous-entendus, tout ce qui nécessiterait une seconde lecture pour prendre la mesure de l’armature du livre, ce qui pour moi est vraiment la preuve d’un très bon texte. On a envie de le relire, presque tout de suite !
Le récit commence dans la tradition du roman américain à la Gatsby, avec un narrateur moins flamboyant, moins haut en couleur si je puis dire que le personnage principal, avec un récit cadre, raconté par un spectateur des évènements peu ou pas engagé dans ces mêmes évènements.
Il va nous raconter la chute de son ami Coleman Silk, un professeur helléniste, qui a monté les échelons de l’université un à un pour la réagencer à son goût, ce qui lui a valu admiration, mais aussi jalousie et antisémitisme par certains de ses collègues. Il tombera de son piédestal lors d’un cours, où il se plaint de l’absence d’élèves en les qualifiant de zombies. Mais les élèves en question sont noirs et le terme est jugé raciste. Il faudra pour lui quitter l’université, ce qui provoquera sa rage, son obsession d’une réparation, jusqu’à la mort de sa femme Iris, qui le calmera, ôtera de son esprit l’envie d’une vengeance.
Le doute s’immisce dans notre tête, parce qu’on remarque dans un premier temps, que la formulation est étrange. « Comprenez bien le contexte ; j’ai dit : Est-ce qu’ils existent ou est-ce que ce sont des zombies ? »
La formulation est curieuse, il aurait pu demander est-ce que ce sont des fantômes par exemple. Pourquoi ce mot-là lui a-t-il échappé ? Est-ce que Coleman est effectivement raciste ? Après tout, comme le précise un personnage du roman, sa spécialité est le pan le plus blanc des études littéraires. Et puis surtout, Coleman n’a de cesse d’avoir le terme d’eux, dans la bouche. « Et qu’est-ce que ça m’apporterait, sinon de me faire penser à « eux » encore deux ans ? » Qui est ce eux, les détracteurs ou les noirs ?
Et puis, lors d’une dispute avec son jeune avocat Primus, un autre mot lui sort de la bouche. Une insulte signifiante, comme le zombie inaugural, car il le traitera de Blanche-Neige. Le lecteur est aussi confus que l’avocat, et c’est là que le texte retourna tous nos pressentiments et nos petites certitudes. Car ces mots qui quittent l’esprit de Coleman, presque à son insu, c’est le retour du refoulé. De ce qu’il a refoulé toute sa vie. De ce qu’il envisage comme « une tare abjecte » sans se le formuler clairement.
Car Coleman n’est pas juif. Il est noir. Il a vécu le racisme des années 50-60. Racisme qui sert de contrepoint au racisme de l’époque du livre,
« ils s’arrêtèrent chez Woolworth acheter un hot-dog, et il se fit traiter de nègre. C’était la première fois ; on ne lui servit pas son hot-dog. »
C’est là où l’on pourrait quand même reprocher à Roth une facilité de pensée. Celle d’un « A l’époque, le racisme existait vraiment, aujourd’hui, c’est quand même beaucoup plus soft ». Ou d’un aujourd’hui, on cherche des poux trop facilement aux gens, chasse aux sorcières etc. C’est pas parce que c’est plus insidieux que ça n’existe pas. Mais on lui pardonne facilement, un roman n’a pas à être un traité ou un essai sur l’évolution du racisme dans la société américaine.
Bref. Coleman décide, à la suite des discriminations vécues, de mentir sur qui il est. Cela se fait progressivement, d’abord plus par omission. Il comprend qu’il ne pourra jamais obtenir la vie qu’il souhaite avec sa couleur de peau, et il a la peau assez claire pour pouvoir prétendre être blanc. Le noir est donc un marqueur social avant tout.
Par exemple, il sort un temps avec Ellie, une femme noire qui le perce à jour. Elle pourrait lui offrir ce qu’il attend, et surtout, son nouveau mensonge serait plus facile à porter à deux — ils seraient un couple mixte, lui le blanc, elle la noire, couple que l’Amérique de ces années-là commence à tolérer. Mais il refuse. Il ne voit pas en elle la possibilité de vivre à visage découvert, mais un marqueur social, celui qui l’empêchera de devenir qui il veut être et le ramènera à sa situation d’origine. Il refuse de la présenter à sa mère, parce « qu’il n’a pas envie d’entendre le soupir de soulagement qui lui dira, sans passer par les mots qu’il fait ce qu’on attend de lui. » Quand il se met avec Iris, sa future épouse juive, il la choisit pour ce qu’elle représente de l’extérieur. C’est presque un mariage de convenance, décidé de manière unilatérale. De plus, il la choisit pour sa chevelure bouclée, qui pourra marteler son mensonge aux yeux de tous, et expliquer les cheveux crépus de ses enfants à venir.
On explique enfin que ce eux dans la bouche de Coleman, ce n’est pas celui qu’on croyait. Le eux, c’est celui du monde blanc, de la domination. Domination à laquelle il souhaite appartenir pour ne plus être dominé. Et ce blanchiment, ce changement de classe aussi, rend le noir obsessionnel.
L’obsession, c’est une « Idée répétitive et menaçante, s'imposant de façon incoercible à la conscience du sujet. »
C’est quelque chose qu’il a sans cesse en tête, et qu’il tente par tous les moyens de supprimer. Par exemple, quand il lit le poème de Steena, sa petite amie danoise avant de rencontrer Iris
« Comme il déchiffrait son écriture à toute vitesse, dans la pénombre du hall, il lut d’abord « nègre » à la place de nuque — et de sa nègre… Sa nègre ? »
Steena, c’est l’autre visage du bonheur. Il tombe amoureux d’elle, la présente justement à sa mère, assumant enfin qui il est. Mais c’est elle qui prendra ses jambes à son cou, convaincant Coleman qu’il est sur la bonne voix en décidant de se travestir.
Un des chapitres du roman s’appelle Le punch. Le punch, cela pour être une référence à ses années de jeunesse pendant lesquelles il était boxeur. Mais surtout, le punch, c’est à sa mère qu’il le donne, dans une scène terrible dans laquelle il annonce qu’il n’est plus noir, qu’il n’est plus son fils, et qu’il ne veut plus la voir. Elle lui répondra « Tu m’as donné bien des avertissements, depuis le jour de ta naissance ou presque. Même le sein, tu répugnais à le prendre. […] Tu penses en prisonnier. Si, Coleman Brutus. Tu es blanc comme neige, et tu penses en esclave. » Brutus, comme celui qui poignarde dans le dos, le traitre.
Et cela explique le zombie, et cela explique le Blanche-Neige, car son frère lui dira : « Ne t’avise pas de montrer ta petite face de Blanche-Neige dans cette maison. »
Et donc la lutte contre le racisme qui passe dans le roman par la chasse aux sorcières semble être un moyen d’expier le racisme qui s’inscrit profondément dans les racines du pays. Coleman paie et perd sur tous les tableaux. Il est victime de racisme, raison pour laquelle il change d’identité, et coupable de racisme pour avoir changé cette même identité. Ce qui fait qu’il ne peut plus faire marche arrière, il est impossible pour lui de révéler son secret, de dire je ne peux pas être raciste puisque je suis noir, car son comportement, bien que compréhensible, est d’une radicalité sans pitié. Il fait une croix sur sa famille, sur son histoire, et peut-être aussi sur le futur de ses enfants, pour réaliser l’assimilation parfaite — ne plus être noir, devenir blanc. La disgrâce, c’est celle-là, pas l’accusation de racisme. C’est celle d’avoir menti toute sa vie sur qui il était vraiment. Toute cette hypocrisie révélée dans le dernier acte, lors de la scène de l’enterrement, n’en demeure pas moins touchante. Humaine, comme Coleman. Laissant un goût amer dans la bouche.
Et donc, je trouve que c’est un livre qui montre bien l’hypocrisie américaine, comme celle de ne choisir qu’un casting presque entièrement blanc pour jouer dans l’adaptation, l’adaptation d’un livre qui parle d’un homme noir.
Disgrace
Disgrâce est le maitre mot du roman, comme celui de Coetzee, qui a aussi un universitaire comme personnage principal. Le livre de Coetzee est sorti un an plus tôt, et traite les mêmes questions, celles de l’héritage que laisse un pays ségrégationniste, l’Afrique du Sud pour Disgrâce et les Etats-Unis pour La tâche.
La disgrâce frappe chacun des personnages de Philip Roth. Coleman d’abord, disgrâce sociale avec son renvoi de l’université et l’opprobre que cela suscite. Puis plus tard avec la révélation de sa relation avec Faunia, une relation que l’extérieur juge « problématique » à cause de la différence d’âge et de statut social du couple.
La disgrâce est un terme qui revient à 4 ou 5 reprises dans le roman, et je pense qu’il est le socle, la clé de compréhension du bouquin. C’est un terme vieilli, qui relève de la Fortune, Fortune qui défavorise. Mais aussi le contraire de la grâce, donc un sens religieux.
La grâce, d’un point de vue religieux, c’est l’aide divine pouvant mener une personne à son salut. Et ce qu’on remarque dans le roman, c’est que c’est souvent dans la disgrâce que les personnages trouvent la grâce. Qu’ils quittent le normal pour une vie supérieure, une vie dévoilée, une vie douloureuse, car cristallisant les années de souffrance et de mensonge, mais qui atteint le sublime.
Chez Coleman, la disgrâce, dans un premier temps, peut ressembler à la vieillesse. Il est un vieil homme encore en forme, mais seul, abandonné par sa famille, par son travail. Cependant, son humanité se fonde sur sa vulnérabilité, c’est finalement la disgrâce qui le sépare du reste du monde, qui en fait un personnage extra-ordinaire, un personnage de roman.
La disgrâce à une relation privilégiée avec le mensonge et la vérité. Sauf que le texte et le lecteur oscille. Qu’est-ce que la disgrâce ? Le mensonge ou la vérité ? Le mensonge qui devient vérité ? C’est ce que reproche Coleman à ses enfants, celui de ne pas faire confiance en l’histoire que leur raconte leur père : « Vous m’avez posé des questions sur vos grands-parents, vous m’avez demandé qui ils étaient, et je vous l’ai dit. Ils sont morts quand j’étais jeune. […] Et le seul à ne pas s’en contenter avait été Mark. « D’où ils venaient, nos arrière-grands-parents ? De Russie. ». Quelle est la disgrâce ? Celle de ne pas être cru sur parole ? Celle de mentir ? C’est la révélation de la vérité ou le mensonge initial qui destitue Coleman ? Le texte a l’intelligence de laisser le lecteur choisir.
Une autre disgrâce marquante, est celle de Delphine Roux. Jeune femme qui travaille avec Coleman, elle est le corbeau qui envoie des courriers anonymes sur la vie privée de celui-ci. Mais ce qu’on apprend, dans le roman, c’est qu’elle est secrètement amoureuse de Coleman. C’est d’elle dont tout est parti, qui ne s’avoue pas son amour et ce mensonge à elle-même, c’est sa disgrâce à elle, disgrâce qui éclate au grand jour à la mort de Coleman « Les yeux ouverts, elle se voit dans sa disgrâce, les yeux fermés, elle le voit se désintégrer. » La disgrâce de Delphine, c’est d’avoir provoqué indirectement la mort de celui qu’elle aime, et d’avoir révélé à l’université entière qu’elle l’aimait, par un acte manqué. Acte manqué comme le zombie et le Blanche-Neige sorti de la bouche de Coleman. Le corps trahit ou plutôt révèle les trahisons de l’esprit.
Et enfin, celle dont la vie pourrait se nommer Disgrâce, c’est Faunia. Faunia a tout perdu, elle a perdu ses enfants dans un incendie, a subi les assauts d’un beau-père dans son enfance, tout le monde pense qu’elle ne sait ni lire ni écrire. Pourtant, on apprendra qu’il s’agit d’un mensonge, mensonge qu’elle-même laissait entendre pour se protéger. Et c’est constitutif d’un personnage complexe, peut-être le plus beau personnage féminin que j’ai lu depuis un bon moment. Faunia assume la disgrâce, en fait une sorte de protection, de manière de vivre différente, sans attente de réussite ou de guérison. C’est elle, qui est le plus touchée par la grâce dans sa disgrâce. Car la disgrâce l’éloigne du quand-dira-t ‘on, d’une vie intellectuelle médiocre et refoulée comme celle de Delphine. Delphine est l’image distordue de Faunia, elles ont à peu près le même âge, aiment toutes les deux Coleman. Mais l’une n’est que répression quand l’autre est lâcher-prise. Pas lâcher prise dans un sens de développement personnel, mais dans un sens d’abandon total, de glissade, de rien à foutre de ce que pensent les autres. Elle est l’égale de Coleman, alors que Delphine, malgré les études et les diplômes reste puérile. Les deux sont hors du monde et c’est ce qui rend leur histoire touchante « un corbeau qui ne sait pas vraiment être corbeau, et une femme qui ne sait pas vraiment être une femme. »
Tragédie
Le roman est sous la forme d’une tragédie. Une tragédie annoncée dès le début, avec des prolepses qui propulsent dans le futur et qui « spoilent » si je puis dire, attisant la curiosité du lecteur « Ils étaient enterrés depuis quatre mois que je me rappelais encore cette séance comme une pièce de théâtre où je n’aurais eu qu’un rôle muet ».
Qu’est-ce qu’une tragédie exactement ? La tragédie remonte au théâtre grec antique, qui comme par hasard est la période étudiée par Coleman.
Elle a évolué à travers les siècles, les auteurs de la Renaissance, classiques ou modernes l’ont chacun retouchée pour la faire correspondre aux canons de leurs époques, mais en général, elle met en scène des personnages de rangs élevés et se dénoue très souvent par la mort d’un ou de plusieurs personnages. Elle a pour vocation d’édifier le public, qui passe par la catharis pour se purger des ses passions. Ce dont j’avais déjà parlé dans ma vidéo sur Albert Cohen.
Ce qui pourrait rapprocher La tache de la tragédie grecque est sa structure et même sa forme littéraire. Comme figure de style, Roth est particulièrement friand des anaphores, une figure qui consiste à répéter un mot en début de phrase, ou de parties de phrase, ceci afin de marquer une insistance, ou de renforcer ce qui est dit, ce qu’on pourrait rapprocher du rôle des refrains chantés par le chœur dans la tragédie.
Dans la tragédie, les scènes sont racontées par un messager (qui est ici l’écrivain, double de Philip Roth) ; les scènes violentes ne peuvent être montrée, ici, la disparition de Coleman et Faunia se passe hors champ. Le chœur est un groupe homogène et non individualisé d'interprètes, qui commente d'une voix collective l'action dramatique. Et il n’est pas rare dans les transitions entre deux chapitres que des voix polyphoniques et indifférenciées prennent le relais du récit, mêlant à l’histoire de Coleman des accents mythiques et nationaux — on pense à la discussion sur Clinton. Tout ce qui donne du réalisme, de la chair au roman, j’adore être perdue comme ça personnellement.
La tragédie, souvent, c’est l’inéluctable. Le destin qui se tisse comme un licol, quel que soit la réaction du personnage. Œdipe ne peut échapper à son destin, de même pour Coleman. C’est ce qui ressort de la relation avec son fils.
« Markie voudrait quelque chose qu’aucun d’entre nous ne peut lui donner.»
Mark sent le mensonge, et plus que n’importe quel autre enfant de Coleman. Et va s’enfermer dans la religion, cherchant un sens, une origine à son histoire qui lui échappe par la faute de son père. C’est ça, La tache du titre. C’est le mot barré, illisible, qui empêche à toute la famille Silk de se comprendre.
Un autre détail intéressant sur le thème de la tragédie. Le nom de famille de Coleman est Silk, qui signifie soie. Et le mot « soie » vient du latin saeta (« soie de porc, poils du bouc »). Quand on se renseigne sur la tragédie, on apprend que le bouc en est une justement une figure primordiale : En effet, tragédie signifierait « chant du bouc ». Et en cette évocation du bouc, il faudrait lire « la récompense offerte » à « la victime d'un sacrifice »
Coleman est la victime du sacrifice expiatoire de toute la ville d’Athéna et peut-être bien de l’Amérique. Un sacrifice pour expier leurs péchés, ceux du racisme, de la ségrégation, de l’esclavage, la faute collective sur laquelle toute l’histoire du pays se fonde.
CONCLUSION
C’est un roman que je ne peux que recommander. Quand je lis certaines critiques sur Babélio, qui le compare à l’affaire Harry Quebert, j’ai les cheveux qui se dressent sur ma tête.
Si je devais juste émettre une réserve, elle concernerait le dernier quart, peut-être un peu mélo. Je pense surtout à la rencontre entre la sœur de Coleman et l’écrivain, où Roth dénoue tous les nœuds, éclaire toutes les zones d’ombre ce qui ressemble vraiment à la dernière partie de certains films américains, où l’on vogue dans la surexplication, et la surémotion.
Mais je pinaille beaucoup, parce que franchement, j’ai adoré ce livre, j’ai adoré le style de Philip Roth. J’adore comment il nous perd parfois, change de point de vue, entre dans la tête de ses personnages grâce au discours indirect.
Je me sens toujours très reconnaissante quand je lis le premier livre d’un auteur qui me plait beaucoup, comme si je découvrais un trésor. D’ailleurs celui-ci est le troisième d’une trilogie, qu’on peut lire de manière totalement indépendante. Bref attendez-vous à d’autres chroniques qui parlent de lui dans les temps à venir.
Je suis rarement aussi conquise, donc n’hésitez pas à l’ouvrir, bon dans quelques semaines le temps d’oublier toute l’intrigue que je viens de révéler.