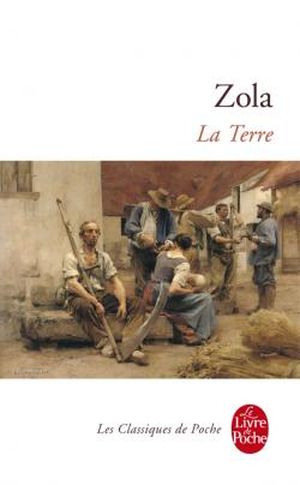La Terre, Emile Zola, La Pléiade, cycle Les Rougon-Macquart, vol. IV
L'actualité de nos campagnes m'a conduit à lire "La Terre" d'Emile Zola, le quinzième volume du cycle des Rougon-Macquart. Celui, sans doute, qui a le plus scandalisé en son temps.
Ce n'était certes pas sans motifs, tant au fil de la lecture on se surprend, plus d'un siècle plus tard, à se situer quelquefois du côté des contempteurs. On s'y trouve, certes, avec du beau monde, Anatole France entre autres qui en a dénoncé en ces termes l'"obscénité gratuite" : "Je ne lui nierai point sa détestable gloire. Personne avant lui n'avait élevé un si haut tas d'immondices" !
Le roman se situe en Beauce, à la fin des années 1860, dans un petit village de petite paysannerie. Le père Fouan décide à 70 ans de mettre ses affaires en ordre, comme on le dit quand un paysan doit s'arracher à la terre dans l'attente de l'être à la vie. Il partage ses biens entre ses trois enfants, non sans remous ni querelles (partage, tirage au sort des lots, bornage, ressentiment) , moyennant le paiement par chacun d'eux d'une modeste rente. C'est l'histoire d'un dépouillement, qui lui coûte. L'avarice, la cupidité et l'ingratitude des siens vont faire le reste : le père Fouan est proscrit dès qu'il ne possède plus rien, dépouillé de ses dernières économies, exilé parmi les siens qui l'hébergent puis l'expulsent, à tour de rôle, quand il n'y a plus rien gratter. Cet attachement vital, possessif et cupide à la terre fait le livre.
On est certes loin des naïvetés bucoliques qui font, généralement, aux yeux des gens des villes, l'authenticité de la campagne. Mais il est vrai que Zola pousse le bouchon un peu loin, se complaisant, semble-t-il, au trash et au scatologique : des viols comme s'il en pleuvait, y compris de la Grande (89 ans tout de même, violée par son petit-fils, un demi demeuré), des concours de pets, des hommes ivres et lubriques en toute occasion, des femmes faciles, encore célibataires ou mal mariées, qui jouent de leur corps entre bottes de foins... Tout ceci pèse beaucoup.
Jusqu'à une scène, assez dérangeante à lire de nos jours, de l'accouchement d'une jeune femme, pendant qu'un vétérinaire fait vèler, dans l'étable qui jouxte la chambre de douleurs, une vache dans des complications atroces. Le luxe de détails et jusqu'à l'effet de vérité des ces deux délivrances concomitantes sont obscénes, même si le cocasse y tient une part, qui nous fait (hélas) rire aux éclats (la fin est heureuse, et la partunriente soulagée de voir le veau avant son nouveau-né (!) mais on est honteux tout de même d'avoir ri...).
On comprend cependant que pour Zola, la terre qui, en ce temps est tout, est d'abord fertilité, d'où la convoitise, fécondation, en sa brute "naturalité", et en ces temps, après les labours, fumier "odeur puissante de ces fientes, nourrices du pain des hommes" ("La puanteur du fumier que Jean remuait l'avait un peu ragaillardi. Il l'aimait, la respirait avec une jouissance de bon mâle, comme l'odeur même du coït de la terre" ).
Il y a dans ce livre, si l'on n'est pas trop retenu par ces quelques épisodes, des pages superbes sur la terre, la terre à blé, les veillées à la chandelle, les rendez-vous chez le notaire, une fête de mariage, les fenaisons, la grêle, les semailles, les vendanges, l'orage, les prés, la sueur et les gestes recommencés, en choeur dans toute la campagne, donnant leur rythme immuable aux saisons que tous partagent.
Des pages de grande littérature et, comme souvent chez Zola, un peu au-delà de la littérature. Des descriptions et des scènes épiques, grandioses. Ses personnages sont de la glaise des hommes (de chair, de sang et ici... d'intestins) mais ont la force et le tempérament de dieux grecs : prescrivant, ordonnant, violant, tuant, ne pardonnant jamais.
"La Terre" n'est plus un roman, c'est une mythologie. Le vieux père Fouan, rejeté par ses enfants, c'est le roi Lear ; Françoise, sa cousine qui épousera le fils cupide du père Fouan, c'est Médée ; la figure de La Grande, la soeur aînée, une divinité persécutrice. "Jésus-Christ", le fils alcoolo du père, Bacchus bien sûr.
Mais cette mythologie recèle aussi des enseignements très contemporains sur le sort des paysans et de l'agriculture . Des pages étonnantes de vérité sur le paysan depuis la Révolution française, puis confronté à la mécanisation et à la science des sols ( " Un paysan serait mort de faim, plutôt que de ramasser dans son champ une poignée de terre et de la porter à l'analyse d'un chimiste, qui lui aurait dit ce qu'elle aurait de trop ou de pas assez"), et au reste : " Tout l'écrase, les impôts, la concurrence étrangère, la hausse continue de la main d'oeuvre , l'évolution de l'argent qui va vers l'industrie et les valeurs financières", y compris la tension, toujours actuelle, entre revenu agricole et prix des denrées alimentaires et protectionnisme et libre-échange : " Si le paysan vend bien son blé, l'ouvrier meurt de faim. Si l'ouvrier mange, c'est le paysan qui crève. Alors quoi ?".
Alors quoi ? Relire Zola : un géant, même les pieds dans le crottin, reste un géant !