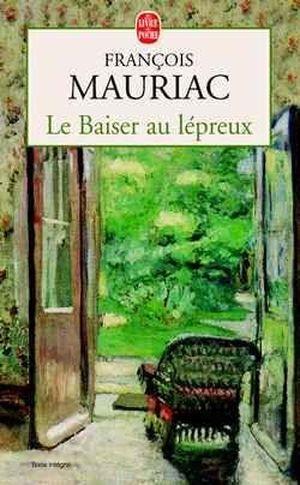Avec le recul, je me rends compte, maintenant, que durant mes cinq années d'études de "lettres modernes", on m'a très peu parlé de littérature du XXe siècle. D'un côté, il s'agit d'une déception : c'était là que se concentraient (et se concentrent toujours) mes lacunes. Or, en tout, on a du me parler un peu du Nouveau Roman, pas mal de Céline et Duras et énormément (jusqu'à l’écœurement) de Proust. Tout cela laisse de côté de grands absents, que ce soit dans la littérature française ou étrangère. Aucun titre de Giono, aucune phrase de Romain Gary, pas le moindre mot concernant François Mauriac, trois exemples, parmi d'autres, de grands auteurs du siècle.
Du coup, merci à mon prof de seconde, qui m'avait fait découvrir Mauriac, auteur que je trouve injustement oublié de nos jours.
D'abord, Mauriac, c'est une incroyable maîtrise de la langue. Les phrases sont ciselées, travaillées comme des diamants. On sent le souci du rythme avant tout.
Les romans de Mauriac sont généralement très courts, avec, certes, une volonté d'aller à l'essentiel, mais aussi (et surtout) cette volonté de concentrer la force dramatique. A mes yeux, ce Baiser au lépreux se rapproche d'une tragédie : pas de blabla inutile, unité d'action, et des personnages qui sont le lieu de conflits entre les désirs et leur morale.
Jean Péloueyre fait partie de cette bourgeoisie provinciale oisive. Dans le domaine familial, au cœur des Landes, on a l'impression qu'il passe ses journées à ne rien faire. Le narrateur nous le dit clairement d'ailleurs : il est incapable de faire quoi que ce soit. Et quand il commence quelque chose, sur un coup de tête, c'est pour abandonner très vite, vaincu par le flot de pensées désordonnées qui circule dans sa tête et par une incapacité à s'organiser et à s'atteler sérieusement à son travail.
Mais il n'y a pas que le travail que Jean fuit. Il y a aussi l'ensemble de l'humanité.
Bien que jamais décrit, on comprend très vite que Jean Péloueyre est d'une laideur peu commune. Et cette laideur va l'empêcher d'avoir une vie sociale. Jean va passer son temps à fuir les autres, ne marchant dans les rues que lorsqu'il n'y a personne ou lorsque l'ombre lui fournira un refuge idéal, préférant rester seul dans sa chambre ou au milieu de la lande à ressasser ses pensées.
Et s'excusant presque de fouler la terre. La question de la dignité envahit Jean. Il ne se sent pas digne d'être sur terre, pas digne qu'on lui consacre du temps. Il ne mérite rien de tout cela. Il se sent une sorte de parasite et se complaît dans un constant flagellement moral.
Il se sent si bas qu'on assiste à une inversion de l'ordre social, ses serviteurs paraissant plus vivants et plus heureux, plus à leur place dans ce monde, bref : plus favorisés.
Et un jour, on va lui proposer un mariage. Un mariage forcément arrangé, dans toute la tradition, avce la plus belle fille du village, Noémi. Mariage qui va définitivement transformer leur vie, à tout deux, en une tragédie implacable.
Dans ce roman sur le sacrifice et l'emprisonnement volontaire, on sent toute l'influence de la morale chrétienne qui va guider les personnages. Mais, à chaque fois, la question de la foi se pose : Jean croit-il vraiment, ou cherche-t-il une consolation ? Et l'attitude de Noémi face aux avances ouvertes du très beau médecin, est-ce par fidélité maritale, ou par chasteté chrétienne ?
Nous allons donc avoir deux personnages qui croient devoir s'opposer à leurs désirs et mener une vie de sacrifice (de là à dire qu'il y a une thématique très proche de Mauriac, qui auraient eu des tentations homosexuelles que son éducation chrétienne ne pouvait accepter, il n'y a qu'un pas...).
Le tout se fait dans un décor qui semble contaminer par la laideur de Jean et par l'agonie des idéaux d'une bourgeoisie enfermée sur elle-même.
Un court roman (150 pages) douloureux mais superbement écrit, aux accents de tragédie.