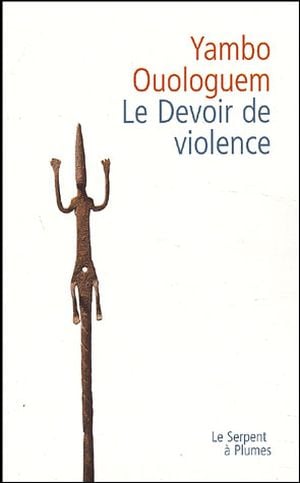J'ai découvert par hasard le Devoir de violence en le voyant passer sur mon fil d'actu SC, dans l'envie de lire d'un contact. D'abord vaguement interpellé par le titre, puis par le fait qu'il s'agissait d'un roman d'Afrique noire, zone littéraire m'ayant toujours pas mal parlé, la surprise s'est triplée lorsque je me suis rendu compte en lisant le quatrième qu'il s'agissait forcément d'un hypotexte du dernier Goncourt, La plus secrète mémoire des hommes – dont vous pouvez retrouver une critique ici https://www.senscritique.com/livre/la_plus_secrete_memoire_des_hommes/critique/259858158
Je mentionne cette anecdote pour bien poser d'emblée le problème de réception qui s'est posé pour moi en parcourant le Devoir de Yambo Ouologuem : mon horizon d'attente avait déjà été trop modelé par une autre œuvre ; Le Devoir est un vrai bon livre que je n'ai pas réussi à aimer.
Ce roman malien, publié en 1968 et obtenant le Renaudot la même année, met en scène, sous la forme d'une épopée orale, les déchirements politiques successifs qui agitent la cour de Nakem et son trône, un empire fictif d'Afrique de l'Ouest, de sa fixation au Moyen-Âge jusqu'à la destinée de son dernier roi dans la première moitié du XXe.
Roman retenu autant pour sa force évocatrice sombre et magique de la violence avec laquelle on s'arroge le pouvoir que pour ses étranges plagiats glissés au sein du texte, ce Devoir de violence est une œuvre qui mêle l'énonciation du conte merveilleux avec une parole de chronique assez typique des entreprises de fixation par écrit des récits de griots – on a ainsi une véritable habitude dans le livre de traiter en quelques pages la destinée d'un personnage qui s'achèvera par sa mort, tragique ou bouffonne, avec une prière et un appel à Dieu, parfois ironiques, pour planter le dernier clou de la page et de son sujet.
Il y a quelque chose de sirupeux et de labyrinthique qui marche bien dans ce roman tortueux, où les rois pervers et manipulateurs s'enchaînent, partageant leur nom dynastique, au point de se confondre dans une espèce de vision persistante d'un mal politique surplombant et inquiétant. Le discours de fond du livre appuie pas mal sur l'exploitation fondamentale de la chair par les puissants, dans une logique de représentation où les Blancs sont souvent des dupes un peu cons (mais complaisants dans leur opportunisme) et les Noirs des carnassiers impitoyables ayant bâti une vaste entreprise industrielle de capitalisation sur l'esclavage. Le roman est censé marquer par l'agressivité avec laquelle il présente le cynisme et la brutalité des rois, colorant étrangement l’œuvre d'une perspective symbolique, magique, tribale attendue au vu du ton conteur mais qui se renverse presque en roman social par instants. Cet entre-deux étrange est assez unique et donne son cachet au bouquin.
J'ai un peu de mal à situer clairement ce qui m'a rendu la lecture du bouquin pénible, parfois désengagée, et plutôt négative tout bien pesé. Malgré une syntaxe volontairement tordue parfois, le bouquin est bien écrit, avec des images en eaux-fortes plutôt vives et percutantes, son merveilleux est dosé avec une justesse toute particulière qui fait presque signe vers le réalisme magique – quelle différence quand on en sort avec L'Homme qui savait la langue des serpents, je le mentionne eu égard à l'importance des reptiles dans ce livre-là aussi... Le propos du livre est violent, questionnant, intéressant, et quelques très bonnes scènes de meurtres politiques notamment me resteront je pense dans les salles du musée imaginaire.
D'où, finalement, mon hypothèse initiale que je ramène. Sarr – qui est d'autant plus décevant après lecture de Ouologuem – tirait le peu de puissance de son roman de l'idée qu'il pouvait exister un livre si noir et dérangeant qu'il en venait à effacer dans un grignotage cannibale celui qui l'a écrit comme ceux qui l'ont lu, grâce à sa poétique fantomatique et fascinante d'une sorte de mal métaphysique indiscernable. Il est difficile de se hisser à la hauteur d'une telle promesse, Bolano (et sans doute Balzac et d'autres avant lui) l'avait bien compris et c'est sans doute la raison pour laquelle ses artistes maudits restaient toujours in fine ou improductifs ou incompréhensibles, et construits par la poésie du creux. Sarr apparaît a contrario comme un vulgaire rédacteur de roman à clef. Le Devoir est un vrai bon roman par bien des aspects mais qui ne peut pas délivrer cela, et peut-être que c'est cette impossibilité créée par l'horizon d'attente qui m'a maintenu sur le seuil.
Je ne le recommande tout de même pas comme première attaque du roman d'Afrique noire de ces années-là. Il me semble qu'il y a mieux à trouver ailleurs.