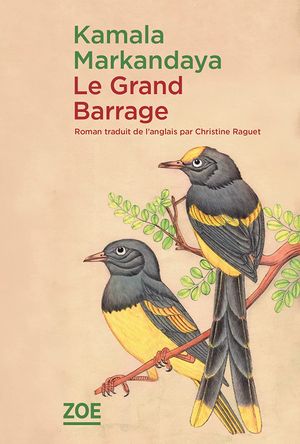Dans le Sud de l’Inde, indépendante depuis peu, une société britannique s’implante pour construire un grand barrage, symbole du bond en avant technologique et industriel du pays. Tandis que les villageois de la vallée sont déplacés et que les ouvriers affluent vers le village rudimentaire qui leur est réservé, les ingénieurs anglais et leurs femmes investissent les bungalows qui leur sont réservés. Avec une échéance en tête : la prochaine saison des pluies, la période de tous les dangers pour le chantier entamé sur cette rivière imprévisible.
Placé dès les premières pages sous le signe d’une lourde menace, Le grand barrage se déroule comme un accident au ralenti, que Kamala Markandaya narre dans un style étrangement dépassionné, presque atone, jetant ainsi une lumière froide et crue sur les comportements des britanniques dont elle adopte le point de vue jusqu’à ce que tout ce que cette société à deux vitesses refoule se mette à déborder en même temps que le fleuve sous l’effet de la mousson. Alors, à mesure que la terre devient de la boue et que les contours physiques du monde se font plus incertains, les certitudes morales semblent elles aussi se liquéfier.
Malgré quelques longueurs, le Grand barrage, initialement publié en 1969, dresse de manière subtile le portrait de cette société en vase clos, comme une fourmilière, et met en scène des personnages ballotés par les événements et qui ne savent plus se positionner dans une Inde en pleine transition : du côté des Britanniques, qui regrettent à demi-mot leur ancien pouvoir absolu tout en se débattant avec leur sens moral plus ou moins aigu, comme des Indiens, transformés par des années de rapports de domination qu’ils peinent à dépasser, à l’image de Das, le vieux domestique qui regrette qu’Helen Clinton, sa maîtresse de maison et l’épouse du chef de chantier, ne soit pas plus exigeante et plus respectueuse des protocoles et de la hiérarchie instituée par les anciens colons.