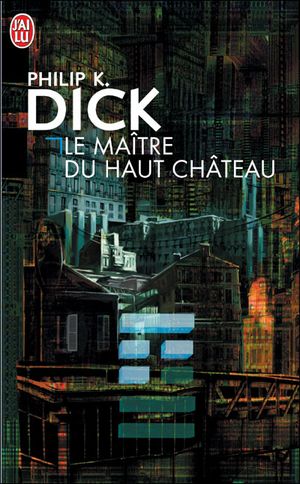Le Maître du Haut Château c’est un jeu de miroir atomique. D’un côté, il y a ceux que j’appellerais les « pâtir », c’est-à-dire les lecteurs qui, plus ou moins passivement, tournent les pages du Maitre du Haut Château ou celles du Poids de la Sauterelle ; Juliana Frink, M. et Mme. Tagomi, vous et moi en faisons partie. De l’autre, les « agir », beaucoup plus rares, qui, non content de faire l’histoire, la racontent, l’écrivent, l’imposent ; on retrouve évidemment Philip K. Dick et Hawthorne Abendsen, mais aussi, dans une certaine mesure, Frank Frink. Les premiers, caractérisés par leur instabilité, courent après l’octet, vers un état plus stable, alors que les seconds, précisément, en sont les détenteurs privilégiés. Et tous évoluent dans une incertitude probabiliste et un désordre réglé autour d’un noyau des plus attracteurs, faisant office de miroir révélateur, le Yi King.
Miroir oblige, chaque personnage est le reflet, quelque peu déformé il est vrai, d’un personnage du groupe opposé. Le couple Tagomi et Juliana Frink répondent ainsi à Hawthorne Abendsen, son ex-mari Frank et le lecteur à K. Dick, et bornant le tout, Le Poids de la Sauterelle, au Maître du Haut Château. Mais les rôles ne sont pas ainsi figés ; et tels des particules capricieuses, des nuages d’électrons avides de plein, chaque personnage renvoie, d’une manière moins directe que précédemment, à un second, du même groupe cette fois. C’est que les univers sont multiples dans le Maître du Haut en Château et qu’en conséquence, les relations interpersonnelles le sont également. Sur une valence inférieure, Juliana Frink et M. Tagomi tisse ainsi un lien avec le lecteur (vous et moi) et Hawthorne Abendsen, avec K. Dick. Les autres personnages (Robert Childan, Joe, M. Ramsey et Rudolf Wegener alias M. Baynes) libres car non conscients de la relativité de leur réalité, errent tels des électrons libres, prisonniers du Maître du Haut Château (pas Abendsen, le livre).
Or cette liaison ou cet accommodement de tous les individus à chacun et de chacun à tous les autres, fait que chacun a des rapports qui expriment tous les autres et qu’il est par conséquent un miroir vivant perpétuel de l’univers, un reflet du Yi King à sa mode. Selon le côté où l’on se place, l’univers prend alors différents visages : pour les uns, il est dominé par l’Axe après son triomphe sur Alliés, à la suite de l’assassinat de Roosevelt en 1933, pour les autres, par les Alliés, selon les faits que nous connaissons. Mais c’est une tout autre réalité que Le Poids de la Sauterelle, en tant qu’il est l’ouvrage dicté par le Yi King par l’intermédiaire de Abendsen, dépeint : si ce sont bien les Alliés qui sont sortis vainqueurs de la Seconde Guerre Mondiale, ni les russes, ni les américains ne se partagent les restes, mais les seuls britanniques.
Trois niveaux de réalité s’affrontent donc, deux antinomiquement, et un troisième, le nôtre, quelque part entre les deux précédents, au centre précisément. Et quand bien même Mr. Tagomi serait projeté dans ce dernier, plus cauchemardesque encore que le sien, par la méditation autour d’une broche riche en Wu, harmonieusement confectionnée par Frank Frink et vendue par Robert Childan, ce ne sera qu’en vertu d’une transition électronique éphémère. Car c’est encore depuis sa fenêtre, que chacun observe la ville, et seul appartient au Yi King de voir, au-delà l’horizon, le toile d’ensemble. D’où la multiplicité des mondes apparents, d’où la multiplicité des causes et des effets. Le débat autour de l’historicité et de l’authenticité des artefacts américains entre Childan et Tagomi, par exemple, nourrit le premier d’un tel désespoir qu’il le prépare à l’achat et à la vente des bijoux de Frank Frink, et donc à la visite du second dans notre monde. De là à dire que nous sommes tous, « pâtir » et « agir », des monades, il n’y a qu’un pas que l’atomisme épicurien intrinsèque à la philosophie de Leibniz permet de franchir.
Soit le modèle atomique de Rutherford-Bohr donc, avec son noyau, le Yi King, et ses orbitales électroniques sur lesquelles courent, toujours en vis-à-vis, les « agir », et les « pâtir », la plus faible en énergie, ou état fondamental, donc la plus proche du Yi King, étant tenue par Le Maître du Haut Château et la plus haute, par Le Poids de la Sauterelle. Les premiers évoluent ainsi au plus près du premier livre et les seconds, du second. Mais les orbitales ne sont pas ainsi faites qu’il est impossible de s’en émanciper, ne serait-ce que le temps d’un songe. Aussi est-il permis, comme à Mr. Tagomi grâce à la broche, selon ce que la mécanique quantique nous enseigne, d’accéder à l’orbitale supérieure par un saut d’énergie (en fait d’augmenter sa probabilité d’y être), et donc de se rapprocher de la vérité (notez que tenir le Maître du Haut Château entre ses mains peut exposer à pareille élévation vers la vérité et qu’à ce titre, le livre peut être considéré comme un objet d’une parfaite harmonie). Seulement, bien que souhaitable, la vérité est d’une nature si fragile et instable qu’à peine y-a-t-on porté le regard que déjà elle s’y dérobe. Mr. Tagomi expérimente ainsi notre niveau de réalité avant d’en être rejeté aussitôt.
Une question se pose alors ; si en effet la vérité, qui est le privilège du seul Yi King, siège au centre du modèle, comment se fait-il qu’on s’en approche en s’en éloignant ? C’est que le modèle dont on parle, qui fait grossièrement du noyau une sorte de trou noir dont la singularité serait la vérité, et des électrons, des particules plus ou moins avides de vérité, est lui-même pris dans un modèle similaire, lequel est lui-même pris dans un autre, et ainsi de suite, à l’infini. La vérité siège donc aussi bien au centre du modèle qu’à la périphérie du système dont il est partie prenante.
Le Maître du Haut Château est considéré comme le premier chef-d’œuvre de Philip K. Dick. Il est en tout cas le premier roman auquel il insuffle autant d’ambition, tant sur la forme que sur le fond. Il est en effet une chose de monter une uchronie, mais il en est une autre d’y emboîter une deuxième, et une autre encore de les intégrer toutes les deux dans un troisième niveau de réalité, qui s’avère par ailleurs être le nôtre ! Sur la forme, Dick écrit comme un architecte dessinerait un labyrinthe : avec malice (maléfice ?), délice et maints artifices. Et bien qu’il ne jugeât le roman jamais satisfaisant (il commença une suite qui ne connut jamais de troisième chapitre), on n’imagine mal l’écrivain souffrir de l’écrire tant il est plaisant à lire : le style, délié, presque haché, rythme la lecture et les dialogues, nombreux et faussement digressifs, la fluidifient. Surtout, c’est l’harmonie entre ce qu’il raconte et la manière dont il s’y prend qui confère au Maitre du Haut Château son statut de chef-d’œuvre ; le ton volontairement lapidaire et métaphorique du livre reflètent objectivement la détresse qu’éprouvent ses protagonistes. Enfin, en interrogeant constamment le lecteur sur le réel, l’art (qui permettrait d’accéder à la vérité), et en multipliant astucieusement les niveaux de réalité, Le Maître du Haut Château dégage une puissance folle et, en ceci, rappelle que la science-fiction n’a rien à envier aux traités de métaphysiques les plus canoniques, et annonce le second chef-d’œuvre de son auteur, Ubik.