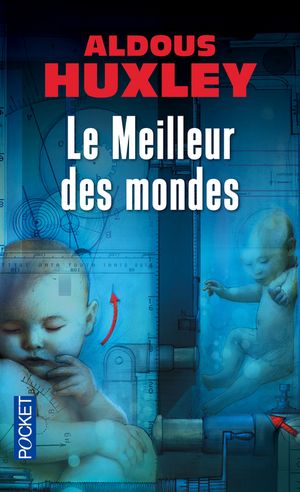Troquons-nous notre libre arbitre pour le bonheur ?
Difficile de se placer en critique légitime quand on s’attaque à un tel monstre du roman d’anticipation et que l’on a, comme moi, une culture peu étendue dans le domaine. En cela, mon avis se veut des plus subjectifs, mais la lecture du Meilleur des mondes est une expérience suffisamment marquante pour que je manifeste le besoin d’exprimer mon sentiment à son égard.
Ce qui est le plus frappant dans la société futuriste d’Aldous Huxley, c’est la manière selon laquelle se présente la dystopie, car il n’y est pas question de machines ayant supplanté l’humanité, de régimes totalitaires où règnent terreur, violence et révolte, ni d’univers prometteurs ayant viré au cauchemar. Dans le Meilleur des mondes, les hommes vivent prisonniers, certes, esclaves de la science et de leur confort, mais heureux. Heureux car conditionnés dès la naissance à aimer les tâches qui leur sont attribuées, heureux car abrutis par leur société.
Et cette vision de Huxley est d’autant plus terrifiante lorsqu’on la compare à l’évolution de notre monde actuel. Comment un écrivain a-t-il pu faire preuve d’une telle perspicacité ?
Car aujourd’hui, à l’heure où l’on cherche à nous catégoriser selon nos aptitudes, à l’heure où nous nous laissons bien volontiers lobotomiser par ces programmes débiles qui envahissent nos écrans, où l’on fait l’apologie de la bêtise et du superficiel, de la libération sexuelle jusqu’au rejet en bloc de la littérature, où l’on nous bombarde d’informations stupides et inutiles pour noyer notre capacité à réfléchir, où l’on nous pousse à toujours davantage consommer pour continuer de faire tourner les rouages de cette société qui nous anesthésie, qui nous promet un bonheur factice en nous faisant oublier notre part d’humanité, à cette heure-là, jamais notre monde n’a autant ressemblé aux prémices de celui de Huxley. C’est un fait, et c’est effarant de le constater au fil de notre lecture, mais le meilleur des mondes qu’on nous présente semble n’être que la conséquence logique de ce vers quoi nous tendons actuellement. En 1931, il y a 80 ans, il y avait un homme qui se doutait que nous troquerions peu à peu notre libre arbitre contre ce faux et triste bonheur.
Oui, le monde que nous dépeint Huxley est terrifiant, mais il l’est car nous parvenons encore à raisonner et à nous insurger face aux pratiques mises en œuvre pour atteindre ce bonheur, à l’image du personnage du Sauvage. Mais prenez les habitants de ce monde imaginaire (du moins l’est-il encore pour le moment). Eux, ne sont pas terrifiés mais heureux. Et c’est, je crois, la question qui me fascine le plus suite à cette lecture : peut-on condamner cette société qui rend ses citoyens heureux ? Cette société que nous percevons encore comme dystopique mais qui s’avère parfaitement utopique pour ceux qui y vivent ? Car même si ce bonheur est factice, permis par des esprits abrutis, tous, jusqu’à la caste la plus inférieure, sont heureux car conditionnés pour l’être. En d’autres termes, sommes-nous prêts, comme le suppose le livre, à sacrifier ce qui fait de nous des humains pour accéder au bonheur ?
Bien entendu, le Meilleur des mondes posent tant d’autres questions qu’il me serait bien compliqué de toutes les mentionner dans cette critique. Aussi je vous recommande vivement de les découvrir par vous-mêmes. Bien entendu, le livre commence à accuser son âge, le style n’y est pas toujours parfait, l’intrigue n’est pas surprenante et on s’attache assez peu aux personnages. Le Meilleur des mondes ne marquera ni pour son histoire, ni pour le peu d’émotions qu’il véhicule, mais pour son fond, ce qui me pousse à ne pas dépasser 7/10. Mais bien qu’elle puisse s’avérer fastidieuse, la lecture est véritablement digne d’intérêt. Et même si vous en sortirez quelque peu pessimistes, on pourra se consoler en songeant qu’il y aura toujours quelque part un Bernard Marx, un Helmholtz Watson, un être qui ne soit pas totalement déshumanisé.