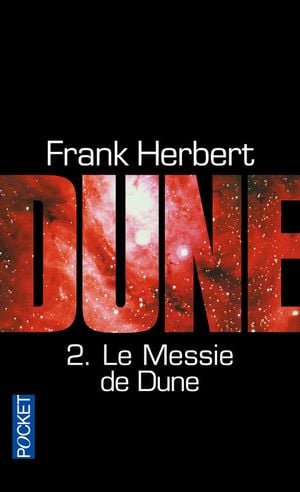Il y a quelque chose de pourri au royaume d'Arrakis...
Avec Dune, Frank Herbert avait pris soin d'ériger une figure messianique, celle de Paul Atréides, Empereur-Dieu de Dune, la planète recelant du précieux Mélange. Douze années plus tard, Paul Muad'Dib règne sur un gigantesque empire, après que les confins de l'espace aient été ravagés par une croisade religieuse menée en son nom par les Fremen indomptés, natifs de la planète désertique.
Après avoir donc pris le lecteur à témoin dans ce processus de déification de son héros via un imbroglio géopolitique mémorable, Herbert va s'employer à le déconstruire. Prisonnier de sa stature divine, incapable de se soustraire au déterminisme historique qu'il aperçoit dans ses visions prescientes, Paul Muad'Dib, amer, aspire à solder son échec dans la solitude.
Ce deuxième tome parvient toujours à proposer un scénario ciselé et sinueux, fondé sur le thème classique de la conspiration, ici rendu digne d'intérêt par la subtilité de ses tenants, à la fois mystiques (le captivant Bene Tleilax), philosophiques et géopolitiques. Mais le tout prend l'allure d'un huit-clos oppressant qui n'a malheureusement pas l'envergure vertigineuse du premier volume, qui déployait un univers à la richesse insoupçonnée par le seul biais de ses personnages, et de sa planète austère à l'écologie fascinante.
Ici, l'introspection devient étouffante : voulant communiquer au lecteur l'isolement de son monarque tourmenté, Herbert finit par ériger un mur entre ce dernier et son lecteur, qu'il perd dans des divagations ésotériques fastidieuses, en dépit de quelques propositions iconoclastes sur la nature de l'Homme, son rapport à l'histoire et au divin. Tout le matériau narratif a du reste bien du mal à se déployer convenablement au cours d'un récit aussi bref, ce qui sape les enjeux dramatiques et rend l'intrigue atone.
On comprend sans mal que Herbert n'ait pas voulu grandir davantage une figure qu'il a mythifié pour mieux la déconstruire. Mais en voulant insuffler ce principe fataliste de la désillusion à son récit, Herbert semble avoir confondu la substance et la matière, puisqu'il en résulte un roman qui produit le même effet.