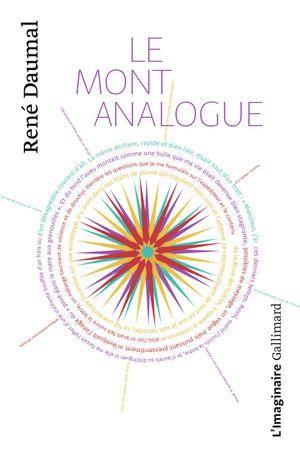Tout se tient dans cette œuvre pourtant inachevée, notamment par la force d’un humour mélancolique que je retrouve chez de rares auteurs, pour ne pas dire des auteurs rares – Vialatte, par exemple.
Dans le premier paragraphe du Mont Analogue figure l’image d’une bulle remontant à la surface d’une eau stagnante. Et l’inachèvement du roman le fait ressembler à un bain qui resterait à la température idéale jusqu’à ce que les sonneries prolongées du téléphone fixe nous obligent à en sortir. (Je parle donc d’un bain de l’époque.) Un bain parfumé à l’intelligence.
Il émane de ce récit, comme de plus d’une œuvre embaumant à ce point l’intelligence, une extraordinaire impression de facilité : tout a l’air d’y couler, les mots, les phrases, les paragraphes, les chapitres… – les idées. Et pour cause, Le Mont Analogue regorge de merveilles d’orfèvrerie stylistique : quand je lis « La nuit se tassait encore autour de nous, au bas des sapins dont les cimes traçaient leur haute écriture sur le ciel déjà de perle ; puis, bas entre les troncs, des rougeurs s’allumèrent, et plusieurs d’entre nous virent s’ouvrir au ciel le bleu lavé des yeux de leurs grand-mères. » (début du chapitre 5), je deviens comme le narrateur, je me dis que « Je n’arrive pas à rendre cette impression d’une chose à la fois tout à fait extraordinaire et tout à fait évidente, cette vitesse ahurissante de déjà-vu… » (chap. 4, p. 109-110 en collection « L’Imaginaire »).
Le Mont Analogue, c’est donc de la très bonne prose poétique qui, comme telle, se donne le langage pour objet. C’est à un dénommé père Sogol qu’échoit la tâche de guider les siens : comme le narrateur semble charitable, il précise, à l’intention du lecteur qui ne s’en serait pas aperçu seul, que Sogol est l’anagramme de logos. (Et comme aujourd’hui je suis moins porté sur l’empathie, je laisserai à l’éventuel lecteur de cette critique de soin de rechercher les divers sens de ce mot grec.)
Le Mont Analogue est donc aussi un roman philosophique.
Le Mont Analogue est encore – et avant tout ? – un roman d’aventures, celles-ci fussent-elles « alpines, non euclidiennes et symboliquement authentiques » (sous-titre). L’alpinisme, ici, n’est pas qu’une métaphore de la philosophie au sens brut – voir l’évocation de cette « “école allemande” » (chap. 2, p. 55) et l’inénarrable extrait de la lettre de Benito Cicoria (p. 77-78). Il n’est pas non plus seulement « l’accomplissement d’un savoir dans une action », c’est-à-dire l’art, qui consiste en l’occurrence à « parcourir les montagnes en affrontant les plus grands dangers avec la plus grande prudence » (fragments en annexe, p. 161). C’est simplement un ressort narratif, quelque chose qui fait avancer l’intrigue, au même titre que la navigation à laquelle se livre les personnages – et qui n’est pas sans rappeler celles d’Arthur Gordon Pym ou du docteur Faustroll.