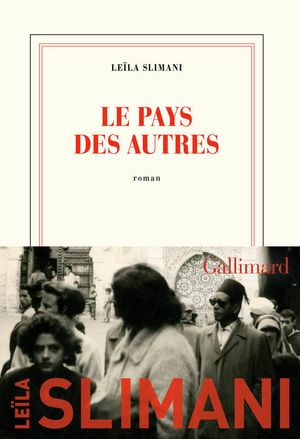Leïla Slimani est la lauréate du Prix Goncourt 2016 pour « Chanson douce », récit cruel, sec jusqu'à l'os, du meurtre de deux enfants par la nounou d'un jeune couple parisien mixte et dans le vent.
« Le Pays des autres » est le premier volume d'une saga annoncée, qui en comportera trois, sur l'installation au Maroc d'une jeune Alsacienne , Mathilde, partie rejoindre en 1947 Amine, combattant marocain de l'armée de Libération dont elle était tombée amoureuse durant la guerre. Nous sommes non loin de Meknès, dans une grande ferme de terres arides où pas grand chose ne pousse. C'est un peu Jean-de-Florette au bled !
Le « pays des autres », c'est, pour Mathilde, ce pays qui lui est étranger et dont elle cherche à se faire apprivoiser en apprenant l'arabe et le berbère pour comprendre ce que raconte sa belle-mère dans la cuisine, une cuisine dont on la chasse (« Ce n'était pas la place d'une Européenne capable de lire les journaux et de tourner les pages d'un roman »). Mais le pays des autres, c'est aussi, et surtout, pour une femme, un monde d'hommes où « Dieu et l'honneur se confondent ».
Le Maroc, c'est également le pays des autres pour son mari, Amine, qui a combattu pour la France et épousé une française, alors que l''indépendance déjà gronde, et se trouve déchiré entre l'aspiration « d'aimer de tout cœur son dieu, sa langue et sa terre » et l'amour et l'admiration intègres, mais non sans tensions, pour sa femme qu'il suspecte de l'en éloigner.
Le pays des autres, ce sera aussi celui de leurs enfants Salim et Aïcha, Aïcha qui est la véritable héroïne de ce premier volume et qui sera la passeuse de cette généalogie. Les enfants, « fruits dégoûtants de cette union », scolarisés chez les bonnes sœurs mais moqués par les fils de colons, vivant à la ferme, loin de la ville, et dont le destin illustrera davantage les épreuves de l'acculturation que le bonheur, damné – selon l'auteure-, du métissage, qui est le thème du livre.
« Le pays des autres, c'est aussi une série de personnages : Selma, la sœur d'Amine, figure de l'affranchie, de la révoltée ; Omar, le combattant clandestin ; Mourad, l'homme-lige d'Amine, son ancien ordonnance dont il fait son fermier puis son beau-frère pour lui épargner les tentations ; Mademoiselle Fabre, généreuse excentrique parfaitement intégrée, mi-écrivain public mi-professeur particulier des filles d'indigènes, comme on dit alors ; Roger Mariani, le fermier voisin qui n'a pour seule règle que de faire suer le burnous de ses ouvriers mais qui respecte Amine ; les Palosi, le couple du docteur que Mathilde consulte pour mieux organiser le dispensaire qu'elle a installé dans sa ferme.
Une vasque fresque de l'outre -méditerranée des années 50 qui fait songer quelquefois à « Vaincue par la brousse » de Doris Lessing.
Mais on retrouve surtout la Leila Slimani de « Chanson douce » : justesse des situations, profonde empathie à l'égard des personnages quels qu'ils soient et quoiqu'ils fassent, cruauté du trait- toujours.
Une sismographie sans complaisance de la confrontation des moeurs, des mentalités et des fracas de l'Histoire qui déjà s'agite dans le protectorat. (La guerre d'Algérie a tant saturé nos mémoires, que ce que nous apprenons des prémices violentes de l'indépendance marocaine est passionnant).
Le tout, brillamment mené, avec un détachement apparent, déchiré de trouées à l'acide, et un ton aigre-doux dont la dissonance ne nous laisse jamais en repos.
Leïla Slimani porte très haut, en littérature, l'Ecole naturaliste. Qui aime Michel Houellebecq, Emile Zola ou la cause des femmes doit vite la lire.