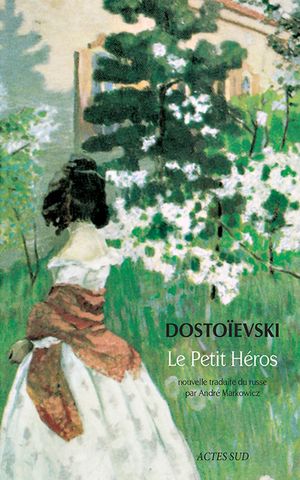Il est hautement significatif que l’écrivain Dostoïevski, venant d’être arrêté et enfermé pour complot politique, se soit décidé à replonger en enfance dès que l’occasion d’écrire lui a été rendue. Au moment où les tribulations politiques ont raison de lui, l’écrivain mystifie le monde adulte en sublimant une enfance du profond ressenti, de l’émotion acerbe : de la sincérité.
Dès cette époque, la plume du jeune écrivain effleure le papier en creusant de sa manière si singulière dans des psychologies profondes. Au sein d’un monde adulte frivole, qui se meut au gré de cérémonies et autres expéditions divertissantes, l’enfance fait figure de sérieux et de pénétration.
L’enfance, ici, s'incarne avec un petit garçon de onze ans, pris dans cette transition bouleversante qu’est la puberté et que traduit un sentiment prononcé de pudeur. Un été dans la grande villa d’un parent proche, T-ov, lequel ne jure que par le divertissement et invite les plus belles dames de Moscou, sera le cadre de mise à l’épreuve de cette puberté balbutiante quoique irréversible. Une jeune et somptueuse blonde ne tarde pas, d’ailleurs, à submerger l’enfant de ses moqueries, tours et espiègleries. Ce dernier, en lequel la première enfance se meurt, est humilié de ces manifestations outrancières d’infantilisation. Dès lors, faut-il s’étonner que l’enfant-transitoire s’éprenne, sans comprendre tout ce qui le traverse et tout ce qu’il ressent, de la seule jeune femme qui détonne dans ce théâtre des apparences ? Devant la beauté brune et froide d’une femme mariée, Mme M., à la fois douce, bienveillante, et au combien altière, – devant cette beauté, mais en face de ce regard surtout –, l’enfant s’humilie. Mais c’est bien un abysse qui mesure les deux humiliations éprouvées, celle provoquée par des cœurs étrangers (dont la charmante blonde que nous évoquions) figeant exprès une enfance pour en tirer le profit de l’amusement, et l’autre quand le cœur tend à l’adulte et s’humilie d’amour. D’ailleurs, seule cette dernière humiliation saurait avoir une teneur proprement esthétique, et Dostoïevski rend magnifiquement compte du trouble profond causé par une première « passion », trouble d’autant plus bouleversant qu’il ne peut encore être pleinement qualifié. Tels sont l’indiscernable et l’indicible qui s’ouvrent au premier sentiment amoureux. Ici plus qu’ailleurs, l’être se découvre en se vivant, la vie se fait impressions et pressentiments.
Bientôt, quand notre blonde jouera des deux humiliations à la fois, en mettant l’enfant au défi de monter un cheval fou devant Mme M., la réaction de l’enfant sera spectaculaire, héroïque, et bien sûr complètement inattendue de ceux qui ne connaissent plus l’enfance en ses passions décisives, en ses mouvements spontanés, en son courage pur et vif, en sa fierté déployée qui s’oppose à l’orgueil ramassé sur soi. Ce cheval que personne n’osait monter, l’enfant l’enfourche, et résiste à ses cambrures avant d’être secouru. Redescendu, l’enfant regarde instinctivement Mme M. avec l’intensité inouïe d’un amour s’extériorisant en honte. Ce regard, volé par les adultes, est bien près d’être prétexte à un rire général. Mais notre blonde elle-même, d’inclination romantique, ne l’entend plus de même et s’emploie à ce que tous tiennent le petit héros et sa chevalerie en estime. Pour la première fois, elle vient de saisir, – par le regard évoqué autant que par le défi relevé –, cet enfant rougi de pudeur dans l’un des aspects brûlants de son authenticité. Aussi prévient-elle, dans une formule que l’on donnerait volontiers en épigraphe à l’enfance saisie par l’écrivain : « Mais c’est très sérieux, messieurs, ne riez pas ! ».