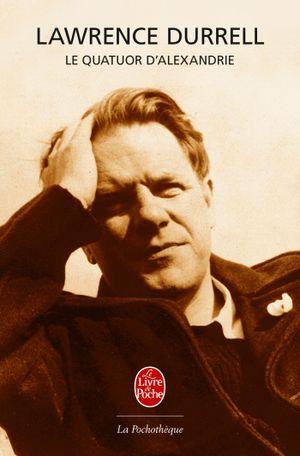« Alexandrie, rosée du matin, duvet de nuages blancs, croisement des rayons lavés à l’eau du ciel, cœur des souvenirs trempés de miel et de larmes. » Naguib Mahfouz, Miramar.
A peine arrivé pour une poignée de mois à Alexandrie, je découvrais cette œuvre colossale, dont le nom entendu pour la première fois – Quatuor d’Alexandrie – sonnait si bien et promettait une belle musique. Et bien que certains la trouvent trop « sucrée », ou que des Alexandrins reprochent à l’auteur d’avoir arraché une Alexandrie de ses rêves et de ses fantasmes, il s’agit d’un hommage inégalé à la ville. Car c’est elle qui en est le personnage principal, avec son ciel bleu couvrant les destins de ses marionnettes ; une ville où, avant Nasser, les Égyptiens, les Grecs, les Italiens, les Levantins, les Français ou les Anglais se côtoyaient, à la charnière des mondes.
Et pourtant… Lawrence Durrell, cet « Irlandais méditerranéen » né dans les Indes britanniques, écrivait à Henry Miller, en 44 :
Je ne crois pas que la ville vous plairait, d’abord à cause de cette platitude moite – pas une seule colline, pas le moindre tertre – bourré à craquer d’ossements et des dépôts successifs de cultures effacées. Et puis cette ville démolie, cette ville napolitaine lépreuse, avec ses amas de maisons levantines qui perdent leur peau au soleil. Une mer plate, d’un brun sale, sans vagues, qui gratte les rebords des quais. […] Non, vraiment, si l’on pouvait écrire une seule ligne qui ait une odeur humaine, on serait un génie…
Et pourtant… Alexandrie devient sous sa plume « le grand pressoir de l’amour », Reine et Catin, où les amants tournent de bras en bras, où les vrais amoureux souffrent ; une ville de laquelle personne ne réchappe – à part les malades, les solitaires, les prophètes – et qui vous suit jusqu’au bout du monde. Car c’est sur une île perdue dans l’Égée que le narrateur, Darley, revient sur son séjour, « afin de rebâtir pierre par pierre cette ville » dans sa tête, avec sa galerie de portraits peints : Justine, la juive espiègle et princesse des bals ; le « Prince » Nessim, copte fier et financier richissime ; Cléa la peintre et la douceur ; Pursewarden le génie insondable ; Mélissa l’abandonnée, et tant d’autres…
Alors qu’est-ce donc, que ce Quatuor ? Comme un concert de jazz. Des musiciens proposant une partition pour jouer un même morceau.
Tout commence avec Justine. Darley épluche quelques documents, sa mémoire et son cœur pour extraire une vérité sur son histoire, là-bas, et l’écrire dans la solitude de l’artiste. Prose léchée par une poésie du souvenir, multicolore mais à la forme décousue, où restent en suspens un tas de questions sans réponses.
Puis vient Balthazar. Balthazar, médecin touchant à l’ésotérisme – il a un nom de mage – renvoie à Darley son manuscrit de Justine barbouillé d’annotations, pour lui exposer ainsi sa vision des mêmes évènements. Dès lors les personnages prennent un autre visage – ou le nouveau visage s’ajoute-t-il à l’ancien, comme sur une toile de Picasso ? – les relations entre eux prennent une autre nature, les fragiles certitudes s’effondrent, la vérité se voit dépouillée d’un peu de ses masques, et l’œil de Darley, comme celui du lecteur, s’aiguise.
Enfin, Mountolive, c’est le roman de l’intrigue politique, dans lequel un diplomate anglais aspire à retrouver l’Égypte, à retrouver Alexandrie, pour retrouver en elle un temps de sa vie et de ses amours. Capitale du cœur, capitale de la Mémoire. Avec ce troisième tome, les derniers points d’ombre se dévoilent, les liens souterrains se rejoignent, l’œuvre s’unifie, et libre à nous, dans une relecture, d’arpenter ce vaste réseau.
Quelque temps plus tard, sous les feux rutilants de la seconde guerre mondiale, Darley revient dans la vieille cité. C’est Cléa ou l’épilogue. Le temps avance enfin, même à Alexandrie – où il semblait figé – et des pages douces et amères, un brin mélancoliques, peignent à nouveau ces personnages connus jadis. Ils ont changé bien sûr, et ils changeront. Dans le Quatuor, rien n’est jamais définitif en somme ; tout est en perpétuel mouvement, même le passé. Et un nouveau passé recouvre le passé. Une fois disséqué et légué au manuscrit – car « c’est dans l’exercice de son art que l’artiste trouve un heureux compromis avec tout ce qui l’a blessé ou vaincu dans la vie quotidienne… » – l’avenir peut enfin se présenter.
Lawrence Durrell redonne ses lettres de noblesse à une écriture romantique, voire très baroque, foisonnant de mots recherchés, de puissantes métaphores et de comparaisons grandiloquentes (parfois un peu trop, mais si l’on aime…) ; un style chargé de poésie, d’érudition, dont la traduction française de Roger Giroux est un immense abreuvoir pour ceux à qui plaît une littérature qu’on pourrait croire – mais on ne le veut pas – dépassée.
Oui, un jour je me suis surpris à écrire, d’une main tremblante, les quatre mots que tous les conteurs de la Terre prononcent depuis le commencement du monde pour réclamer l’attention de leur auditoire. Des mots qui annoncent simplement qu’un artiste est entré dans sa maturité. J’écrivis : « Il était une fois… »
Un livre à lire, au moins deux fois.