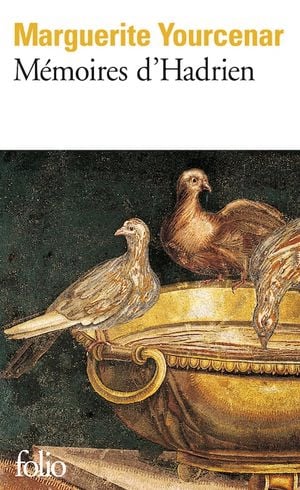« Il est des livres qu'on ne doit pas oser avant d'avoir dépassé quarante ans. » disait Margueritte Yourcenar, à propos des Mémoires d’Hadrien.
C’est le livre de la maturité, de la personne accomplie, de la dépersonnalisation d’une femme du XXe siècle pour devenir empereur romain du IIe. Car ce qui coule dans ces pages, ce sont bien les dernières gouttes d’encre, adressées à Marc-Aurèle, les derniers mots d’un maitre du monde, à ce moment de lucidité que nous donnerait l’approche de la mort, où tous les calculs d’intérêts sont vains, pour enfin voir sa vie face-à-face ; les derniers mots d’un homme seul face au papier et à la profonde introspection que cela appelle. Cette longue prose n’est autre qu’un bilan, un adieu, son chant du cygne. Les années et les années qui composent cette vie paraissent se contracter dans une seule note, un seul ton : celui d’une mélancolie douce-amère où s’entrelacent les joies et les débâcles, le printemps et l’hiver. Un grand Tout construit par des actes longuement mûris, des coups d’éclat et les caprices du hasard, un Tout fait de bribes détachées auquel Hadrien désespère de trouver un sens :
Je m’efforce de reparcourir ma vie pour y trouver un plan, y suivre une veine de plomb ou d’or, ou l’écoulement d’une rivière souterraine, mais ce plan tout factice n’est qu’un trompe-l’œil du souvenir. De temps en temps, dans une rencontre, un présage, une suite définie d’événements, je crois reconnaître une fatalité, mais trop de routes ne mènent nulle part, trop de sommes ne s’additionnent pas…
On s’imagine un vieil homme allongé sur un lit richement orné de sa Villa de Tibur, en train de considérer son héritage au monde : architecte de la paix – autant qu’il a été possible – qui a consacré son principat à éteindre les feux allumés aux quatre coins par des siècles de conquêtes ; bâtisseur de mémoire, en édifiant de l’Occident au lointain Orient des temples, des palais, des sépultures, des villes à son nom, afin que son œuvre et lui-même soient immortels ; voyageur aussi, qui a passé douze ans de son règne – car il en fallait bien tant pour visiter l’empire – à écumer les régions les plus reculées : de la Bretagne, entourée d’un océan sans sommeil, jusqu’aux brûlantes colonnes de Palmyre ; jusqu’à ces coins de l’Asie dont les noms sont prononcés comme des légendes par ces marchands venus d’ailleurs, et qu’on ne veut jamais croire ; jusqu’à cette Égypte millénaire sur laquelle le temps ne semble pas avoir prise ; à Athènes, cent fois ; au sommet des Pyrénées, contemplant l’aurore irisée, et sur ce volcan sicilien, d’où l’espace terrestre et marin s’ouvre au regard jusqu’à l’Afrique visible et la Grèce devinée. A la fois partout et nulle part : un Ulysse sans d’autre Ithaque qu’intérieure.
Mais l’être humain ressort toujours de sous la pourpre : « il me semble à peine essentiel, au moment où j'écris ceci, d'avoir été empereur ». Beaucoup de ses souvenirs vont à un jeune pâtre de Bithynie qui n’a compté pour rien dans l’histoire du monde… Mais les portraits, les statues, les monuments consacrés à cet éphèbe abondent pour la seule raison qu’il a été aimé. Trajan pleurait pour n’avoir pas conquis la terre entière ; Hadrien pleure Antinoüs, l’amour de sa vie, suicidé sur les berges du Nil, sacrifié dans la fleur de l’âge à cet empereur qui se sentait dieu, et qui comprend combien le bonheur – cet éphémère – est fragile :
Tout bonheur est un chef-d’œuvre : la moindre erreur le fausse, la moindre hésitation l'altère, la moindre lourdeur le dépare, la moindre sottise l'abêtit.
Ce long procès de soi-même se termine par l’évocation d’une vieillesse impossible ; impossible quand on a foulé des sols de toutes les couleurs ; et douloureuse quand, rien qu’à la pensée des marches de l’Acropole, on suffoque… Puis vient l’heure de la méditation sur la mort, de la résignation : l’heure d’accepter de n’être qu’un souffle qui n’aura fait que passer…
Terminons par un dernier voyage :
La route du retour traversait l’Archipel ; pour la dernière fois sans doute de ma vie, j’assistais aux bonds des dauphins dans l’eau bleue ; j’observais, sans songer désormais à en tirer des présages, le long vol régulier des oiseaux migrateurs, qui parfois, pour se reposer, s’abattent amicalement sur le pont du navire ; je goûtais cette odeur de sel et de soleil sur la peau humaine, ce parfum de lentisque et de térébinthe des îles où l’on voudrait vivre, et où l’on sait d’avance qu’on ne s’arrêtera pas. Diotime a reçu cette parfaite instruction littéraire qu’on donne souvent, pour accroître encore leur valeur, aux jeunes esclaves doués des grâces du corps ; au crépuscule, couché à l’arrière, sous un tendelet de pourpre, je l’écoutais me lire des poètes de son pays, jusqu’à ce que la nuit effaçât également les lignes qui décrivent l’incertitude tragique de la vie humaine, et celles qui parlent de colombes, de couronnes de roses, et de bouches baisées. Une haleine humide s’exhalait de la mer ; les étoiles montaient une à une à leur place assignée ; le navire penché par le vent filait vers l’Occident où s’éraillait encore une dernière bande rouge ; un sillage phosphorescent s’étirait derrière nous, bientôt recouvert par les masses noires des vagues. Je me disais que seules deux affaires importantes m’attendaient à Rome ; l’une était le choix de mon successeur, qui intéressait tout l’empire ; l’autre était ma mort, et ne concernait que moi.