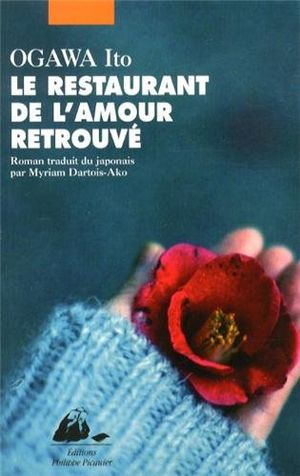Il y a deux romans dans le très bancal projet que constitue Le Restaurant de l'amour retrouvé mais les deux me paraissent répréhensibles, pour des raisons toutefois différentes.
Sur les trois quarts ou peut-être les quatre cinquièmes de son intrigue, le Restaurant ressemble à ce que je connaissais déjà d'Ogawa Ito et que j'abhorre particulièrement dans une manière que le milieu du livre a de vendre l'Orient, et surtout le Japon, en Occident. Il s'agit de toute cette frange d'une littérature cosy qui se plaira à mettre en scène comme personnage principal une trentenaire paumée, qui souvent se retire de la ville pour se consacrer avec minimalisme à une activité traditionnelle qui sera exhibée de façon sémiologique dans le détail de ses petits gestes : vous pouvez faire ça avec l'ornithologie, avec la calligraphie, avec la cuisine, avec le travail du tissu, peu importe, la recette demeurera inchangée. L'héroïne de ce roman invariable se réalisera systématiquement de la même façon dans un petit travail artisanal qui lui permettra de se reconnecter à un monde modeste mais vivant, à grandes louches de truismes sur la banale beauté du quotidien.
Je déteste cette littérature pour l'hypocrisie crasse avec laquelle elle vend un mode de vie en apparence décroissant à destination en réalité uniquement d'un public d'urbains snobinards qui se déteste, mais qui a envie de croire à cet ailleurs essentialiste et dépouillé qui n'existe pas, parce qu'il est socialement et économiquement inepte. Je déteste cette littérature qui vise constamment la femme en essayant de la ramener à un idéal de réalisation sentimentaliste, ne pouvant s'exprimer que par un travail d'aiguille fondamentalement arriéré. Je déteste l'envie qu'on a de nous étaler un meme Marie Kondo sur deux cent ou trois cent pages globalement, en remobilisant des esthétiques aseptisées puantes comme le food porn largement convoqué ici. Certains se rappelleront qu'on nous avait tenté le coup il y a une quinzaine / vingtaine d'années avec le même type de soupe britannique, mais parfumé à la fleur de cerisier cette saloperie connaît une nouvelle vie tout à fait consternante que ne semble menacer dans son hégémonie affreuse que les très cousins romans de chats.
Aux alentours de son dénouement, le Restaurant a par contre la spécificité de totalement déraper dans une espèce d'improbable mélo' sous crack qui en quelques pages, je vais spoiler, vous sortira de sa besace à conneries le cancer soudain, les secrets familiaux enfouis, l'amour d'enfance et la dévoration sacrificielle qu'on avait pour le coup senti arriver trente mille caractères avant à peu près. C'est surprenant, mais comme n'importe quel départ en couilles peut l'être. Conclure une intrigue, ça n'est pas ça.
__________
Au fond, que les maisons d'édition en France – et probablement ailleurs – éprouvent le désir de vendre une image du Japon, comme on l'a fait avec les pays scandinaves un moment, comme une sorte de grand magasin de design où le méta-discours que l'on tient sur l'objet se substitue à lui, je m'en branle ; grand bien leur en fasse, ce pays a été plus mal vendu chez nous et largement dans ma génération de mongolos nourris à Naruto.
Le problème, c'est qu'on vend derrière cette image en papier glacé un mode de consommation et d'appréhension du monde qui est celui de la pire bourgeoisie de la culture ; et c'est une manière d'intégralement vassaliser le beau.
Donc allez vous faire foutre.