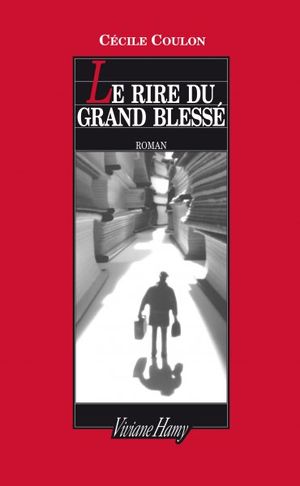Pas si facile de lire ce récit en s’efforçant de ne pas tenir compte du micro-battage qui entoure son auteur — sa jeunesse, cinq ou six romans, etc. — : on a tôt fait de prêter à un écrivain des ambitions qu’il n’a jamais eues. Le Rire du grand blessé (ou peut-être du Grand blessé) marche sur les plates-bandes de l’anticipation de haut niveau — Fahrenheit 451, Des fleurs pour Algernon, 1984, tout le bazar. Le pari est d’autant plus risqué qu’il n’y a dans l’histoire aucune maison d’édition ou collection spécialisée dans ce que ceux qui ignorent ce qu’est l’imaginaire appellent « littératures de l’imaginaire ».
Premier constat : sans être mal écrit, ce court roman n’a rien d’un choc stylistique. Et certains passages au parfum de cliché et de maladresse embarrassent. « J’avais signé le contrat du bonheur, à une seule condition : interdiction formelle d’apprendre à lire » (p. 9) : si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire non plus, et tu ne peux rien signer ; ou alors ce n’est pas un contrat.
D’une manière générale, le Rire du grand blessé sent la retenue, l’absence d’audace. La narration fait quelques clins d’œil au lecteur, comme pour dire : « Voyez, je suis de votre côté, je suis un livre à la gloire des livres, j’ai peur pour la Culture, pour notre Culture, et si je pouvais voter je voterais centre-gauche. » Mais ça s’arrête là. Il y a quelques trouvailles — 1075 l’ambigu, le phénomène des Manifestations à Haut Risque, le sort des campagnes — dont une dystopie intéressante aurait fait son cœur, et que le roman de Cécile Coulon se contente d’esquisser, moins pour solliciter le lecteur que par manque de prise de risque.