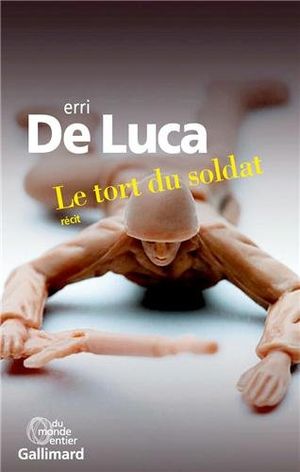Deux destins vont se nouer dans ce court roman de l’écrivain italien Erri de Luca, deux voix singulières, proférées par deux narrateurs successifs. Deux « je », le premier masculin, le second féminin, ignorant tout l’un de l’autre, si ce n’est ce qui peut s’observer lors d’une brève rencontre à la terrasse d’un café. Et pourtant, l’interaction sera radicale et ce croisement fugitif aura l’effet d’une déflagration sur l’une des deux trajectoires, les nouant ainsi intimement l’une à l’autre.
L’écriture d’Erri de Luca est claire, limpide, en apparence sans mystère. Les vingt-quatre premières pages de l’édition Folio, dans la traduction de Danièle Valin, donnent la parole à un écrivain, traducteur de yiddish, qui aime, l’été venu, s’isoler dans les Dolomites, pour y travailler et s’adonner à l’escalade, déplaçant son corps « sur la page ouverte de la roche. [...] mais le corps n’écrit pas dessus, et ne laisse aucune trace sur la surface traversée » (p. 25).
Les cinquante pages qui composent la seconde partie du roman font entendre la voix d’une femme que l’on imagine entre deux âges mais qui se dépeint, malgré ses diverses expériences auprès des hommes, comme une « femme qui se fane déjà alors qu’elle est encore intacte » (p. 79). Son père est un ancien nazi, en fuite et perpétuellement caché, depuis l’Argentine jusqu’à son propre pays, et vivant sous des identités d’emprunt. Elle a choisi de rester auprès de lui depuis que sa mère a abandonné la fragile cellule familiale. Erri de Luca choisit d’associer cette écriture supposée féminine à l’hésitation et à l’excuse, puisque cette narratrice n’en finit pas de ponctuer certaines chutes de paragraphes d’une phrase lancinante : « Je m’excuse de la digression »...
Le titre du roman est éclairé avec insistance dans cette seconde partie, puisqu’il reprend une parole scandée par le père lui-même : « ´Mon tort a été d’être battu. C’est la pure vérité.’ », p. 39 ; « ‘Le tort du soldat est la défaite. La victoire justifie tout. ‘», p. 46. Obsédé par l’histoire passée et par « l’échec du nazisme », cet homme va, une fois venue sa retraite officielle, jusqu’à se pencher sur la kabbale juive. Convaincu de « l’erreur d’une persécution superficielle » (p. 51), il « voulait s’expliquer l’échec du nazisme : il s’était appliqué à détruire un peuple, il s’était acharné sur les corps, au lieu de se concentrer sur le centre de sa cible » (p. 50) : « Il se persuada que le judaïsme était retranché dans le labyrinthe de la kabbale » (p. 49). Mais cette étude acharnée, cette poursuite d’un combat obsolète à travers l’interprétation forcenée des lettres et des nombres conduiront cet homme traqué non vers la lumière de la révélation, mais vers l’obscurcissement complet de son discernement.
Le finale, dans lequel les fins de chacune des deux parties se rejoignent, offre un démenti douloureux à l’explication officielle du titre. Se dégage ainsi le thème, jusqu’alors souterrain, de la culpabilité, en tant que conscience profondément enfouie, dissimulée avec application derrière les proclamations arrogantes. Et l’on mesure alors que « le tort du soldat », bien différent de ce que celui-ci revendiquait, a sans doute fini par se retourner contre lui et par avoir raison de l’ancien criminel de guerre, sous une forme inhabituelle d’ « auto-justice »...
On songe à l’impressionnant roman de Bernhard Schlink, « Le Liseur » (1995), qui explorait aussi avec beaucoup d’audace et de sensibilité le destin inconfortable d’anciens nazis, sans non plus inverser les étiquettes des bourreaux et des victimes, mais en questionnant opportunément le devenir de ceux qui sont désignés comme monstres aux yeux de la Terre entière, y compris des leurs propres. Dans le domaine cinématographique,
« Le Médecin de famille » (2013), de Lucia Puenzo, s’approche aussi de ces zones ambiguës, même si la question du vécu de culpabilité y est moins centrale. Concernant la figure du père restant prisonnier d’un passé traumatique, le très beau roman, « Mon père couleur de nuit » (2001), de Carl Friedman, détaille les cicatrices laissées par les camps dans la vie quotidienne d’un ancien déporté.
Dans cet écrit, Erri de Luca expose de manière terrible et implacable la façon dont le roman intérieur paranoïaque peut anéantir un homme, à plus forte raison s’il est alimenté par le ruisseau fielleux d’une culpabilité réelle.