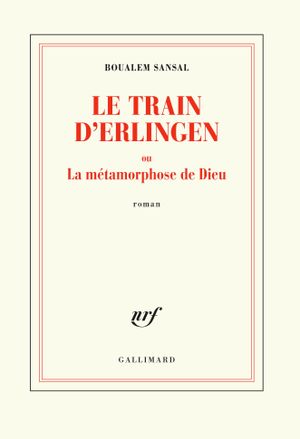Boualem Sansal est un écrivain algérien qui a vu son cher pays, en une vingtaine d'années, basculer dans l'islamisme le plus belliqueux, et fait partie de ces "esprits inquiets" - pour reprendre l'expression de la quatrième de couverture - observant attentivement, avec désespoir, la diffusion de l'idéologie islamiste à travers les démocraties européennes. En France, il s'est révélé à un large public en 2015, avec son roman 2084 (grand prix du roman de l'Académie français ; un 1984 religieux que j'avais trouvé assez aride et abscons), fatalement propulsé au-devant de la scène littéraire par les événements tragiques de son année de publication.
Son dernier ouvrage, Le Train d'Erlingen ou la métamorphose de Dieu, est à mi-chemin entre un roman et un essai. Il est divisé en deux parties : "la réalité de la métamorphose" et "la métamorphose de la réalité", constituées, pour une construction originale, de lettres, de chapitres écrits à quatre mains, de notes de lecture... comme un fatras de documents qui, en définitive, forme un seul texte des plus cohérents.
Le pitch, simplifié au maximum, est très bien formulé sur la quatrième de couverture que je me permets donc de reprendre paresseusement pour ma critique : "Ute Von Erbert raconte à sa fille la vie dans Erlingen assiégée par un ennemi dont on ignore à peu près tout et qu’elle appelle «les Serviteurs», car ils ont décidé de faire de la soumission à leur dieu la loi unique de l’humanité. La population attend fiévreusement un train qui doit l’évacuer. Mais le train du salut n’arrive pas."
Le style est assez difficile ; libre, changeant et savant ; et le côté "essai" se fait ressentir par des réflexions précises filées tout le long du livre (notamment cette idée de métamorphose à grande échelle) et s'appuyant souvent sur un corpus d'œuvres défini (Kafka, Thoreau, Buzzati...). Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Le Train d'Erlingen dresse un constat alarmant sur l'état de l'Occident.
Dans la vision de Boualem Sansal, l'Europe est envahie par les "Serviteurs", c'est-à-dire les extrémistes religieux, et plus particulièrement, comme nous allons le voir par la suite, les islamistes. Il décortique, alors même que la situation a atteint un point de non-retour, notre naïveté ; la prudence excessive et inutile - en un mot : la veulerie - des gouvernements ; les conséquences d'un capitalisme mondialisé, incontrôlable comme un train fou, à la fois générateur de malaises et dangereusement soporifique ; la "migration des idéologies" ; et attaque, ce qui n'est jamais de trop, les religions en général, estimant que les hommes ont tout en main pour poursuivre leur chemin sans elles.
Mais plus nous avançons dans le roman, mieux Boualem Sansal règle la focale. J'ai eu l'impression qu'il cherchait à donner la main à son lecteur pour l'aider à émerger du flou progressivement, et ainsi passer de cette image universelle des "Serviteurs" à celle, contemporaine, des islamistes. Et comme en témoigne l'effet miroir des titres des deux parties du roman (effet avec lequel il joue sans cesse), la projection de Sansal n'a rien d'une anticipation. Elle est, à son sens, un reflet de notre réalité.
Enfin, j'aimerais terminer rapidement cette modeste critique sur deux remarques. La première, que les intellectuels algériens sont une formidable clé pour comprendre ce à quoi nous nous confrontons ; la seconde, que ce livre est possiblement fondamental pour la littérature francophone du XXIème siècle.