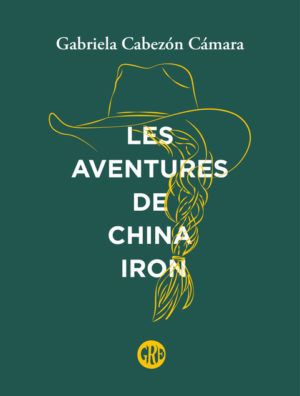La fin d’après-midi sur l’autoroute est le pire moment du voyage : levé•es à la fraîche et promptement enfermé•es dans l’habitacle, nous souffrions des torrents de chaleur qui se déversaient sur la carcasse de métal de la voiture depuis déjà bien trop d’heures quand le soleil a passé son nez sous le toit et a commencé à nous inonder de ses rayons ardents. Suée immédiate. Donc le rituel : sortir le pare-soleil chiffonné de la poche dorsale du siège conducteur et le caler, le recaler, le décaler, le caler à nouveau et encore jusqu’à ce qu’il soit à la position optimale, le tout ponctué de moult bruits de succion parfaitement dégueulasses : une purge auditive qui provoquent d’intenses grimaces chez ma copine – dont je ne me suis jamais lassé•e.
Et puis la route opère un virage et là, c’est le drame : l’astre honni se retrouve pile en face de nous. Évidemment, on ne peut pas caler un pare-soleil Dora l’exploratrice sur le pare-brise (j’ai demandé (plusieurs fois)) parce que soi-disant ça gênerait la visibilité et que Clara aurait pas trop envie de nous planter. Foutaises, ma copine est la meilleure conductrice que je connais (après, dans l’ordre : ma mère et ma sœur, mais avant mon père, nerveux notoire) et je suis persuadé•e qu’elle sait conduire les yeux fermés et sur du verglas.
Donc, après m’être régalé•e de ses mimiques d’écœurement, je profite de la diversion pour changer de CD (concerts de protestations véhémentes, je réplique par un « mais chaton, je veux bien te laisser choisir la musique, mais il faudrait que tu lâches le volant pour ça… » parfaitement mielleux et elle me boude en retour). Les décibels font immédiatement trembler les vitres et un sourire satisfait (et un peu cruel) se dessine sur mon visage. Je laisse passer quelques minutes (une chanson et demie) et finis par déposer un bisou sur son épaule brunie par le soleil et ma main sur sa cuisse. Clara ronronne presque.
Nous avons tourné à nouveau et le soleil est dans notre dos, libérant pour quelques kilomètres notre peau que les rayons solaires dévoraient avec ardeur. Nous sommes en plein dans l’heure orangée qui annonce le soir, et les collines nappées de pins s’enflamment, couvertes qu’elles sont par cette couette semblable à une écorce d’orange. Le sol sablonneux se transforme en rivière ambrée et chaque voiture que nous croisons se mue en comète étincelante. Envie d’ouvrir la fenêtre et de m’alanguir au milieu des épines qui piquèteraient ma peau, et l’odeur de résine se faufilerait dans mes narines ; un nuage esseulé me couvrirait parfois de son ombre bleutée et, toutes proches mais néanmoins invisibles (on pourrait croire que des millions de haut-parleurs ont été disposés par une organisation secrète pour cacher leur disparition), les cigales entameraient leur chant, et je m’élève dans ce tourbillon, enlevé•e comme naguère les enfants d’Hamelin, et de cimes en cimes, je bondis, m’accroche aux branches sèches, récolte pommes de pin pour les faire griller et virevolte, et le vent sifflera à mes oreilles parce qu’il faut bien créer ses propres bourrasques en canicule quand tout est appesanti, parce qu’il faut bien fulgurer quand tout est écrasé par le soleil, qui lui brille toujours égal à lui-même et même franchement indifférent à nos tracas d’humain•es piégé•es dans un four géant : alors je danserai à la brune quand il ne pourra pas me mater (l’horizon protecteur en allié) et sous mes pas cadencés, l’humus résonnera longtemps – cri de louve libre.
J’ouvre les yeux dans un sursaut (regard en coin de Clara, sourire tendre qui caresse mon ventre). Le disque est fini depuis longtemps et la nuit est tombée, et avec elle la fraîcheur relative et le calme. Ma partie préférée du voyage commence.
Nous arrivons bientôt.
*****
Ce texte présente ce que m’évoque Les Aventures de China Iron, livre lui-même hommage à Martín Fierro, dont le personnage éponyme apparaîtra d’ailleurs dans le roman de Gabriela Cabezón Cámara, sorti en France en 2022 et en 2017 en Argentine.
Nous y suivons China Iron et Liz qui voyagent à travers la pampa pour prendre possession d’un lopin de terre afin de l’exploiter. Les deux personnages finissent par se nouer d’amour au fil du trajet, une relation nécessairement vouée à l’éphémérité, puisque chacune risque de retrouver son mari au bout de la route.
Stylistiquement, je rapprocherai ce roman du modernisme, dans le sorte de flux de conscience fréquemment utilisé, mais aussi sa polytextualité et les nombreuses langues liées à la narration. Nous sommes face à un livre qui assume son héritage et tâche de construire quelque chose d’autre, de plus moderne, justement, notamment à travers ses personnes LGBT+ et sa critique du colonialisme ainsi que du patriarcat.
C’est une lecture à la fois aisée et flottante, parfois dure dans sa violence, mais très souvent poétique, adaptée à de longues sessions où l’esprit se perd en partie (pensez : train, plage), que je recommande chaudement.