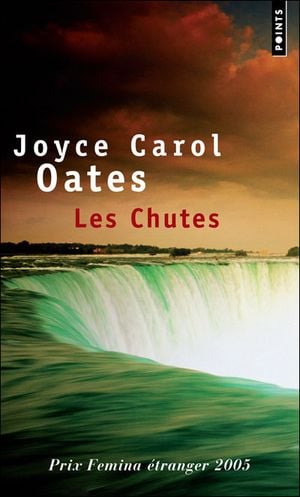Chronique vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lsZAEVF4flE&ab_channel=YasminaBehagle
Joyce Carol Oates, Les chutes — C’est un livre que j’ai mis du temps à terminer, je l’avais posé alors qu’il ne me restait que cent pages, et ne l’ai repris que tardivement, un peu comme une série netflix qu’on ne sait plus bien pourquoi on la regarde. J’avais le fort sentiment que si je ne le terminais jamais, que je le laissais trainer indéfiniment sur ma table de chevet, ça ne m’empêcherait pas de dormir. Ce qui est quand même un gros problème pour un roman, ou pour toute œuvre d’art — l’indifférence, c’est presque pire que le ratage complet. Et pourtant, formellement, il n’y a rien qui cloche objectivement chez Oates, on peut même trouver une certaine élégance à sa plume, qui réussit à alterner les passages poétiques assez expressifs à d’autres plus suggestifs sans jamais qu’on ait l’impression qu’elle en dit trop ou pas assez, (au niveau stylistique, parce qu’au niveau de l’intrigue, ça se discute). Elle fait confiance à l’intelligence du lecteur, parvient à planter des graines dans son esprit, n’essaie jamais de toute éclaircir, de toute assainir. Mais, malgré quelques passages très réussis, ça ronronne. L’effet qu’a principalement produit ce livre sur moi, c’est ce qu’on appelle couramment l’ennui poli. Du bel ouvrage si on ne rentre pas dans les détails, mais l’ensemble se rapproche à mieux y regarder d’un académisme propret. Dans une des critiques qui apparait en premier sur Babélio, il est dit que le style d’Oates est si particulier et justement, c’est le principal défaut que je trouve à ce roman : contrairement à la personne qui a écrit cela, j’ai l’impression d’avoir déjà lu beaucoup trop de livres dans cette langue. Et ce n’est pas vraiment la faute d’Oates, mais plutôt de ces héritiers, je pense par exemple à Anna Hope, mais j’imagine qu’on peut citer beaucoup d’exemple, il faut penser roman choral, et j’ai l’impression que trop de rejetons sont nés de la cuisse de ce type de romans. Un roman choral, donc, qui prend le parti de cocher toutes les cases du genre : la famille décrite est dysfonctionnelle, on va s’intéresser à chacun d’eux pour mettre en scène leur impossibilité à se comprendre, tout le livre prend le soin à tricoter les angles morts de chacun, les difficultés qui empêchent de faire preuve d’empathie ou de compréhension envers les autres et pourtant, va tout ruiner dans le dernier acte. L’auteur remet en question ce constat, qui est quand même un constat intéressant, celui qu’une famille, en son sein même, complique le rapport à l’altérité, dans une scène réconciliatrice où les personnages sont réunis pour guérir et aller de l’avant. Et moi qui en ce moment suis en train de m’essayer au genre, je vois l’artificialité d’une telle facilité : c’est trop pratique, trop commode. La vie n’offre pas sur un plateau d’argent des scènes d’apaisement où tous les personnages sont au même stade de maturation, où ils sont tous au stade de la guérison, sont tous raccords dans l’envie de pardon et de tourner la page. En fait, l’auteur qui fait ça détruit ce qu’il a pris cinq cent pages à patiemment construire, celle de montrer l’individualité de chacun et comment le venin s’est instillé dans leurs veines, sous quelle forme.
Quand on lit les critiques sur Babélio, ce qui revient souvent, c’est la grande capacité analytique de Oates pour comprendre la psyché humaine. Ça revient, et ça m’a fait réfléchir, car lors de ma lecture, je n’avais pas l’impression qu’on entrait réellement dans la tête des personnages à proprement parler, à expliquer leurs mécanismes de pensée, mais plutôt qu’elle emprunte parfois au flux de conscience l’enchainement non-logique des pensées pour définir ses personnages. Mais les définir petit bout par petit bout : les personnages nous restent étrangers, comme nous-mêmes nous sommes étrangers au monde ; nous ne comprenons pas exactement leurs intentions, et c’est la grandeur du livre, et à chaque qu’il trahit ce parti-pris, je pense à la fin quand on comprend qui est le père du petit-ami de Juliet par exemple, le livre s’amenuise. Je crois avoir lu que l’autrice perdait parfois ses lecteurs, et je regrette le contraire, j’aurais aimé, même si elle nous fait généralement confiance, qu’elle nous perde encore plus.
Les chutes — le titre, référence aux chutes du Niagara, mais aussi à la longue chute de la plupart des personnages (plus ou moins symbolique d’ailleurs, on compte pas moins de trois chutes réelles dans les gorges). Les chutes du Niagara ouvrent et clôturent le roman, et un autre reproche que je pourrais faire, c’est que cet endroit, qui est très symbolique, on le perd souvent de vue dans le roman, il devient accessoire, comme en arrière-arrière plan, ce qui fait que quand il réapparait à la fin, je ressens une frustration, la petite nostalgie du début du roman, des promesses qu’il n’a pas tenues. Je regrette parfois le livre que je croyais lire, c’est rare car souvent le livre réel remplace le livre fantasmé, mais là, c’est ce que ça m’a fait. Je lisais en même temps le Pavillon d’Or de Mishima, et le lieu décrit a beaucoup plus d’utilité dans ce roman, il emblématise la Beauté, un idéal inatteignable, alors qu’ici, j’ai l’impression que c’est uniquement en tant que décor qu’il a été choisi : un décor intéressant car il offre une part de mystère, mais un décor tout de même.
C’est donc un roman qui s’offre et se dérobe, qui se perd dans quelques longueurs (je pense à la partie roman noir sur l’enquête de Dirk, ou sur Chandler négociateur de prise d’otage — où l’on se dit, bon, il n’aurait pas pu avoir un boulot plus classique, il fallait vraiment décliner le polar sous une forme plus moderne ?), mais on peut saluer quand même cette envie de surprendre et de se réinventer, de proposer plusieurs romans et ambiances en un seul. Je pense que je retenterai ma chance avec Oates à l’avenir, même si pour celui-là, ça a pu élimer ma patience.