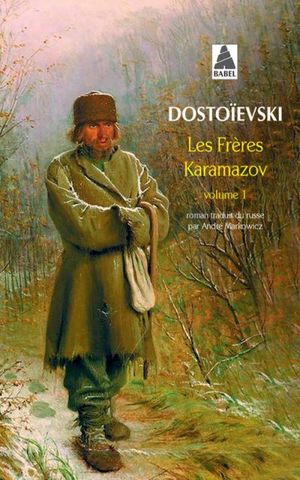Parfois, en voyant l’œuvre de certains artistes, j’ai comme l’impression que tout ce qu’ils ont fait n’était qu’une préparation pour arriver à un sommet, une œuvre suprême, monumentale, qui couronnerait toute leur carrière. Par exemple, si je prends le cas de Sergio Leone, j’ai l’impression que tous ses films ne sont que des préparations, des étapes, voire des brouillons qui l’ont amené à construire le point culminant de sa carrière, Il était une fois en Amérique.
Il est en de même lorsque je songe à Dostoievski. Quelle que soit l’extraordinaire qualité de son travail habituel, ses romans (et on parle là de livres aussi géniaux que Crime et Châtiment, L’Eternel Mari, Les Démons ou L’Idiot, entre autres) n’étaient que des préparations pour le sommet de son œuvre, Les Frères Karamazov. Il ne s’agit pas de dénigrer la qualité des autres romans du maître, mais je trouve que l’ultime chef d’œuvre de Dostoievski contient, réunit tout ce qui était en germe dans le reste de sa carrière.
Les Frères Karamazov, c’est le roman ultime, un des monuments de la littérature mondiale, au même titre que La recherche du Temps perdu (avec lequel il partage certaines qualités) ou Les Misérables (qui est souvent cité parmi les sources d’inspirations). Et c’est un roman typiquement dostoievskien, réunissant toutes les qualités et toutes les thématiques habituelles de l’auteur.
Comme Crime et Châtiment, on pourrait résumer Les Frères Karamazov en une simple histoire policière : un père, affreux jojo débauché et débaucheur, est assassiné en pleine nuit. Le fils aîné, qui semble avoir hérité du caractère débauché de son paternel, est le suspect idéal. L’enquête commence…
Dostoievski maîtrise tellement l’aspect policier de son roman qu’il reste une référence en la matière encore maintenant. La scène où l’on découvre le corps de Fiodor Pavlovitch, le père, en pleine nuit, avec le serviteur Grigori en sang et le présumé fils bâtard Smerdiakov en pleine crise d’épilepsie prolongée, est un moment de tension dramatique extraordinaire. La construction du roman est là aussi savamment orchestrée : le narrateur nous fait suivre Dmitri tout au long de la nuit du meurtre, ce qui fait que nous, lecteurs, savons qu’il n’est pas le coupable ; mais en même temps, ce même narrateur montre comment Dmitri sème tout au long de son chemin les preuves quasi-indiscutables de sa culpabilité, faisant de lui le coupable idéal…
Cependant, ne nous trompons pas : si Les Frères Karamazov est un exemple, un modèle de roman policier moderne, ne l’aborder que comme tel serait commettre une erreur grossière. En effet, la découverte de la mort du père n’intervient qu’au bout de 800 pages, c’est-à-dire aux deux-tiers du livre.
Ce qui importe surtout à Dostoievski ici, c’est la description psychologique de personnages d’une complexité humaine rare. L’écrivain russe est un des ces très rares auteurs capables de reconstituer le cheminement tortueux des pensées humaines. Des pensées prises entre les passions et les désirs, les souffrances et les incompréhensions, les colères et les exaltations. Son roman est d’abord et avant tout le portrait croisé de trois frères différents et semblables, avec leurs fêlures, leurs non-dits, leurs craintes, trois personnages finalement prisonniers de l’image qui s’échappe d’eux (un peu à leur insu d’ailleurs) : le débauché, le socialiste athée et le saint.
Ce qui est extraordinaire chez Dostoievski, c’est qu’il est un des rares écrivains de son siècle à décrire l’homme tel qu’il est réellement. La psychologie dostoievskienne n’est pas asservie à une doctrine ou une philosophie. Il ne fait pas une description socialiste, sociologique, hégelienne ou autre (et surtout pas romantique : je crois même qu'il se plaît à faire de l'anti-romantique). Sa référence n’est pas dans un dogme quelconque. Il décrit l’être humain tel qu’il est réellement, dans toute sa complexité et toute sa liberté.
Car c’est bien là un des malheurs absolus des personnages dostoievskiens. Ils sont libres. Ils sont comme prisonniers de leur liberté. Cette liberté totale et intégrale agit paradoxalement comme une fatalité : délivré de tout dogme, le personnage de Dostoievski ne sait pas quoi faire, ne sait pas où aller. C’est un personnage moralement errant, un vagabond tiraillé entre des aspirations opposées.
Ce tiraillement est un des traits essentiels de la psychologie de Dostoievski : ses personnages sont, à la fois, en même temps, attirés vers le haut et englués vers le bas. Ils sont sincèrement pris de désirs de faire le bien, de se donner en sacrifice pour le bien des autres autour d’eux (des sacrifices paradoxaux parfois, comme lorsque Dmitri se dit qu’il est prêt à tuer pour pouvoir rembourser la dette qu’il avait contractée auprès de Katia Ivanovna : faire le sacrifice de son bien-être moral, s’enfoncer dans le crime, pour sauver son honneur et l’honneur d’une jeune femme). Ils sont pris dans des élans vers le ciel, vers la spiritualité, vers la vie simple, dure et finalement satisfaisante de l’homme bon. Et, en même temps, ils sont englués dans leurs péchés, dans leurs débauches, et ne peuvent (ni ne veulent) vraiment en sortir. C’est, là aussi, la figure de Dmitri, partagé entre deux femmes, la douce et sainte Katia et la débauchée Grouchenka. C’est Grouchenka elle-même, qui mène une vie de débauche tout en restant fidèle à son premier amour. Les personnages dostoievskiens sont à la fois des êtres spirituels et des êtres terriens, presque chtoniens, tiraillés entre deux directions opposées.
Même Aliocha, le saint, n’échappe pas à cette règle. Derrière son extrême religiosité se cache quelque chose de peu avouable, qui transparait dans les souvenirs qu’évoque le narrateur. Son rapport aux femmes est des plus étranges. Freud, qui n’a pas écrit que des bêtises, a dit des Frères Karamazov qu’il était « le roman le plus imposant de son époque ». En tout cas, en bon lecteur de Dostoievski, il a dû voir exposée, au fil des pages du roman, toute sa théorie de l’inconscient, qu’il n’avait plus qu’à plagier allègrement. Dostoievski était vraiment l’un des plus grands connaisseurs de l’âme humaine.
Et un immense écrivain, comme il se doit. Son livre est d’une incroyable liberté de ton tout en suivant une construction rigoureuse. Comme tous les plus grands livres, Les Frères Karamazov ne se contente pas de raconter une histoire, il décrit tout un monde. Le nombre de personnages est impressionnant, et Dostoievski prend le temps d’approfondir la psychologie de chacun d’eux. C’est également tout un portrait de la Russie de son temps qui est décrit là. Un portrait que l’écrivain ne veut pas critique : il ne s’agit jamais de dénoncer quelque chose ici, mais simplement de montrer. Jamais il n’adhère ou ne rejette les idées de ses personnages : il montre des personnages dans toute leur complexité, ôtant tout caractère bêtement doctrinal, politique ou philosophique à son œuvre.
Les Frères Karamazov est donc bel et bien, selon moi, l’aboutissement logique de la carrière de Dostoievski, le sommet de son art, le livre qui réunit tout le génie de l’écrivain. Une œuvre exceptionnelle comme il y en a très peu dans l’histoire littéraire.
- Citation extraite du roman Oblomov, dans laquelle Ivan Gontcharov donne sa conception de la littérature.