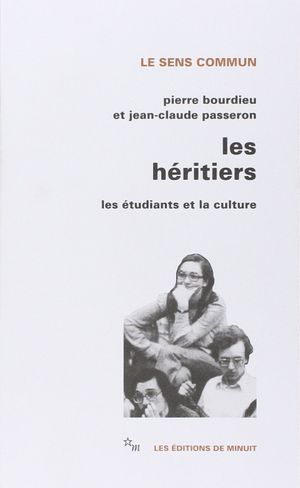Partant de l'inégale répartition des classes sociales dans l'enseignement supérieur et selon les filières, Bourdieu et Passeron vont s'intéresser aux raisons et aux significations de ces inégalités d'accès à l'enseignement.
Le premier chapitre porte vraiment sur les raisons de ces inégalités, c'est-à-dire la fait que les classes sociales supérieures soient nettement favorisées à l'école du fait de la proximité de la culture scolaire / savante avec la culture à laquelle ils ont été confrontés dans le cadre familial. On se penchera plus spécialement sur le cas des étudiants en sciences humaines et sociales, selon les auteurs plus représentatifs des distinctions de classes et des différentes attitudes face à l'éducation.
Le deuxième chapitre se penche plus précisément sur le rapport personnel des étudiants à l'enseignement selon la classe dont ils sont issus. On distingue alors deux attitudes opposées : le dilettantisme des classes les plus élevées, pouvant s’accorder des libertés plus grandes vis-à-vis d'une culture déjà maîtrisée et assimilée (qui démontre aussi d'une certaine assurance) en opposition à une attitude très scolaire d'étudiants moins favorisés faisant des efforts manifestes pour rattraper leur retard. Cette partie parle également de la perception de la vie estudiantine comme une parenthèse plus ou moins détachée du monde réel et de l'avenir professionnel ainsi que de l'influence des enseignants.
Pointant ces inégalités et la volontaire ignorance de celles-ci par le système éducatif, c'est un enseignement plus démocratique que prône cet ouvrage. Il appelle à une prise de conscience nécessaire si l'on souhaite que l'école soit autre chose qu'un lieu de légitimation des inégalités sociales. Les auteurs se permettent de proposer quelques solutions en conclusion : prendre conscience des inégalités et tenter de les compenser, meilleure prise en compte des différences et pourquoi pas penser un autre système de classement des élèves. Une remise en question du rôle de l'enseignant, mais aussi un questionnement de la pédagogie pour aller vers quelque chose de plus rationnel...
Des chiffres et des extraits d'entretiens viennent systématiquement appuyer les propos apportés et le livre est relativement accessible au niveau du langage, mais aussi parce que les auteurs n'hésitent pas à se répéter ou à préciser certaines nuances, le choix des mots, via les notes en bas de page.
Publié dans les années 60, il est légitime de s'interroger aujourd'hui sur la persistance des phénomènes évoqués. En effet, il semble que certaines lacunes du système scolaire décrites par Bourdieu et Passeron aient été en partie prises en compte : une plus grande valorisation de la méthodologie, des visées et des exercices pratiques... même si cela reste très variable selon les filières. Le taux d'accession aux études supérieures a lui aussi augmenté (au point que l'université peine à accueillir tous ses élèves), mais comme le soulignait cet article, la dévaluation des diplômes (notamment suite à un plus grand accès à ces diplômes) implique de s'intéresser aujourd'hui à des formation d'un plus haut niveau d'études, où les inégalités de classe sont toujours présentes.
C'est donc un livre qui trouve aujourd'hui encore sa pertinence lorsque l'on s'interroge sur l'égalité dans le cadre scolaire (mais aussi de manière plus générale) et dont le discours mériterait d'être plus largement diffusé.