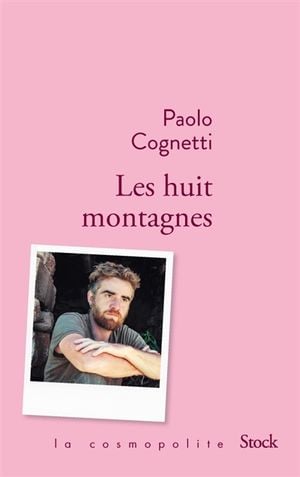À l’image de Pietro, héros des “Huit montagnes”, Paolo Cognetti a passé les étés de son enfance et de son adolescence en montagne, et c’est là qu’à trente ans, tournant le dos à la ville, il a renoué avec la liberté et avec l’inspiration, un épisode de sa vie qu’il a raconté dans son carnet de montagne, “Le garçon sauvage”.
Est-ce en hommage à Primo Levi que le père de Pietro exerce la profession de chimiste ? Dans l’usine de dix mille ouvriers constamment agitée par des grèves et des licenciements qui l’emploie, ce citadin tardif qui a aimé et épousé sa femme dans les Dolomites, leur premier amour, étouffe de colère tant il semble inadapté à la vie urbaine. Pour échapper à cette suffocation et à l’agitation qui règne à Milan, les parents de Pietro louent à partir du milieu des années 1980 une maison dans un village perdu des Alpes italiennes, Grana, où ne vivent plus désormais qu’une poignée d’habitants. Grâce à l’intervention discrète et chaleureuse de sa mère, Pietro le solitaire réussit à se lier d’amitié avec Bruno, le dernier enfant du village. Il découvre ainsi un nouveau monde avec ce garçon des alpages, celui de l’aventure et de la liberté : Bruno l’emmène explorer le lit du torrent, les vieilles étables, fenils et greniers de Grana ou encore l’école abandonnée et envahie de broussailles, reflets du dépeuplement et de l’extinction d’une civilisation de montagnards.
«La nuit venue, dans mon lit j’eus du mal à trouver le sommeil. J’étais bien trop excité pour fermer l’œil : je venais d’une enfance solitaire, et n’avais pas l’habitude de faire les choses à deux. Je croyais, sur ce point aussi, être pareil à mon père. Mais ce jour-là j’avais ressenti quelque chose, un sentiment soudain d’intimité, lequel m’attirait et me faisait peur en même temps, comme un territoire inconnu qui s’ouvrait devant moi. Pour me calmer, je cherchai une image dans ma tête. Je pensai au torrent : à la mare, à la petite cascade, aux truites qui frétillaient de la queue pour ne pas bouger d’un centimètre, aux feuilles et aux rameaux qui flottaient. Puis aux truites qui se jetaient sur leur proie. Je commençai alors à comprendre que tout, pour un poisson d’eau douce, vient de l’amont : insectes, branches, feuilles, n’importe quoi. C’est ce qui le pousse à regarder vers le haut : il attend de voir ce qui doit arriver. Si l’endroit où tu te baignes dans un fleuve correspond au présent, pensai-je, dans ce cas l’eau qui t’a dépassé, qui continue plus bas et va là où il n’y a plus rien pour toi, c’est le passé. L’avenir, c’est l’eau qui vient d’en haut, avec son lot de dangers et de découvertes. Le passé est en aval, l’avenir en amont. Voilà ce que j’aurais dû répondre à mon père. Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de nos têtes.»
Dès qu’il est en âge de faire des randonnées, Pietro accompagne son père vers les sommets et il gardera de lui une façon “d’aller en montagne”, une transmission par les gestes plutôt que par la parole, rejoignant la filiation par la nage si merveilleusement évoquée par Chantal Thomas dans “Souvenirs de la marée basse”.
Roman lumineux, “Les huit montagnes” dit combien le lien et l’amitié peuvent être aussi splendides que fragiles, comme toute véritable relation humaine. Au sortir de l’adolescence Pietro coupe les ponts avec son père et avec la montagne pour rejoindre la ville et sa condition originelle de citadin, s’éloignant du même coup de son ami d’enfance.
Après la disparition prématurée de son père, l’héritage inattendu d’un terrain en montagne le ramène à Grana. À la fin du printemps et au cours de l’été suivant, saison du retour et de la réconciliation, il s’installe en montagne pour construire avec son ami Bruno, devenu maçon, la maison imaginée par le père sur son terrain adossé au rocher, sous la barrière imposante des glaciers du Mont Rose. Cette pause de son existence lui permet de retrouver ses jambes d’autrefois et de faire la paix avec cette montagne dont il s’était éloigné en coupant les amarres avec son père. L’amitié avec Bruno se reconstruit en même temps que la maison, autour des gestes et avec peu de mots. Cœur de cette histoire, la montagne est le lieu où se renoue l’amitié de deux hommes entretenant avec elle un lien si différent, le lieu de la conservation et de la mémoire comme chez Mario Rigoni Stern ou W.G. Sebald.
«Le glacier fascinait l’homme de science qu’était mon père encore plus que l’alpiniste. Il lui rappelait ses études de physique et de chimie, la mythologie sur laquelle il s’était construit. Le lendemain, sur le sentier qui menait au refuge Mezzalama, il nous raconta une histoire digne d’un de ces mythes : le glacier, dit-il à Bruno et à moi, c’est le souvenir des hivers anciens que la montagne garde pour nous. Passé une certaine hauteur, elle en conserve le souvenir, et si on veut retrouver un hiver lointain, c’est là-haut qu’il faut aller le chercher.»
Ce qui donne sa puissance à ce roman publié en 2016 et superbement traduit de l’italien par Anita Rochedy pour les éditions Stock (août 2017) est que Paolo Cognetti, en digne héritier de Mario Rigoni Stern, excelle à dire ce que les silences recouvrent, et à raconter d’une manière magnifiquement humble la rencontre et le frottement de l’homme et de la montagne, avec en filigrane au fil des décennies et de “l’apprentissage” de Pietro, la transformation du milieu naturel et de la civilisation des montagnards.
«Peut-être ma mère avait-elle raison, chacun en montagne a une altitude de prédilection, un paysage qui lui ressemble et dans lequel il se sent bien. La sienne était décidément la forêt des mille cinq cent mètres, celle des sapins et des mélèzes, à l’ombre desquels poussent les buissons de myrtilles, les genévriers et les rhododendrons, et se cachent les chevreuils. Moi, j’étais plus attiré par la montagne qui venait après : prairie alpine, torrents, tourbières, herbes de haute altitude, bêtes en pâture. Plus haut encore la végétation disparaît, la neige recouvre tout jusqu’à l’été et la couleur dominante reste le gris de la roche, veiné de quartz et tissé du jaune des lichens. C’est là que commençait le monde de mon père. Au bout de trois heures de marche, prés et bois cédaient la place aux pierrailles, aux petits lacs cachés dans les combes à neige, aux couloirs creusés par les avalanches, aux ruisseaux d’eau glacée. La montagne se transformait alors en un lieu plus âpre, plus inhospitalier et pur : là-haut, mon père arrivait à être heureux. Peut-être retrouvait-il sa jeunesse, en retournant à d’autres montagnes et d’autres temps. Même son pas semblait se faire moins lourd et recouvrer une agilité perdue.»
https://charybde2.wordpress.com/2017/12/27/note-de-lecture-les-huit-montagnes-paolo-cognetti/