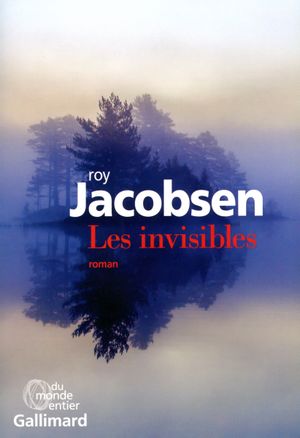Les minutes d’observation vigilante que je garantis aux rayons de littérature scandinave à chacune de mes visites dans une nouvelle librairie se ressemblent. Je suis surpris : il y a plus de livres que dans la dernière – en fait c’est rarement vrai, mais je suis surpris ; puis je reste incertain. Les noms d’auteurs restent les mêmes ; il est difficile de mettre la main sur quelque chose de vraiment frais ; tiens, un autre qui parle de pêche au début du XXe… Parfois il y a des guides, pour les geysers islandais ou les fjords verdoyants norvégiens. Je me dis que le tableau de l’agence de voyage est complet, que je suis condamné à m’attourister de la monotonie du Nord qu’on me vend.
Mais tout de même, c’est drôle. Les paysages des pochettes sont rarement aussi riants dans les lignes du texte. Les éternels pêcheurs à la morue y meurent de froid, noyés, de solitude. Souvent il y a de la métaphysique – peut-être un argument marketing de plus ? « Approchez-vous mesdames etc. : le légendaire Einar Hjartasteinn au cœur-de-pierre ! comme il est dur ! oh qu’il est fier ! ». Mais elles sont bien sombres ces pensées que nourrit la nuit polaire, et souvent, on a l’impression de mettre le doigt sur quelque chose : de l’étranger, un témoignage d’un autre, d’un adelphe qui ne nous ressemble pas ; ce que peut la littérature, en somme, dans sa forme la plus nécessaire.
Si les choix éditoriaux faits par les maisons françaises n’ont rien d’émouvant – à moins que la lassitude soit une émotion – ceux qui décident des traductions qui seront subventionnées sont loin d’être des billes. Au moins se fient-ils à la critique étrangère.
Il a tout de même fallu attendre cette année 2019 pour qu’une traduction, d’ailleurs d’excellente facture, de Roy Jacobsen, pourtant reconnu depuis trente ans dans en Norvège comme l’un des auteurs contemporains incontournables, paraisse en poche.
Les Invisibles assouvit, s’il en est encore besoin, notre soif de voyage : son personnage principal est l’îlot de Barrøy, dans l’archipel des Lofoten, où s’acharne contre la vie une typique famille éponyme. Hans Barrøy en pater familias nordique, sa mutique épouse Maria, Martin le père chenu, Barbro la sœur autiste et l’angélique Ingrid, fille unique de sept ans, qui sourit mais grandit, trop vite parce que c’est ce que la vie lui demande.
C’est bien entendu une vie dure qui se mène là, rythmée par les exploits techniques des hommes, qui domptent leur île quand elle leur donne secrètement, par avance son consentement. Personne n’est dupe, elle reste maîtresse, capable de renvoyer toute la famille à chaque instant au néant de la vanité de sa petite humanité ; mais cela est rassurant. Barrøy est fauve, mais elle n’est pas ennemie.
L’attention portée aux gestes et aux outils laisse souvent penser à un roman d’aventure dans la veine de L'Île Mystérieuse, mais le paradigme de l’émancipation de la terre annihile d’entrée de jeu la gloire coloniale sur laquelle survivent les héros de Jules Verne. La famille Barrøy, plus modeste, doit se soutenir dans la chaleur humaine, enfouie pourtant si profondément dans l’exil îlien. Mais le continent n’est pas plus attirant. En ce puissant début de XXe siècle, le progrès, les fortunes de nouvelles mœurs et du capital y broient les hommes.
Depuis l’Usine sur le rivage, à l’horizon, Barrøy, ce n’est pas l’enfer, ce n’est pas le paradis. Ce n’est d’ailleurs rien pour quiconque d’autre que ses habitants ; et, pour eux, Barrøy, c’est la maison. Ils ne la quitteront jamais, ils s’y accrochent autant qu’elle s’agrippe à eux, malgré tous les manques qu’ils y ressentent.
À bord, il faut être ensemble pour survivre. Ce ne sont pourtant que des bribes que l’on échange, à plus forte mesure encore dans les temps de détresse. On y doute, on y sonde le fond de son âme, en silence. L’écriture de Roy Jacobsen retranscrit bien l’hésitation et la parcimonie de la compassion.
Les phrases sont brèves, tranchantes puisqu’elles saisissent à vif les traits de celui ou de celle qu’elle regarde, mais pas tranchantes comme un couperet, qui équeuterait le spectre du visible, pour garantir un vrai artificiel et se débarrasser d’un faux pas moins fabriqué.
On pourrait y voir une esthétique de l’isolement radicale. Pourtant, dans les détails, tout montre que ce n’est pas ainsi que la vie est conçue. Les îliens veillent sur le rivage, y accueillent les épaves, des arbres centenaires déracinés, le quai de l’îlot voisin arraché par la tempête : des cadavres en somme, ou des matériaux à mettre au service de la vie, comme la carcasse consommée par les vers.
Il y a un rapport avec le continent, qui constitue Barrøy en tant que telle. Elle le regarde ; lui parle, timide ou défiante, quand elle lui envoie une barque. Lui-même, il l’envahit parfois, quand il lui rappelle qu’elle n’est pas hors de ce monde, hors de l’histoire ou de la guerre, même si elle veut leur tourner le dos, et que chaque fois que le dehors surgit, on le ressent comme une effraction.
Si la famille Barrøy est sensible à la métaphysique, c’est qu’elle aussi est sujette au temps qui passe. On meurt et naît au sein de l’île, et c’est si surprenant qu’on croit l’avoir oublié à chaque fois ; on peut même y être adopté. Le temps passe, oui. Le soleil ne disparaît jamais pour de bon sous l’horizon. Il revient pour éclairer des rides, des ruines absurdes au bord de l’eau, là où une civilisation d’une dizaine d’habitants a perdu la vie et la mémoire.
Chez ceux que l’on ne voit pas, rien n’est bon, rien n’est mauvais : tout passe, et tout reviendra.
Alors oui, au fond, Les Invisibles est bien un livre-voyage, puisqu’il faut qu’il en soit ainsi pour paraître en France. Mais c’en est un de choix parmi la masse. De la littérature dans sa forme la plus nécessaire.
Lu dans la traduction française d'Alain Gnaedig.