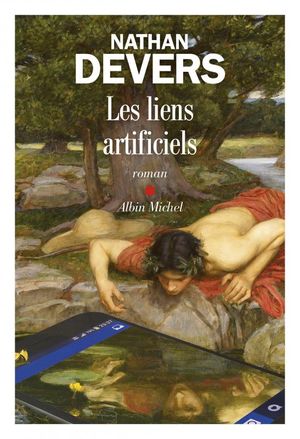Croque-mort des lettres déguisé en sociologue
Combien ce livre me déçoit, je ne saurais le dire vraiment sans désespérer tout-à-fait de la littérature (Ou la non-littérature) d’aujourd’hui. Non.
Voici donc un normalien de 24 ans, agrégé de philosophie qu’on nous présente comme le digne héritier d’un J.P. Sartre. Bon.
Tout va de travers dans ce roman, à commencer par ce style fade, presque administratif. J’ai eu l’impression de lire une histoire racontée par un professeur d’économie qui de sa vie n’a jamais écrit autre chose que des thèses sur la balance commerciale et la bourse des valeurs, insipides et ennuyeuses comme ses chemises trop repassées. On sent l’universitaire habitué aux dissertations, aux explications, mais vierge de toute effusion, de tout torrent intérieur.
Je n’ai jamais lu autrement qu’en amateur de poésie, que ce soit Nietzsche ou Baudelaire, Sartre ou Desnos. Tout grand livre, tout beau livre doit d’abord être un long poème, et le roman, par les échos qu’il peut multiplier à l’infini entre les chapitres et les scènes, entre les personnages et les décors, par un style chantant, par des images parlantes et une tension dramatique, peut être considéré comme un poème en prose. Du reste, des gens comme Mallarmé, Desnos, Hugo ou Queneau ont pleinement assumé le haut potentiel poétique du roman.
En cherchant, on trouvera aisément le Hugo des Contemplations dans Les misérables et Quatre-vingt-treize, fort de ses nombreux oxymores et antithèses expéditifs qu’on connaît bien. Le Mallarmé des Poésies est tout entier dans Les Pages ; le Desnos de Corps et biens est au complet dans La liberté ou l’Amour.
Style fade, disais-je. L’adjectif « électrique » revient quelques fois sous cette plume, mais qu’y a-t-il d’électrique en elle vraiment ? Rien.
Ce livre tire toute sa légitimité de sa modernité confondante, de son caractère de prophétie avant-gardiste. Ici, l’argument marketing est donc flagrant, comme si le fait de parler du monde présent et du futur, comme si inscrire une œuvre (Je tique en écrivant ce mot) dans l’actualité et les eaux troubles d’Internet dédouanerait son auteur de faire un travail d’écrivain. Il n’est pas encore question des impératifs auxquels tout romancier devrait soumettre son livre.
Ce que je cherche dans un livre, c’est d’abord une vision de l’Homme, une facette anthropologique de l’Humain que je ne connaissais pas ou que j’appréhendais malaisément. Je demande donc à chaque œuvre de me montrer l’Homme, de m’aider à le comprendre, à lui pardonner, à vivre dans des millions de corps, à visiter une pléthore d’âmes rien qu’en côtoyant quelques personnages riches et authentiques.
Chez Devers, rien de cela. Son personnage, Julien Libérat, loin de représenter l’Homme individualiste, lassé, orphelin d’idéal et de transcendance, loin de nous peindre la détresse des hommes du 21 ème siècle que la cupidité folle des patrons d’Internet s’empresse d’exploiter en en faisant autant de moutons bêlant après des algorithmes, tout ce qu’il montre à la clarté d’une lecture attentive, c’est l’échec constant et pathétique d’une écriture programmée, à l’image des réseaux sociaux et de l’Antimonde dont il s’entiche, non pour dire la vérité et lui donner ses droits, mais pour charmer les petits esthètes de Saint-Germain-des-Prés qui, sachant bien que la vraie littérature est morte avec Sartre et Aragon (1980-82), mais n’en laissant rien paraître, tant cet aveu coûterait à l’égo gargantuesque de ce petit monde qui croit encore que la France livresque rayonne dans le monde comme au temps des soirées de Médan, se rengorgent de la fierté d’avoir un écrivain, un vrai, tant les autres (Les Angottistes en couettes) se font un point d’honneur de ne jamais en donner le mirage, assumant la crasse et la sacralité de l’Intime qui mine tous leurs livres.
Je tiens d'abord pour responsable de ce marasme Houellebecq, sur l’autel duquel tous ces rentiers de la fausse littérature se touchent comme des sœurs vicieuses sur Jésus. Houellebecq a montré à toute une génération de plumitifs au verbe rassis qu’il est possible de faire du roman sans jamais chercher la transcendance nécessaire à toute œuvre d’art, transcendance dont les canons sont : le Beau, le Vrai et le Juste dans le cas d’une littérature moraliste comme chez Hugo ou Barrès.
Houellebecq a dépossédé le roman de sa capacité à dire l’Homme intemporel en ancrant, ou plutôt en noyant tous ses personnages dans l’époque, en les condamnant à ne jamais dire, exprimer et montrer autre chose que les maladies et obsessions de notre temps. Ainsi, le romancier est pris au piège de son sujet. Il se laisse envahir par la merde qu’il prétend traiter en naturaliste roué. Voulant soumettre l’époque à sa plume, il se retrouve les fers aux pieds, noyé et affadi par les tares qu’il voulait exposer, maculé du sang des plaies qu’il désirait ausculter. Le sujet submerge l’auteur et finit par le transformer en acteur de sa médiocrité, en exemple d’une décadence qu’il était censé aborder en vainqueur. Cette infirmité, cette incapacité de s’élever de la boue de l’époque pour mieux en miroiter les reflets, empêche l’auteur de placer son histoire dans le temps long. Dans ce genre de romans, on ne voit jamais l’Homme dans ce qu’il a de plus vrai, c’est-à-dire de plus intemporel. Pour qu’un personnage soit vrai, il faut qu’il soit aussi préhistorique que les demeures troglodytes et aussi actuel que le journal du jour. Il n'y a qu'à voir l'histoire entre Guillaume et Hersent dans La plage de Scheveningen que Paul Gadenne inscrit dans le marbre de l’histoire universelle en la comparant à celle d’Abel et Caïn, histoire millénaire, mais aussi actuelle pour l’époque (1952), puisque leur histoire est celle de millions de Français : collaboration, fascisme et les amis d’antan qui s’en vont déçus, incompréhension de l’engagement méprisable…etc.
Nathan semble malheureusement avoir trop lu Houellebecq, beaucoup trop pour se garder d’en imiter les recettes.
Houellebecq n’a d’intérêt que dans le cas où la sociologie classique deviendrait trop paresseuse ou barbante. On ne lit pas Houellebecq pour exister autrement ou en apprendre plus sur l’humanité, non. Il a donc désappris aux écrivains à écrire de vrais romans, c’est-à-dire à composer des jeux langagiers à triple, quadruple fond.
Dans tout roman, il y a naturellement en premier lieu ce que j’appellerais « Le prétexte », ce qui justifie la narration. C’est d’abord le cadre spatio-temporel, l’histoire en elle-même, l’ambiance politique…etc. Ensuite, l’on pourrait distinguer ce que Houellebecq conserve dans ses livres : un réalisme sociologique qui met en relation causale « Le prétexte » - l’atmosphère et le cadre du roman – d’un côté, avec les comportements et attitudes de certains archétypes identifiables dans la société de l’autre.
Ce réalisme peut plus et moins que la sociologie : il a la liberté de passer à son aise de la sociologie à la psychologie et densifier, enrichir ainsi un type avec tout l’attirail psychologique et observationnel dont dispose le romancier. Il peut moins puisqu’il lui est impossible de mettre en formules limpides une vérité exhaustive et rigoureuse concernant toute la société. La dimension psychologique et investigatrice, même psychanalytique du roman l’empêche de s’élever réellement au-dessus des hommes pour considérer la société dans son ensemble. Jules Romains a essayé mais tout le charme des Hommes de bonne volonté réside dans l’attirance qu’on éprouve pour l’intelligence perçante d’un Jallez, pour l’optimisme volontaire d’un Jerphanion, mais l’unanimisme n'atteint jamais la subtilité des chapitres où Romains poursuit avec acuité les folies singulières de ses personnages. Le singulier l’emporte sur le pluriel et c’est toujours l’Homme qu’on préfère aux autres, au peuple, à l’ensemble qui finit par faire sourire.
Malheureusement, les personnages et l’intérêt qu’ils doivent susciter contraignent le romancier à les traiter comme des objets uniques mais où peuvent se distinguer quelques reflets d’une vérité sociologique.
Nous voilà donc au 3 ème fond, l’arrière-fond, le vrai, nous voilà à la sève nourricière du roman. Tout ce dont je viens de parler ne sert que d’alibi à l’écrivain pour justifier de l’actualité de son roman et de sa place dans l’univers littéraire. Il utilise donc le désir, ou plutôt le besoin qu’on a de lire des choses qui nous concernent, il le convoque pour nous parler en vérité d’autre chose. Prétextes donc. Le romancier prend pour exemple son époque dans une démonstration anthropologique qui la surplombe, l’englobe, mais la traite comme un point dans l’espace, comme une borne naine dans une frise chronologique où s’enchaînent les siècles.
En ceci, le roman concurrence les livres sacrés, les prend pour modèles et s’inspire de leur force d’évocation. À partir de là, l’objectif n’est plus de mimer comme un imbécile amuseur de rue les pires travers de l’époque et d’en rire mais de les relier, les expliquer, les éclairer – en sus de l’apport du « Prétexte » à la compréhension de ces phénomènes – de les relier donc à l’histoire universelle des hommes. Il faut nous montrer en quoi le morveux addict à un jeu réaliste sur Internet est de la même espèce qu’Hannibal et Apulée, en quoi son addiction est la forme moderne d’un instinct, d’un désir, somme toute d’une vérité écrite sur la chair de l’Homme, sur sa destinée depuis la nuit des temps. Que partage ton personnage avec ceux de l’Odyssée et de la Bible ? Celui de Nathan ? Rien.
Je me réponds à moi-même, à demi railleur, que ceci est bien volontaire de sa part. Mais être conscient d’une tare n’en fait jamais un atout, et le roman est définitivement mort de sa douce et laide mort, douce puisque non-avouée, tue par de faux esthètes qui jouissent davantage du mirage d’un beau livre que d’une vraie expérience littéraire, laide puisque la prétention de ces gens-là, gardiens des Lettres, à mettre leurs pas dans ceux des plus grands est si pathétique qu’il serait scandaleux d’en rire, vraiment.
Pour la construction du roman, il faudrait repasser. C’est très mal construit. Les ponts causals sont plus que fragiles. L’évocation de la relation amoureuse et la rupture entre Julien et May au début du roman ne sert à rien. Elle peine à expliquer l’attitude du personnage principal, sa lassitude et la pente que prend sa destinée. C’est poussif. On ne croit pas une seule seconde à cette volonté de prendre sa revanche dans un monde virtuel – où tout ce qu’il désire lui est octroyé – sur le monde réel insatisfaisant et frustrant, pour la simple raison que toutes les bribes du passé de Julien que l’écrivain nous livre comme autant d’explications ne sont jamais convaincantes. Julien ne semble même pas très peiné quand la rupture est là, ou quand May lui annonce qu’elle part à New-York avec un autre.
C’est le défaut d’une littérature performative qui croit qu’en disant « Un tel est blessé, Martine se sent confuse, Daniel est déconcerté », aussitôt le lecteur en prendrait connaissance et dirait : d’accord mon coco, continue. Non. Il ne suffit pas de nous dire que Julien souffre ou est chagriné pour nous embarquer. Il faut nous les montrer, toutes ces émotions que l’esprit connaît mais que le cœur ne reconnaît pas. C’est d’ailleurs la différence entre la philosophie et la littérature. La première fait surgir la vérité des mots quand la seconde la cherche dans les images qu’elle s’évertue à tailler à la pioche du langage. Nathan Devers raconte des histoires comme il exposerait une thèse philosophique. Quelle tragédie !
On nous dit que le personnage est perdu, las, presque malade, mais nous montre-t-on au moins une fois comment l’est-il ? Non. Les mots, toujours les mots, jamais l’image ! Toutes les scènes censées soutenir cette description psychologique ne révèlent pas grand-chose, ne suivent point d’ailleurs l’idée présidant à leur exposition.
On y voit un personnage perdu qui répond indifféremment à tout comme le ferait n’importe quel personnage de n’importe quel roman.
La partie narrant l’ascension d’Adrien Sterner (Entrepreneur ambitieux créateur de l’Antimonde qui happe Julien) est trop longue, trop impersonnelle, trop attendue. Le personnage surpuissant et calculateur, ce stéréotype du self-made-man qui n’hésite pas à se référer à la Bible pour souffler sur son projet un élan créateur et mystique (À défaut de vraie transcendance, on a ça : un prédicateur en carton), cet archétype est aujourd’hui usé jusqu’à la corde. Je trouve même indécent qu’on puisse penser dire à travers ce dernier quelque chose de neuf.
D’Octave Mouret à Jean Barnery, en passant par Haverkamp et Raymond Pasquier, l’archétype de l’entrepreneur ambitieux, frère de lait de Macron, a les os rongés par la terre du temps et l’usure des publications.
Enfin, je passerai sur la maigreur de sa personnalité que ne sauve même pas un génie dont on se doute des moindres trouvailles à venir, ce qui est le contraire du génie. Improbabilité et surprise où êtes-vous ?
L’épisode au chapitre 10 de la 2 ème partie, où nous voyons Julien aller donner son dernier cours au petit Michaël, gosse de riche indiscipliné et paresseux, avant de s’investir entièrement dans l’Antimonde, achève de nous convaincre que le livre a été bâclé, mal foutu, puisqu’il ne sert strictement à rien, ne renseigne sur rien. Julien disparaît du tableau et tout ce qu’on nous donne à voir c’est le reflet brumeux d’une esquisse hâtive de ce pourri gâté de Michaël. Nous renseigne-t-il donc sur le passé de professeur de musique de Julien ? Non. Nous aide-t-il à comprendre pourquoi il s’inscrit dans l’Antimonde et voue ses jours à ce jeu de réalité virtuelle ? Non plus.
J’arrête là, car à force d’énumérer les manquements, de répertorier les maladresses d’un universitaire qui s’improvise sans succès romancier, j’en oublie que l’objectif premier, le dessein d’un tel livre n’est pas de dire la vérité ou de la faire dire au lecteur, tâche qui exige une grande rigueur, une tyrannie dans le choix et l’agencement des scènes et des chapitres, une traque minutieuse de tout superflu, de toute évocation relevant de l’anecdote, de la fioriture. Non. L’objectif est de charmer le public esthète qui pleure en cachette sa littérature d’antan mais sera toujours prêt à encenser, à gratifier de mérites donnés d’une main prodigue, (Il n’y a qu’à voir l’engouement d’un BHL, ancien sbire de Sartre et de Barthes, pour ce jouvenceau), à crier au génie pour peu qu’on lui donne des mots rares, quelques métaphores bien tournées et sibyllines à souhait et l’apparence d’une littérature spéciale, ésotérique, faisant mine d’exclure de son horizon d’attente tous ceux qui ne possèdent pas les lettres, quand elle ne sert en vérité qu'à faire croire à certains qu’ils font partie, comme jadis les habitués des après-midis de Mallarmé, des élus auxquels leur savoir permet de goûter aux divines délices d’une œuvre dont ils ignorent l’affligeante morosité sous le soleil.
Je tiens à préciser que les quelques béquilles relevées dans cette critique sont multipliées par 100, par 1000 tout au long du livre et rendent fidèlement l’avis que je me suis fait des 300 pages. Nathan Devers est ce qu’on pourrait appeler « Une matière grise gâchée mais téméraire ». Sa prose porte comme un stigmate tant de défauts qu’elle ne cesse de rebrasser dans l’eau sale des précédents manquements. Elle possède la vertu de répéter à l’infini des erreurs qu’elle présente comme forces : superflu, scories, anecdotes sans rôle, sécheresse chronique, prévisibilité…
Il s’agissait donc pour lui, en écrivant ce livre, d’y garder fermement la cohérence interne du néant et la perspicacité de ses déficiences. Malheur lui en prit de chercher la publication, de désirer le paraître et la fausse lumière de la télévision. Que n’as-tu travaillé plus mon cher Nathan ! Que n’as-tu fait ton métier ! Tu voulais remplir des pages, avoue donc !
Qu’un dieu, quel qui soit, me garde de lire des torchons de ce genre à l’avenir ! Qu’un oblat prie pour moi et je serais alors le plus heureux des hommes. Un oblat, pas un moine je vous prie !