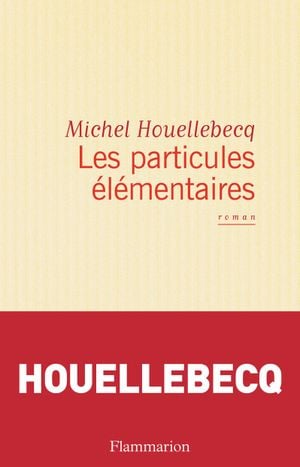Dépression, dérision, sexe
Une première certitude, très intime – Houellebecq n’a jamais écrit et n’écrira jamais qu’un seul roman, cette histoire des deux (demi) frères (et la confrontation répétée des deux moitiés ne permettra jamais de retrouver l’unité perdue), apparemment si complémentaires, le scientifique et le littéraire, le prof et le chercheur, totalement mutilée en réalité, l’un dont le cerveau, dès le début, a totalement dévoré le corps, l’autre dont l’obsession du corps et du sexe, sous le signe de la grande maladie, parviendra à annihiler, jusqu’à la folie le fonctionnement du cerveau.
Houellebecq n’a écrit qu’un seul livre. En amont, Extension du domaine de la lutte (très bref et intéressant) n’est en fait qu’un synopsis, presque le brouillon d’un roman futur – où les personnages, les « théories" seront repris, développés, revêtus, dans la douleur, de chair. La suite compte à peine : Plateforme (très raté) se borne à reprendre l’obsession de la pédophilie, à glisser ici ou là quelques provocations (que des crétins traduiront en procès …) sans parvenir à tenir la distance ; de même la Possibilité d’une île, sans doute plus ambitieux (mais raté), se borne à reprendre l’obsession de l’espèce nouvelle à créer, sur fond de clonage, avec une attaque assez originale, un enlisement du côté de Raël , et toujours l’incapacité à tenir la distance du roman. Et il est encore plus difficile d’évoquer la Carte et le territoire, qui ne fonctionne, que très ponctuellement, par provocations légères, jusqu’au moment où Houellebecq ne sachant plus comment finir met en scène et sans transition … sa propre disparition.
Depuis Houellebecq n’écrit plus, ou des bribes – et se contente de participer à des performances avec d’autres, sans doute décidées après quelque beuverie, le film (évidemment aussi intéressant qu’exaspérant concocté par les garnements de Canal, Near death experience, mais mise en scène, thèmes et dialogues n’appartiennent qu’à Kervern et Delépine) ou encore les poèmes interprétés par Aubert. Il ne fait aucun doute que ces expériences ont été entreprises avec un enthousiasme aussi extrême que minimaliste …
Un seul livre – sans doute (et tous ceux qui écrivent, pas les techniciens de l’écriture – terme qui pourrait d’ailleurs convenir pour les œuvres ultérieures de Houellebecq ont forcément éprouvé cette usure) à cause d’un investissement, intellectuel et physique absolu, d’une mise à nue (à ne pas confondre avec le souci, bien moins intéressant de la provocation) à très haut risque. Et on ne peut pas ressortir intact d’un tel investissement – même lorsque l’on semble doté d’un tel pouvoir de repli que Houellebecq. Car la fatigue est aussi, d’abord, très physique et s’accompagne nécessairement du sentiment qu’à ce stade tout a été dit.
Demeure le livre – que j’ai relu, longtemps après, après avoir été confronté à son adaptation théâtrale (4 heures !!), strictement fidèle, mais pas réussie pour autant, ni dans ses partis pris formels (les comédiens immobiles face au public, disant le texte de Houellebecq , la recherche de forme passant par des projections vidéos, des effets de lumière ou des éléments musicaux joués jusqu’à saturation, des passages en anglais), ni dans les choix textuels (des élément sur-représentés, masturbatoires notamment, d’autres négligés) – la transposition étant sans doute impossible : la lecture s’accompagne de pauses, indispensables pour éviter la saturation et permettre la distance.
Demeure le livre, dont l’originalité, immédiatement ressentie, n’est pourtant pas si évidente : les « théories » développées par Houellebecq ne sont en effet pas extrêmement originales – l’idée des grandes « mutations métaphysiques » n’est qu’une déclinaison, assez approximative, du « Nous autres, civilisations, savons maintenant que nous sommes mortelles » ; l’idée d’une espèce nouvelle, explicitement empruntée à Huxley (et pathétiquement reprise, plus tard, via Raël et la possibilité de l’île …), combinée avec les découvertes du génome et du clonage, est dans l’air du temps ; la critique de l’individualisme à outrance, combinée avec la critique de l’après 68, renvoie à une problématique personnelle et assez anecdotique (le règlement de comptes, certes horrible, avec le personnage de la mère) et recoupe des théories économiques désormais éprouvées, comme la critique du libéralisme via « la liberté du renard libre dans le poulailler libre ». Même appliqué au sexe, tout cela n’est pas très neuf.
Les Particules élémentaires n’en sont pas moins une œuvre originale – et forte ; d’abord par quelques réelles singularités, propres à Houellebecq :
• La confusion, délibérée et souvent ironique, entre réalité et fiction, souvent en fait l’occasion d’épingler quelques sommités- le procédé sera beaucoup plus utilisé dans les romans futurs, jusqu’à faire des personnages en question des éléments importants de la fiction (et jusqu’à Houellebecq lui-même …) ; ici, ce sont des évocations très ponctuelles, à la marge – Sollers accueillant Bruno, à propos de la (non) publication d’un article, à vocation effectivement très polémique et très raciste ; ou encore, avec la mère des héros, le temps d’une danse, la silhouette, particulièrement laide, de Jean-Paul Sartre ; et d’autres : « lors d’un dîner chez Bénazéraf, sa maîtresse avait rencontré Deleuze, et depuis elle se lançait régulièrement dans des justifications intellectuelles du porno … » Parfois même certains patronymes attribués aux personnages de papier renvoient aussi (mais pourquoi ?) à une autre réalité : Desplechin, Di Meola …
• L’ironie, évidemment : elle consiste d’abord à ne rien prendre, vraiment, apparemment, au sérieux ; à détruire par une saillie, délibérément décalée, triviale, très grossière, provocatrice, toute proposition qui s’annonçait comme sérieuse ; mais l’ironie de Houellebecq est pour le moins complexe : on ne peut jamais savoir s’il adhère, où s’il ironise, ou s’il adhère provisoirement (le temps parfois de la formule), ou s’il ironise provisoirement, ou s’il se soucie fort peu de tout cela – tout reste ouvert …
• La construction du roman, très savante par delà les apparences : trois parties, qui renvoient en fait aux trois grands moments dans la vie des deux frères : le passé (l’âge d’or, perdu), le présent (en ruines, et glauque, avec ses hauts lieux du commerce sexuel et inéquitable, communautés, camps naturistes, boîtes à partouzes), le futur, ouvert et serein. Et cette construction, jusqu’aux titres des trois parties, dit beaucoup : le « royaume perdu » renvoie ainsi à un avant, celui des civilisations, mais plus encore celui des individus, un temps heureux et effectivement vécu, un temps qui sera plus tard évoqué par la jeune femme, Annabelle, dans des termes absolument désespérés, de ce genre-là : « je n’arrive pas à comprendre à quel moment tout ça a foiré … » Et les deux frères eux-mêmes, par delà tous les essais de dialogues (d’ailleurs très pesants au long de la seconde partie, ne parviennent précisément pas à se trouver dans ce présent : chez Bruno, égaré dans ses déboires sexuels et sociaux, ce ne sera qu’une critique constante, plus que violente, atroce du passé ; chez Michel, traversant le présent en le voyant à peine (son ultime, ou première, rencontre sexuelle avec Annabelle, ne sera traduite qu’en un compte rendu scientifique), il n’y a qu’une projection dans un monde futur renouvelé. Pas de présent.
• La phrase de Houellebecq , si personnelle – sociologique, clinique, blanche, simple ; mais avec souvent, des décalages lexicaux très surprenants, ces termes très grossiers déjà évoqués qui viennent s’insérer dans un discours posé comme policé, ces références à des marques, à des enseignes ; de véritables chocs, aussi, à l’intérieur des phrases, qui interdisent au lecteur de se situer, ou au contraire l’invitent à trouver sa propre situation, quelque part entre provocation énorme et poésie pure. Ainsi de cette évocation, en deux temps, de Desplechin, le directeur de Michel au CNRS : « il n’arrivait plus à se souvenir de sa dernière érection ; il attendait l’orage ». Et, très rarement bien sûr, la phrase finit aussi par échapper au contrôle, à se laisser envahir par l’émotion, ainsi de l’extraordinaire fin de la première partie, le paradis perdu, après la mort de la grand-mère : « il se passa environ deux minutes, puis on entendit, venant de la chambre, une sorte de miaulement ou de hurlement. Michel était enroulé sur lui-même au pied du lit. Ses yeux étaient légèrement exorbités. Son visage ne reflétait rien qui ressemble au chagrin, ni à aucun autre sentiment humain. Son visage était plein d’une terreur animale et abjecte. »
• Et la provocation ? Elle est permanente, énorme, dans tous les « full frontal » plaçant personnages et lecteurs face à la misère sexuelle, ou à des énormités sociales, dans la pensée (le racisme de l’article proposé à Sollers) ou dans les actes (Bruno hurlant, chantant devant le corps cadavérisant de sa mère), dans des paradoxes déconcertants, sérieux ou pas, comme la valorisation récurrente du Club des cinq ou de Pif le chien comme outils de pensée en contrepartie de la critique négative et tout aussi récurrente de Nietzsche, de Shakespeare …
QUESTION : MICHEL HOUELLEBECQ EST-IL UN TROLL ?
La réponse est non. Définitivement.
Les particules élémentaires ne doivent pas être confondues avec les testicules alimentaires.
Car l’ironie provocatrice de Houellebecq est incertaine – elle ne vise pas une cible précise, pour le plaisir de choquer ; elle s’adresse peut-être, en premier lieu à lui-même, criblé de contradictions comme la vie.
Et elle dit sa dépression permanente, mais constamment teintée d’humour. Le mot « dérision » convient assez bien car il inclut le rire, avec une dimension presque sacrée : la faculté, au bout du compte, de ne pas (trop) se prendre au sérieux, de rire. La dérision traduit bien son désespoir total et paradoxalement serein, presque poli. La dérision, et au bout la compassion. Pas le cynisme.
Et les malentendus viennent de là :
• Houellebecq misogyne ? Misanthrope sans doute, désespérément, mais nullement misogyne. Les femmes réduites à leur simple existence de « machines à jouir » ? Les propos les plus atroces, le plus souvent placés dans la bouche de Bruno, renvoient au règlement de comptes sordide avec la mère. Ils renvoient aussi à une évolution sociale incontrôlée, à un individualisme libertaire et exacerbé, où sous couvert de liberté on ouvre une compétition mortelle et biaisée entre les individus, où certains ne trouveront jamais ni leur place ni leur part et où les femmes seront presque toujours enjeux et victimes – à l’image du destin atroce de la trop aimante, trop humaine et trop belle Annabelle. Jeanne / Jane, la mère, elle-même, finit par être presque épargnée, et même à travers les propos du « monstre » Bruno : s’entourer d’hommes jeunes, c’était trouver sa place dans la compétition, alors que s’occuper des ses enfants l’aurait condamnée au rang des vieux, à balancer. On peut alors constater, simplement, indiscutablement, que nombre de pages sont un véritable hommage aux femmes, du don de soi absolu de la grand-mère à l’avenir du monde (très au-delà des slogans d’Aragon), jusqu’à une opposition explicitement formulée (« … plus aimantes, plus compatissantes … ») qui ne tourne certes pas à l’avantage des hommes, « qui depuis quelques siècles ne servaient plus, à peu près, à rien… » !
• De même pour son rêve d’une société future, inspiré par Huxley et par les découvertes de la génétique, avec une race nouvelle – souvent tenu pour un délire fascisant, façon « et on tuera tous les affreux », avec les représentants de la race ancienne, les barbares, relégués aux confins et appelés à prochainement disparaître. Là encore, c’est plutôt, de façon sans doute très naïve, l’inverse : rechercher un moyen, « une formule », pour empêcher les dégâts commis par l’individualisme occidental – source de conflits permanents, de séparation, accumulant les victimes au nom de la liberté. La société rêvée par Houellebecq, évitant la confusion entre reproduction et sexualité, libère (et pour tous !) cette dernière de la plus civilisée des façons.
Et avec l’immortalité en prime.
La critique doit évidemment s’interrompre – mais on doit sentir à présent que derrière la provocation, parfois énorme, l es Particules élémentaires développent des thèmes très profond – en particulier le drame de l’homme occidental, soumis à toutes les séparations – l’éclatement du groupe et de tous ses repères, la rupture entre le corps et l’esprit, entre la femme et l’homme, entre les individus en lutte perpétuelle.
Face au drame de la séparation, la seule réponse possible, selon Houellebecq, serait la disparition – celle du héros se confondant avec celle de l’humanité. La troisième partie est alors rédigée avec une écriture très sereine (à la différence des conversations et des épisodes très lourds de la seconde partie). Michel, le savant ultime, celui qui annonce la fin de l’humanité ancienne, choisit de disparaître en Irlande, du côté de Galway, à l’extrême pointe du monde occidental : « nous pensons aujourd’hui que Michel Djerzinski est entré dans la mer. »
Houellebecq lui-même a un temps vécu en Irlande. Mais il est par la suite rentré en France.
Son ironie porte aussi, évidemment, sur ses propres propositions.