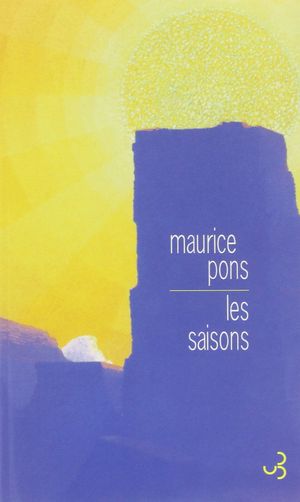«Il arriva par le sentier de la cluse, vers le seizième mois de l’automne, qu’on appelait là-bas : la saison pourrie.»
Sous des stries ininterrompues d’une pluie drue, Siméon, un étranger échappé des flammes de l’enfer, arrive dans un village hostile et boueux, au creux d’une vallée encerclée de montagnes.
Malgré la misère et l’agressivité des villageois, créatures hideuses et souvent estropiées, qui ont tous fermé portes et volets à son approche, il pose son havresac et, saisi d’une émotion naïve, veut voir dans ce village un lieu de grâce et de bienfaisance.
Siméon est lui aussi pathétiquement laid, mais il est porté par son espoir de devenir écrivain, et le seul objet immaculé dans ce bourbier de cauchemar est le beau papier blanc et satiné qu’il transporte. Mouton noir malhabile, les éléments vont se liguer contre lui, lui l'étranger inadapté qui prétend écrire, qui brûle de raconter sa vie, qui ose imaginer un destin pour son œuvre.
«Le brigadier, pressentant cette fois que la prise était de taille, s’appliqua à cerner davantage le suspect : il alla jusqu'à demander à Siméon « quelle sorte d’écriture il faisait ».
- Ce n’est pas facile de l’expliquer en deux mots, fit Siméon embarrassé – car dans la seconde même, il avait perçu une sorte de vision globale et cependant indéfinie du livre qu’il voulait écrire, avec la brûlure sombre de son soleil et l’ombre des cages sur le désert, avec la sable épars de sa musique aigüe, avec ses larmes, avec ce visage hagard, avec les cris de sa sœur Enina… et il entendait le chef du camp, dans sa soutane blanche, qui hurlait ses jurons démentiels : Crucifixus ! Alléluia ! Eleison !»
Rien ne nous sera épargné dans ce livre d’une noirceur totale. Dès la première phrase, et pendant seize mois d’automne et quarante mois de gel, «Les saisons» enfoncent le lecteur dans un univers de sauvagerie et d’incompréhension. On se divertit par moments de voir les habitants se réchauffer avec des animaux vivants attachés à leur taille, on sourit de la timidité naïve de Siméon, obsédé par une villageoise qu’il a entraperçue tandis qu’elle se baignait nue, mais quelques lignes plus tard, le bestiaire grotesque n’est tout à coup plus qu’atrocités et barbarie.
«Siméon, naturellement amène et sachant la déférence due aux vieillards, descendit prudemment la pente raide et détrempée et, s’approchant de l’entrée, se trouva en face d’un étrange spécimen humain – si peu humain en vérité que la première image qui lui traversa l’esprit fut celle d’une de ces tortues océanes dont on affirme qu’elles peuvent vivre deux cents ans. Mais peut-on imaginer une tortue coiffée d’un bonnet ? Il contemplait avec stupeur ce visage noir et crevassé, on aurait dit l’écorce d’un érable séculaire, dans lequel s’ouvraient faiblement deux petits yeux allongés comme ceux des reptiles. Les lèvres avaient complètement disparu à l’intérieur d’un pli du visage un peu plus marqué, un peu plus humide aussi, qui avait dû être une bouche. Siméon, qui avait pourtant connu de bien étranges horreurs, demeura à ce point fasciné par ce visage qu’il fut un long moment avant de s’apercevoir que la pluie qui ruisselait du talus entrait en force par-dessous la porte et que la vieille femme, assise sur sa chaise devant l’entrée, baignait dans l’eau, comme lui-même, jusqu’au-dessus des chevilles.»
Livre de l’espoir gangrené qui meurt, sombre questionnement sur la place de l’écrivain, éternel étranger, sur la possibilité d’écrire dans un monde insoutenable, ce roman épuisant publié en 1965 aux éditions Juillard et réédité par Christian Bourgois en 1975, incroyablement beau malgré la laideur du monde qu’il décrit, mérite sa réputation de roman culte et inoubliable.
Un livre à lire de préférence avec de grosses chaussettes, pour se prémunir d’éventuelles phobies pédieuses.
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/09/10/note-de-lecture-les-saisons-maurice-pons/