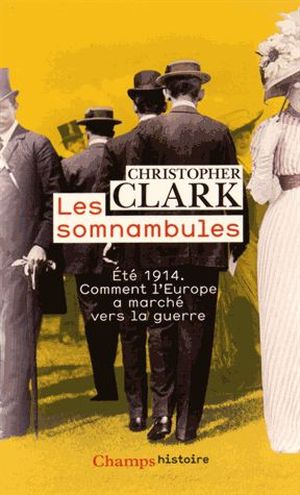Qui a déclenché la Première guerre mondiale ? Cette question est devenue une tarte à la crème pour illustrer la difficulté à analyser un objet historique aux causalités multiples (courtes ou venues du temps long).
L'ouvrage de Christopher Clark est arrivé au bon moment, alors qu'approchaient les commémorations du centenaire du déclenchement de la guerre, et il a fait un énorme tri pour tenter de reconstituer le contexte dans lequel s'est passé l'été 1914 et la chronologie des prises de décision.
Le principal apport, outre cette relecture très fine des sources, est la tentative de faire une sorte d'anthropologie des centres de décision de chaque puissance. Il en ressort plusieurs points :
- Les monarques ne jouaient pas un rôle décisif dans les prises de décision, tout au plus dans la gestion des carrières. Guillaume II, en particulier, était connu pour ses interventions malvenues et son administration veillait autant que possible à le corneriser. Au surplus, il était bravache mais freinait des quatre fers dès qu'une crise sérieuse se présentait.
- L'articulation entre monde militaire et monde civil était très différente d'un pays à l'autre. La France est le pays dans lequel l'armée est la plus soumise au monde politique. Ailleurs, des chefs d'armée peuvent prendre des initiatives, par exemple pour élaborer des plans de déploiement communs, etc... Ces deux mondes, le politique et le militaire, ne se comprennent pas forcément bien.
- La manière de sonder les intentions des autres puissances, et en particulier de ses alliés, est hautement aléatoire : cela repose sur des entretiens (d'où le rôle important de la personnalité et des convictions de chaque ambassadeur), mais aussi sur la lecture de la presse étrangère. Or beaucoup d'articles de cette presse sont "inspirés", c'est-à-dire écrits sur commande du pouvoir. En somme, chaque chancellerie vit dans une incertitude permanente sur les intentions de ses ennemis... et de ses alliés. Du côté de la Triple entente notamment, une obsession de la France et de la Russie est la fiabilité de l'Angleterre. De nombreuses initiatives s'expliquent par la volonté de sonder la fiabilité de cette dernière. Mais c'est aussi vrai des relations entre Autrichiens, Hongrois et Allemands.
La première partie, "Sur la route de Sarajevo", pose les bases de la question des Balkans, et notamment du panslavisme serbe et des tensions avec l'empire austro-hongrois. C'est exotique et passionnant.
La deuxième partie, "Un continent divisé", est d'intérêt inégal. Le chapitre 4, "les voix multiples de la politique étrangère européenne", est vraiment brillant et constitue, comme je l'ai dit, une véritable anthropologie de chaque chancellerie. En revanche les chapitres qui l'encadrent sont particulièrement touffus : ils reconstituent les évolutions qui amènent à la constitution de la Triple Entente et de la Triple Alliance, mais le degré d'analyse, qui pèse les calculs de chacun pour chaque crise, chaque petit pas en avant, est incroyablement touffu, compliqué et difficile à synthétiser. Je ne peux que saluer de loin l'acribie de l'analyse.
La dernière partie, "La crise", revient sur l'engrenage qui suit l'assassinat de Sarajevo (magnifiquement reconstitué). Avec plusieurs moments pivots, dont deux clé : l'ultimatum autrichien (mais il y a beaucoup à dire sur les réactions serbes et russes) et la mobilisation russe, dont la décision est prise dans une situation de quasi-panique par le tsar.
Bref, les somnambules est une relecture touffue et incroyablement documentée sur la crise de l'été 1914. C'est l'ouvrage d'une vie, de toute évidence. En revanche cela défie un peu la synthèse.