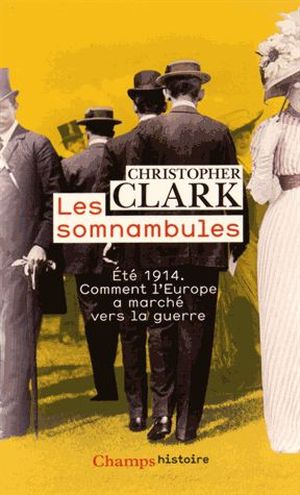Les Somnambules (The Sleepwalkers) est, sur le plan de la réalisation, un des meilleurs livres d'histoire qui m'ait été donné de lire : écrit dans un bel anglais, il excelle sur tous les plans, de la composition de petites vignettes narratives (comme celle de l'assassinat de la famille royale serbe en 1903, en ouverture du livre) à la conceptualisation, en passant par l'analyse des semaines haletantes de juillet 1914.
D'un point de vue intellectuel, il éclaire avec beaucoup de talent la complexité du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ch. Clark part d'une base méthodologique clairement exposée dans son introduction, et reprise en conclusion : il compte parler du “comment” plutôt que du “pourquoi”. Ce parti pris l'amène à dresser une histoire narrative et diplomatique de la genèse du conflit (qui nous éloigne beaucoup de la culture historique léguée en France par les Annales), qui souligne la contingence du conflit et sa “co-production” par une série d'acteurs. Cette approche n'exclut pas totalement les réflexions structurelles sur des “causes profondes” du conflit, auquel Clark fait parfois allusion (il évoque par exemple le parallèle entre les déliquescences chinoises et ottomanes, qui aiguisent toutes deux des rivalités impériales entre puissances européennes ; il note aussi qu'il serait “hard to overstate” [difficile de surestimer] l'effet historique de l'unification allemande).
Néanmoins, Clark préfère de loin insister sur le faisceau de causes du conflit à court terme — les anticipations relatives à la Russie (dont l'Allemagne craignait le renforcement, dont l'Angleterre redoutait une recrudescence d'ambitions orientales), l'arbitrage tardif fait par les Russes dans les Balkans parmi leurs clients locaux, au détriment de Sofia et au profit de Belgrade (lui-même lié à la politique des détroits), etc. Il note également le rôle des systèmes institutionnels nationaux dans les arbitrages souvent laborieux des grandes puissances (seule la France s'engage en guerre sans atermoiements ; a contrario, l'engagement décisif du Royaume-Uni n'est acquis que par les manœuvres du ministre des Affaires étrangères, d'abord mis en minorité sur le sujet au sein de son propre gouvernement). Cette préférence pour les causes immédiates donne aux questions balkaniques, et notamment serbes, une ampleur majeure dans le déclenchement du conflit, alors que d'autres sujets sont renvoyés de l'ombre (sept mentions seulement de l'Alsace-Lorraine). Il souligne enfin les importants aspects psychologiques du déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui lui confie son caractère profondément dramatique : climat d'opacité et d'ambiguïté des différents acteurs, qui a pu mener les uns et les autres au jusqu'au-boutisme (l'espoir étant toujours permis que tel ou tel n'interviendrait pas, en l'absence d'assurances officielles) ; déresponsabilisation de chaque acteur, toujours convaincu qu'il est contraint à prendre telle ou telle mesure par les autres.
Ch. Clark, en revanche, me semble ne pas suivre son programme méthodologique “officiel” sur un autre aspect : celui de la responsabilité. Clark rejette, au début comme à la fin de son livre, la pertinence même du débat sur la culpabilité des pays dans le conflit, ce qu'il traduit par une belle formule en conclusion : “The outbreak of war in 1914 is not an Agatha Christie drama at the end of which we will discover the culprit standing over a corpse in the conservatory with a smoking pistol. There is no smoking gun in this story; or, rather, there is one in the hands of every major character. Viewed in this light, the outbreak of war was a tragedy, not a crime.” (nonobstant le fait qu'on ne découvre jamais les coupables d'Agatha Christie avec une arme à feu entre les mains).
Pourtant, son récit dénote à de multiples reprises sa volonté d'une lecture révisionniste du conflit, dans laquelle les puissances centrales sont exonérées de leur responsabilité, laquelle est rejetée (dans l'ordre) sur la Serbie, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Cette approche n'est pas un problème en soi, et elle mène à de nombreuses analyses intéressantes. Par exemple, Clark montre que la perception partiellement erronée selon laquelle l'Autriche-Hongrie était un “deuxième homme malade de l'Europe” menait les autres puissances à négliger ses intérêts, ce qui a pu exciter son envie de fermeté en 1914. Il fait également une étude poussée des circuits de décision allemands, qui relativise très nettement la bellicosité des élites politiques du pays en 1914. Réciproquement, Clark souligne que de nombreux dirigeants français souhaitaient provoquer l'Allemagne à un conflit qui leur permettrait de récupérer l'Alsace-Lorraine, dans une inversion de la rouerie d'Ems.
À d'autres égards, la présentation de Clark est parfois tendancieuse. Ainsi, Clark décrit comme une “carte blanche” l'assurance donnée par la France à la Russie qu'elle la suivra dans une guerre austro-serbe… avant de critiquer l'usage d'un terme sémantiquement très proche, le fameux “chèque en blanc” donnée par l'Allemagne à l'Autriche le 6 juillet 1914. Dans le même registre, Clark critique à plusieurs reprises la certitude franco-russe selon laquelle l'État serbe n'aurait pas commandité l'assassinat de François Ferdinand (thèse qu'il confirme lui-même au début de son livre, sans en masquer les zones d'ombre), tout en défendant la légitimité du courroux autrichien contre la Serbie, y compris si celle-ci n'était pas l'instigatrice directe de cet assassinat. Il va jusqu'à comparer la défense russe de la souveraineté de la Serbie à ses vétos pro-syriens au Conseil de sécurité, ce qui est carrément malhonnête (le parallèle de l'Afghanistan ou de l'Irak, dans lequel des États étaient accusés de favoriser des activités terroristes dont ils se dissociaient officiellement, aurait été beaucoup plus pertinent).
Les Somnambules, malgré ces petits errements, reste un livre d'un très grand intérêt, qui suscite utilement la réflexion sur une période dont Clark a raison de rappeler qu'elle est plus proche de nous que jamais — l'Europe de 1914, multipolaire, traversée par les nationalistes et frappée par le terrorisme, ressemble étrangement au monde des années 2010.