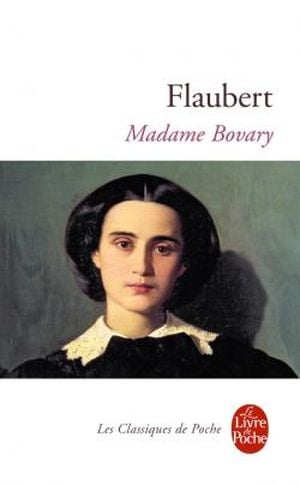Madame Bovary, c'est moi !
Délicieuse et savoureuse découverte cette lecture de Madame Bovary !
Mon premier Flaubert et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Je vais allonger la longue liste des critiques déjà présentent sur le site...
Je préviens d'emblée au futur lecteur de ma critique (alors on s'emmerde au point de lire ma critique ?) que s'il n'a pas lu le livre, cette critique ne lui apprendra pas grand chose, voire pas du tout, sur ce chef-d'œuvre qu'est Madame Bovary et cet immense auteur qu'est Flaubert. Je vais modestement et humblement exposer de façon succincte mon avis (oui c'est le but d'une critique, je suis si malin) sur Flaubert, la façon dont il m'a éblouit avec ce livre et puis je vais décortiquer un passage qui m'a énormément plu et en dire ce que j'en déduis avec mes faibles connaissances sur l'auteur et sur la littérature en général. D'où l'intérêt d'impérativement vous reportez sur une autre critique bien plus précise et analytique sur le style, le fond de Flaubert et l'énorme contribution à la littérature française, chose incontestable, qu'il a apporté. Je vous conseille d'ailleurs celle de Reno qui m'a épaté (non ce n'est pas de la vile flagornerie). Voilà, j'en ai fini avec ce petit préambule bien ennuyeux, je vous l'accorde volontiers ! Vous voulez vraiment lire la suite ? Vous êtes sûr ? Bon alors allons-y...
Il y a des lectures qui vous perturbent, vous troublent et vous empêchent d'avoir les idées claires. Vous vous réveillez pour relire un passage, vous replonger dans ce bain exquis, cette symphonie de mots que l'agencement, la sonorité de ceux-ci vous marquent au fer rouge et résonnent dans votre cerveau tel un lointain écho dans une vallée bornée et délimitée par les cours d'eaux des rivières où le lointain soleil se mire et contemple l'ineffable spectacle d'une contrée plongée dans la douceur. Elle-même dominée par la mélancolie et la volupté qui y règnent à l'unisson... Cette lecture fait parti de cet hasardeux aperçu.
Vous voulez continuer ? Quelle hardiesse !
Flaubert détruit la force d'imagination (ou la réduit au strict minimum) d'un livre avec ses nombreuses descriptions, c'est cela sa principale prouesse et elle m'a ébahi. C'est la première fois que j'aie lu un portrait aussi juste aussi complet de la dépression nerveuse par le truchement du personnage d'Emma Bovary. J'ai ressenti ça évidemment avec le Spleen de Paris de Baudelaire mais jamais ça avait été le cas dans un roman. Céline c'était la misère et la pauvreté à son paroxysme, avec Madame Bovary c'est l'insatisfaction permanente, les désirs et les passions constamment déçus. Emma vie plus à travers ses nombreuses lectures que dans sa propre vie (bon pour moi un véritable écrivain ne différencie pas la vie de la littérature, puisque que pour lui TOUT est littérature, petite digression), elle s'émancipe d'un quotidien fastidieux et sempiternel. Le passage avec le prêtre est assez éloquent et c'est d'ailleurs celui que je vais "analyser" avec mes piètres compétences et ma pathétique prétention à une "étude" psychologique.
Voici donc le fameux passage :
Emma dans une tentative désespérée de renouer avec le passé (elle a passé son enfance dans un couvent), un soir où l'intarissable réflexion sur sa vie pèse plus lourd que le plus grand des tourments, décide d'aller à l'église tout en se précipitant comme si cette dernière allait disparaître dans un tourbillon de ténèbres et qu'elle aurait ainsi perdu un des vestiges de son impénétrable passé. Harcelée de toutes parts par ses démons intérieurs elle espère trouver en la personne du curé une âme charitable, compatissante capable d'adoucir ses peines et ses malheurs. S'ensuit alors une conversation cocasse pour le lecteur et cruelle pour l'héroïne... En effet le curé ne dégage aucune empathie envers la bourgeoise infortunée ne comprenant pas les maux qui l'assaillent et la déboussolent. Chaque tentative où elle essaie, elle esquisse d'exprimer ses peines est avortée par l'évocation de malheurs plus grands comme la faim ou le froid. Dès lors une dichotomie évidente apparait pour le lecteur désœuvré (enfin c'était mon cas). L'ecclésiastique ne peut imaginer ou même concevoir qu'une personne jouissant d'un tel niveau de vie ; elle mange à sa faim, profite d'une maison bien chauffée en hiver... Puisse être malheureuse. Emma se trouve dans une impasse et même les souvenirs joyeux de son enfance, représentés ici par l'ecclésiastique et l'église ne peuvent l'aider dans sa langueur existentielle... Car elle souffre d'un mal être qui ne peut être vu distinctement, qui change son comportement, la conditionne et qui l'a rend plus vulnérable et sensible aux moindres de ses pensées destructrice tel un poisson (disons un saumon !) luttant contre le courant coercitif de la rivière. D'où ma conclusion qui n'engage que moi :
La pensée est un bienfait mais dans certain cas elle est également un démon et ce livre le prouve brillamment...