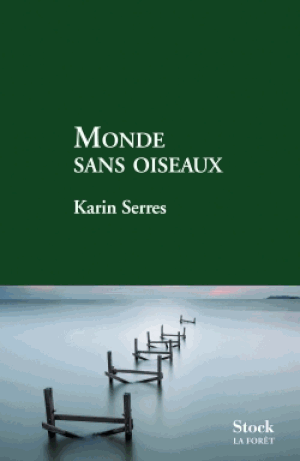À priori, Monde sans oiseaux n’est pas ma tasse de thé : une fille de pasteur appelée « Petite Boîte d’Os » en personnage principal, une syntaxe simple avec une narration au présent, un genre de nature writing à la française, ça sentait pas mal cette littérature contemporaine après laquelle je ne cours pas, et un peu la poésie facile des ateliers d’écriture… Je n’aurais peut-être pas songé à le lire sans la mention d’un « après le “Déluge” » en quatrième de couverture, qui m’a fait imaginer qu’il compléterait mes lectures de récits post-apocalyptiques de ces derniers mois (Mais je gardais un assez bon souvenir des deux autres livres de la collection « La Forêt » que j’ai lus, Y revenir et Regarder l’océan de Dominique A.)
Du reste, le court roman de Karin Serres n’entre pas vraiment dans la catégorie des récits d’après l’Apocalypse ; d’ailleurs, clin d’œil voulu ou non aux exigences du genre, le cannibalisme n’y est qu’une rumeur… Disons qu’en termes de nature massacrée et d’humanité à l’abandon, ce n’est pas pire que maintenant. Les oiseaux ont disparu à force d’être élevés n’importe comment ; des cochons transgéniques fluorescents, amphibies et autorégénérants forment le troupeau des figurants ; le village lacustre qui constitue le cadre de l’histoire est menacé par ce qu’on devine être, au loin, une urbanisation qui galope et aliène.
C’est sur cette toile de fond que la narratrice raconte sa vie, finalement celle de tout le monde : naître, mourir, et entre les deux faire ce qu’on peut. Pas plus compliqué que cela, ou alors faussement simple, parce qu’il faut y arriver, à faire tenir une vie en cent pages, en procédant par l’écriture à cette dissimilation entre le superflu et l’essentiel. Karin Serres y parvient : le lecteur de Monde sans oiseaux y lira non seulement plus que ce qui y est écrit, mais aussi plus que ce qu’il aurait pu lui-même écrire – à rebours d’une partie de la production littéraire, faite de détails inutiles et d’aphorismes écrits d’avance. « Et je reste orpheline, dans le village grouillant de cochons fluorescents. » (p. 96) ou « Toute cette machinerie sous nos peaux. Toutes nos peaux sous nos habits. » (p. 85) : pas besoin de plus.
Si tout avait l’allure de l’enterrement des pages 90-92, ce roman aux allures de conte serait un chef-d’œuvre, du niveau des Saisons de Maurice Pons, dont, sur la durée, il se rapproche assurément plus que du Roi des Aulnes (p. 17) ou de « la Belle au bois dormant » (p. 19). On y trouve les mêmes minimes décalages par rapport au réel qui finissent par donner au texte son étrangeté et son identité propres.
On pourrait même penser, pourquoi pas, à l’une de ces Vies minuscules de Pierre Michon.