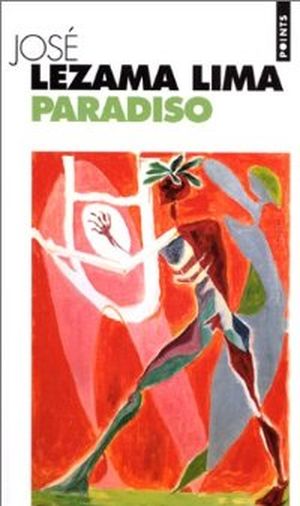10 juillet
20 juillet
(traduit de l'espagnol par Didier Coste)
Il faut se méfier car, Paradiso est bel et bien une forêt inextricable, où tous les mots sont vivants : ce qu'on pourrait prendre pour une branche ou une liane pourrait bien être un serpent, la forêt, comme l'écrit Alejo Carpentier*, cache des choses. Lima ne laisse que deux choix à son lecteur, contourne-moi, sans risque, ne me lis pas ou lis-moi sans me lire (il faut être disponible avec Lima). Ou bien, pénètre dans ma forêt et accepte de ne pas tout saisir. Oui Paradiso possède bien une langue qu'il faut apprendre à lire, sans trop hâtivement froncer les sourcils, "ça n'a pas de sens", "c'est du verbiage pédant"... en apparence cette langue pourrait paraître anarchique, confuse, embrouillé : elle est au contraire très articulée, comme un poème dont la beauté m'a par moments fait atteindre le nirvana. Encore que pas si souvent que je ne l'aurais voulu, le texte n'échappant pas à certaines périodes lénifiantes.
Je me suis laissé surprendre à la moitié du livre, complètement débordé par des discussions philosophiques à en perdre le nord. Quand on parle de "métissage" des cultures chez Lima, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et de là, le visage déjà monstrueux du récit se démultiplie, comme le cerbère. Je retiendrai cependant une chose qui me semble assez importante : la veine autobiographie de cette langue. C'est comme si le narrateur regardait le film de sa vie, et nous le décrivait en direct, très précisément, mais avec l’art de transformer tous ses éléments en beautés étrangères.
La plus proche amie de Rialta, cette Paulita Nuvias que nous avons vue chez elle, dans sa salle de bal, saluant le premier président de la république cubaine, était la fille de très riches marchands de tabac unis d'amitié aux Olaya pour des raisons de voisinages ; elle tenait à la main la tintante solution. Serré entre le pouce et l'index, le passe-lacet d'argent montrait l'impassible avidité de son hameçon. La perplexité qui se marquait sur le visage de Victoria rétrograda, fendue en deux par un éclair de joie. Lorsque plusieurs jours auparavant, parmi les préparatifs du trousseau nuptial, Mme Augusta, Rialgta et Paulita étaient allées acheter des bottines, elles avaient ri de leur petitesse et des invraisemblables faux pas qu'elles pourraient causer à la fin de la soirée des solennités, quand la corne d'abondance des choses à réaliser tend à se renverser sur l'étroite strangulation de l'instant.
PS : C'eût été drôle si le récit s'était arrêté une page plus loin.
665 pages – Seuil (Points)
- : Le partage des eaux, Alejo Carpentier
La forêt vierge était le domaine du mensonge, du piège, du faux-semblant ; tout y était travesti, stratagème, jeu d’apparences, métamorphose. Domaine du lézard-concombre, de la châtaigne-hérisson, de la chrysalide-mille-pattes, de la larve à corps de carotte, du poisson-torpille, qui foudroyait du fond de la vase visqueuse. Lorsqu’on passait près des berges, la pénombre qui tombait de certaines voûtes végétales envoyait vers les pirogues des bouffées de fraîcheur. Mais il suffisait de s’arrêter quelques secondes pour que le soulagement que l’on ressentait se transformât en une insupportable démangeaison causée, eût-on dit, par des insectes. On avait l’impression qu’il y avait des fleurs partout ; mais les couleurs des fleurs étaient imitées presque toujours par des feuilles que l’on voyait sous des aspects divers de maturité ou de décrépitude. On avait l’impression qu’il y avait des fruits ; mais la rondeur, la maturité des fruits, étaient imités par des bulbes qui transpiraient, des velours puants, des vulves de plantes insectivores semblables à des pensées perlées de gouttes de sirop, des cactées tachetées qui dressaient à un empan du sol une tulipe en cire safranée. Et lorsqu’une orchidée apparaissait, tout en haut, au-dessus des bambous et des yopos, elle semblait aussi irréelle et inaccessible que l’edelweiss alpestre au bord du plus vertigineux abîme. Mais il y avait aussi les arbres qui n’étaient pas verts, qui jalonnaient les bords de massifs couleur amarante, s’incendiaient avec des reflets jaunes de buisson ardent. Le ciel lui-même mentait parfois quand, inversant sa hauteur sur le mercure des lagunes, il s’enfonçait dans les profondeurs insondables comme le firmament. Seuls les oiseaux étaient vrais, grâce à la claire identité de leur plumage. Les hérons ne trompaient pas, quand leur cou s’infléchissait en point d’interrogation ; ni quand, au cri du vigilant coq-héron, ils prenaient leur vol effrayé dans un frémissement de plumes blanches.