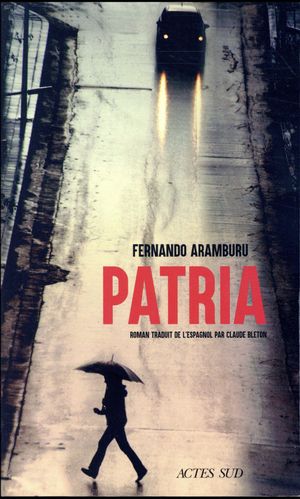Un soir d’octobre 2011. Dans la maison inoccupée depuis des années, un rai de lumière filtre sous la porte, un pot de géraniums apparaît au balcon. Il n’en faut pas plus pour que la rumeur enfle. Déjà, quelques jours auparavant, on l’avait aperçue qui descendait du bus quelques arrêts avant le village pour éviter d’être remarquée. Peine perdue puisque malgré l’heure tardive, elle avait croisé un groupe de vieux qui n’avaient pas manqué de la reconnaitre. C’est donc vrai : Bittori revient s’installer chez elle, à présent que l’ETA a décidé de déposer définitivement les armes.
Comme elle a changé, Bittori ! Les presque vingt ans qui se sont écoulés depuis la tragédie l’ont considérablement vieillie, évidemment. Sans compter tout ce qu’elle a enduré depuis la mort du Txato … mais au fond, les villageois n’ont-ils pas tous souffert de la lutte armée ? A commencer par Miren, l’ex-amie de toujours dont le fils moisit depuis plus de dix-sept ans dans une prison d’Andalousie – quel scandale à ses yeux que cet éloignement programmé par l’Etat pour saper le moral de ceux que personne ici ne songe à appeler des terroristes mais plutôt des combattants pour la liberté d'Euskal Herria.
Bittori et Miren : deux femmes au caractère bien trempé, complices depuis l’enfance, presque deux sœurs. Toutes deux ont failli prendre le voile, toutes deux ont fini par se marier la même année, en 1963, la première avec le Txato, patron d’une petite entreprise de transport, la seconde avec Joxian, ouvrier dans une fonderie. Des hommes taiseux, des maris conciliants, à l’esprit pratique qui partagent les mêmes plaisirs simples, jeux de cartes et randonnées à vélo. Basques, ils le sont par toutes les fibres de leur être : ils parlent l’Euskara et sont viscéralement attachés à leur terre et à leurs traditions. Mais le terrorisme viendra gangréner cette solide amitié. Joxe-Mari, le fils de Miren, acquis à la cause indépendantiste et prêt à embrasser la lutte armée, entre dans la clandestinité. Quant au Txato, il supporte de moins et moins le chantage financier que l’ETA lui fait subir et rechigne à payer l’impôt révolutionnaire. Tous ou presque en conviennent: le Txato est quelqu’un de bien, toujours prêt à donner un coup de main aux amis ou à embaucher un gars du coin quand c’est possible. Mais lorsqu’apparaissent les graffitis l’accusant de traitrise, le voilà traité en paria : les gens du village prennent leurs distances avec sa famille, certains par conviction, beaucoup par lâcheté. Jusqu’au jour où le Txato tombe sous les balles d’un commando terroriste auquel appartient Joxe-Mari. A la demande insistante de ses enfants, Bittori se résigne alors à quitter son village pour San Sebastian où même le Txato sera enterré pour éviter que sa tombe ne soit profanée. A présent, tous s’interrogent : pourquoi, après tout ce temps, est-elle revenue sur les lieux du drame ? Simple bravade, désir de vengeance ? Entre compassion et exaspération, les langues se délient et la mémoire revient à ceux qui, oublieux des victimes, auraient préféré tourner la page, une bonne fois pour toutes.
Si le roman a eu un impact considérable en Espagne, c’est parce qu’il s’attache à restituer sans langue de bois ce que furent les années de plomb du terrorisme basque, spécialement au cours des décennies 80 et début 90, lorsque la lutte antifranquiste a cédé le pas à la lutte anti-Espagne, dans un mécanisme de fuite en avant aussi radical que désespéré sur lequel, il est vrai, l’auteur ne s’appesantit guère. Séduits par la propagande de l’ETA, de nombreux jeunes aux motivations diverses (nationalisme romantique pour les uns, attrait pour la violence ou encore désœuvrement chez les autres) sont entrainés dans un conflit sanglant qui les élève au rang de héros ou de martyrs. A travers l’histoire de deux familles dont l’amitié vole en éclats, l’auteur analyse finement l’impact social et psychologique d’une guerre d’indépendance qui tout en prétendant libérer un peuple a enfermé les individus dans un carcan de déshumanisation, de souffrances, de haine et de rancœur, privant du droit au bonheur aussi bien les descendants des victimes que ceux des assassins. Il dénonce également sans complaisance aucune l’héritage du franquisme, fait notamment de violences policières, dont l’Espagne peine à se défaire encore aujourd’hui, ainsi que la propension toute espagnole elle aussi à jeter un voile d’oubli sur le passé plutôt que d’en affronter les démons.
La construction du roman peut paraître déroutante, surtout en début de récit : à travers un incessant va-et-vient de rétrospections et de retours au présent, les divers protagonistes (à savoir les deux couples et leurs enfants) apparaissent au lecteur à différents moments de leur existence, sans qu’on parvienne toujours à saisir la cohérence de ce puzzle informatif. Assez vite cependant, on comprend la volonté du narrateur de s’approcher le plus doucement possible des événements douloureux de l’histoire, d’en différer le dévoilement, créant de la sorte une habile tension dramatique. Et lorsque finalement nous assistons à la scène somme toute prévisible de l’assassinat du Txato, c’est pour mieux nous rendre compte que le véritable enjeu du roman est ailleurs. Et si Bittori n’était pas revenue au village pour se venger de ceux qui l’ont trahie dans le passé ou pour réclamer quoi que ce soit ? Pourquoi cette vieille femme qui se sait proche de la fin tient-elle tant à entrer en contact avec le fils toujours incarcéré de Miren, l'assassin présumé de son mari, celui que sa mère présente avec orgueil comme un exemple de fidélité à ses convictions nationalistes ? Serait-il possible qu’avant de mourir elle envisage d’accorder son pardon à ceux qui ont détruit sa vie pour peu qu’on le lui demande ? Quant à ceux qui se sont si longtemps fourvoyés, peuvent-ils arriver à renier le combat auquel ils ont sacrifié leur existence et accepter de remettre en question l’image idéalisée qu’ils se font d’eux-mêmes ?
Lorsque les armes se taisent enfin, le processus de paix et de réconciliation ne peut être bâti que sur la reconnaissance des fautes commises et sur le pardon accordé par des victimes auxquelles on a rendu leur dignité. Rien à voir avec la loi de l’oubli qui a trop souvent prévalu en Espagne – et qu’on retrouve d’ailleurs dans d’autres Etats tentés de refouler un passé dont ils ne sont pas très fiers. C’est donc bien un message d’une portée universelle que délivre ce roman bouleversant, si bien qu’il serait dommage de le croire réservé au seul public espagnol.