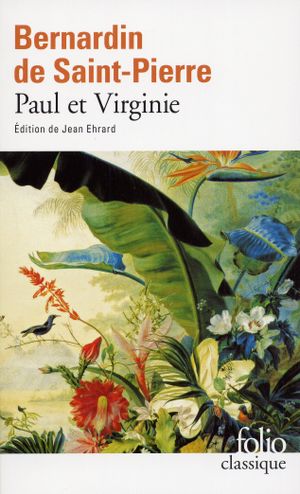Puisque Zola voulait, avec le Rêve, refaire Paul et Virginie, lisons Paul et Virginie. Il semble effectivement y avoir repris l’idylle amoureuse naïve et une sorte de théologie primitive, mais elles s’inscrivent ici dans un tout autre registre.
C’est le siècle des colonies et celui des Lumières qui s’exprime, dans cet extrait de voyages publiés par Bernardin. L’époque du mythe rousseauiste du bon sauvage, mis en scène à travers l’histoire de Paul et Virginie, deux français nés sur l’île de France (actuelle île Maurice), de mères respectivement pauvre et riche (l’inverse de chez Zola), et n’ayant connu au début de la vie que cette île, dans laquelle ils vivent comme de jeunes sauvages, heureux, gentiment amoureux, entourés des figures qui peuplent leur univers bien défini et idyllique, jusqu’à ce que Virginie doive retourner se faire une éducation en France, histoire d’apprendre les bonnes manières : déchirement pour Paul (le canevas initial, mais inversé, de Florence et René chez Brasillach, dans Comme le temps passe). L’occasion de se rendre compte d’à quel point c’est la civilisation qui est en fait sauvage, mais au-delà de ça il y a effectivement matière à réflexion : c’est en quittant son île lointaine, topos littéraire symbolique du bonheur sur terre, que Virginie expérimente la sauvagerie : c’est entourée de monde qu’elle ressent la solitude, et environnée de richesse elle est pauvre car ne dispose de rien, ne peut rien donner ni partager. Durant cet exil, Paul apprend la lecture et l’écriture pour être en mesure de communiquer proprement avec l’aimée : cette ouverture au monde, auparavant clos, le rend malheureux par l’excès de connaissances, de bribes de vérité que la culture lui apporte, in fine lui fait perdre un peu d’innocence.
L’innocence me semble être un grand sujet de l’histoire, thème auquel se greffent les idéaux du siècle et un éloge de la solitude et de la nature. Nature luxuriante, « amphithéâtre de verdure » crée par Paul au centre d’un bassin, île dans l’île, création de main d'homme d’un cosmos à soi, hors du monde et du temps ; descriptions abondantes de la nature par un Bernardin grand voyageur, qui voit peut-être en elle le théâtre de Dieu : plus vénérable que les Anciens, plus antique que l’Antiquité, la nature se substitue aux arcs de triomphe pour devenir le Temple où se chantent ses harmonies mêmes. Chateaubriand a dû beaucoup lire ce livre pour avoir écrit un peu plus tard les Natchez, et avoir repris l’idée aussi du récit entier raconté par un narrateur a posteriori, donnant l’illusion d’un mythe fabuleux. D’ailleurs, j’en profite pour raconter cette anecdote : après la parution et le succès énorme du livre, un propriétaire terrien avait fait construire sur cette même île, pour les touristes, le tombeau de Paul et Virginie, tombeau qui a été détruit en 1869 pour construire... une ligne de chemins de fer. Ou quand Zola eut le nez fin en prenant ce symbole pour figurer la destruction du vieux monde par le nouveau, par le progrès inarrêtable, fondamentalement insensible, donc inhumain.
Fond de stoïcisme dans la vision de la vertu et du bonheur et célébration de l’ataraxie ; description épique d’un ouragan ; éloge du monument de la nature dans une volonté de donner une mythologie à cette autre partie du monde, plus récente, dont l’Adam et l’Eve sont tout aussi tragiques que les nôtres par la désunion d’avec cette innocence perdue ; critique de la vénalité du temps et de la tiédeur du siècle devenu tellement mou qu’il n’a même plus les couilles de censurer les livres ; chanson d’une certaine transcendance par le recours à la sagesse du passé, car « les sages qui ont écrit avant nous sont des voyageurs qui nous ont précédés dans les sentiers de l’infortune » ; théologie primitive d’un Dieu dépouillé de sa glose et dont la grâce est directe ; dernière dignité de Virginie rappelant celle, réelle, du capitaine Delamare qui lors du naufrage du même Saint-Géran refusait de se jeter à l’eau pour survivre car ça impliquait de se déshabiller, ce qui n’eût pas été convenable d’autant plus qu’il avait des « papiers importants sur lui » (sic !) : il y a beaucoup de choses dans ce joli roman, naïf certes, mais dont la poésie reste touchante et qui de toute façon, par l’allégorie, a l’air de montrer aussi que la sensibilité, assimilée à la mièvrerie, n’est plus de ce monde. Roman qui commence éloquemment par l’évocation d’une ruine, celle des petites cabanes de Paul et Virginie, plaçant déjà l’histoire à venir dans son cocon mythique, une invitation d’emblée à la méditation ; et invitation à laquelle nous nous rendons avec plaisir, pour accompagner ce texte d’épanouissement d’un genre, la pastorale, et en même temps la clôture « crépusculaire du siècle », et dont le caractère pessimiste, voire tragique dans les destinées d’abord heureuses des héros, donne à voir souvent, après ses teintes dorées de zénith, ses couleurs de crépuscule.