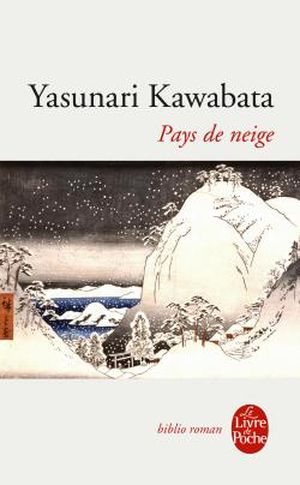Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/08/pays-de-neige-de-yasunari-kawabata.html
PAS LE MOMENT, OU PAS POUR MOI ?
De Kawabata Yasunari, le premier Prix Nobel de Littérature japonais (en 1968 ; le second serait Ôe Kenzaburô en 1994), je n’avais lu pour l’heure que Les Belles endormies, très beau roman d’une plume délicate et sensible, qui atténuait le sordide apparent des situations jusqu’à en exprimer les émotions les plus pures avec une élégance admirable. Les Belles endormies est bien un des chefs-d’œuvre de l’auteur – et peut-être son texte le plus connu en France ?
Mais, au Japon comme ailleurs, quand vient le moment d’envisager dans son ensemble le travail de l’écrivain, c’est peut-être un autre roman, antérieur (en fait, mais sous sa première forme seulement, j’y reviendrai, il s’agissait du premier roman de l’auteur, autrement célébré pour ses récits courts et éventuellement très courts, qu’il désignait comme ses Récits de la paume de la main), qui est cité de préférence : Pays de neige. Il figurait sauf erreur parmi les premières traductions de l’auteur, en anglais comme en français – et sans doute dans d’autres langues. En 1968, le Comité Nobel s’y est particulièrement attardé : si le prix récompense une carrière dans son ensemble, il est bien parfois des œuvres individuelles qui se singularisent dans l’argumentaire du jury, et il semblerait que Pays de neige ait été dans ce cas, même si d’autres œuvres de Kawabata avaient bien sûr été mentionnées en cette occasion (mais, bizarrement ou pas, Les Belles endormies n’était pas du lot).
Il me fallait donc lire ce roman, d’une importance cruciale, non seulement dans la carrière de l’auteur, mais probablement bien au-delà, dans l’histoire de la littérature japonaise, voire mondiale. Hélas… Je suis passé complètement à côté, ou peu s’en faut. Ce compte rendu, j’imagine, va dès lors témoigner d’une certaine gêne, à chaque instant ; il va me falloir tenter d’expliquer pourquoi ce roman sans doute très bon et même mieux que ça en tant que tel ne m’a pas parlé…
Pour une approche « objective », je vous engage donc à fouiner par ailleurs, vous ne manquerez pas de tomber sur des articles tout à fait intéressants et autrement positifs, donc autrement pertinents : par exemple, voyez ici, ou peut-être ici, ou encore là, un article cette fois plus ciblé, portant sur la fin du roman, et qui emprunte énormément aux travaux de Cécile Sakai, laquelle a beaucoup écrit sur Pays de neige en particulier et Kawabata en général ; les sources à privilégier se trouvent dans ce genre d’articles, certainement pas ici.
Mais moi ? Eh bien, ça n’a pas pris. Je vais tâcher de le développer par la suite, mais l’idée, c’est que je pense être, dans une certaine mesure, en état d’envisager « rationnellement », « intellectuellement » peut-être, ce qui fait le brio de cette œuvre, mais sans m’être jamais senti impliqué « émotionnellement » ; et c’est un fâcheux paradoxe, j’imagine, parce que, à bien des égards, le très poétique roman de Kawabata, dans son épure et son « faux inachèvement » (en fait sa quête acharnée de la perfection littéraire sous la forme de l'épure et de l'ellipse), devrait probablement parler d’abord à l’émotion, ensuite seulement à la raison.
Mais cela n’a donc pas marché sur moi. Peut-être n’était-ce pas le moment ? Ou peut-être, au regard des thèmes, très prosaïquement la dimension sentimentale du récit, ce livre n’était-il tout simplement (rien n’est simple...) pas pour moi ? Il peut y avoir de ça – et d'autres choses encore, sans exclusion. Je ne sais pas.
Je sais que je n’ai pas apprécié ce roman quand tout aurait dû jouer pour me le faire apprécier, et c’est un constat assez pénible…
UNE ŒUVRE SANS CESSE REMANIÉE EN QUÊTE DE PERFECTION
Ainsi que plusieurs œuvres de l’auteur, Pays de neige emprunte au moins pour partie à l’autobiographie de Kawabata, qui avait alors passé quelque temps dans une station thermale (onsen) du nom de Yuzawa, dans la province d’Echigo – montagneuse et froide. Là, il a notamment fait la connaissance d’une geisha du nom de Matsuei, qui lui aurait inspiré le personnage de Komako dans son roman. Quoi qu’il en soit, Kawabata a passé quelque temps à Yuzawa, clairement la « source », si j'ose dire, de la station thermale qui demeure anonyme dans Pays de neige, et il a même commencé à écrire son roman sur place (pour l’anecdote, la chambre qu’il occupait là-bas est devenue aujourd’hui peu ou prou un « musée » honorant cette histoire, ce qui en dit long je suppose sur la portée du roman de Kawabata).
Mais il faut d’emblée apporter un bémol à cette idée d’un « roman ». En effet, comme Les Belles endormies un quart de siècle plus tard, Pays de neige a d’abord été publié en revue, plus ou moins sous la forme de nouvelles ; ce n’est qu’ensuite que ces récits ont été rassemblés pour constituer un roman – en l’espèce, le premier de l’auteur. Les premiers textes constituant Pays de neige paraissent ainsi dès 1935, et le premier volume rassemblant ces « nouvelles » qui n’en étaient plus vraiment, en 1937. Mais Kawabata, après une pause de trois ans seulement, y est revenu : en 1940 et 1941, il publie de nouveaux « chapitres » sous la même forme ; en 1946, il révise complètement la fin du roman, en synthétisant deux de ces nouveaux récits ; en 1947, il y ajoute encore un « chapitre », et le roman ne paraît donc dans sa forme « définitive » qu’en 1948, soit treize ans après la publication du premier fragment de Pays de neige, et onze ans après la première mouture du roman en volume. C’est sur la base de cette « ultime » version que la traduction française a été faite, en 1960 (en collaboration ; j’avoue être un peu perplexe devant la présentation de la contribution de chacun en page de garde : « roman traduit du japonais par Bunkichi Fujimori, texte français par Armel Guerne »).
« Ultime » version ? Eh bien, pas tout à fait… Car Kawabata y est revenu une toute dernière fois, quelque mois à peine avant son suicide, en 1972. Il a alors considérablement abrégé Pays de neige… au point qu’il ne consistait plus qu’en quelques pages, bien loin du format romanesque ! En fait, c’était sans doute pour lui l’occasion de réduire son roman aux dimensions d’un de ses Récits de la paume de la main…
On comprend combien cette œuvre importait à Kawabata lui-même, un auteur en quête de la perfection ; il lui fallait y revenir, jusqu’à aboutir à cet état de 1948 qu’il jugea enfin « satisfaisant » ; j’imagine cependant que l’entreprise d’abréviation ayant précédé immédiatement ou presque le suicide de l’auteur est à sa manière plus éloquente encore…
Mais cette perfection ne joue certainement pas de la carte vulgaire de l’épate – bien au contraire, c’est d’épure qu’il s’agit ici. Kawabata coupe pour s’en tenir à l’essentiel, avec élégance et discernement, et cela contribue sans doute à la réputation du roman, que l’on a souvent comparé, et semble-t-il plutôt à bon droit, pour une fois, à un haiku. À vrai dire, Kawabata lui-même y fait quelques allusions dans le roman, et l’entreprise des Récits de la paume de la main, parallèlement, n’est sans doute pas sans évoquer l’art de Bashô et compagnie (auquel je suis totalement hermétique – c’est bien le problème…).
Mais un autre aspect de cette épure, plus singulier peut-être (mais semble-t-il typique de l’œuvre de Kawabata ?), doit probablement être mis en avant, et qui est le « faux inachèvement » du roman ; « faux », à l’évidence, tant le travail acharné de l’auteur témoigne bien de ce que Pays de neige a été longuement muri, réfléchi, repris, pour toucher enfin à la « perfection » (ou à cet état jugé « satisfaisant » par l’auteur) ; à ce compte-là, c’est tout sauf une œuvre « inachevée » ! Ce qu’il faut entendre par-là, c’est la nature délibérément fragmentaire du récit : même s’il a un début clairement identifié en tant que tel (mais peut-être pas sans ambiguïtés pour autant, et j’y reviendrai), et, du moins à partir des révisions des années 1940, une conclusion qui sonne bien comme une conclusion, l’impression d’ensemble demeure pourtant celle d’un roman que l’on aurait très bien pu prendre en cours de route, et dont la fin ne répond pas aux questions du lecteur, voire l’amène à s’en poser davantage encore – dans une impression (seulement ?) d’indécision que l’on pourrait trouver frustrante, mais qui, là encore, est sans doute murement réfléchie ; en fait, l’histoire pourrait se poursuivre au-delà – elle ne le fait pas, mais elle le pourrait… De même qu'elle aurait pu commencer avant. Et, entre la première et la dernière page, la narration procède en outre souvent par ellipses, éventuellement compliquées par un jeu temporel subtil, où le passé et le présent ne sont pas toujours bien aisés à distinguer (délibérément), et s’enchaînent sans vraie causalité. Le procédé d’écriture du roman, puis ses multiples remaniements, appuient encore davantage sur cette dimension.
LE VOYAGE DE SHIMAMURA
L’ouverture du roman est parfaite – même si la suite ne m’a pas parlé, la qualité de cette introduction ne fait aucun doute à mes yeux (en fait, ça a pu peser dans ma déception par la suite, où je n'ai rien trouvé d'aussi fort, ou du moins ai-je eu cette impression). Nous sommes dans un train qui franchit un tunnel de montagne. Il vient de Tokyo, et se rend à une station thermale anonyme située dans une région que l’auteur n’appelle sauf erreur jamais autrement que « Pays de neige » ; en notant que la neige y est certes abondante en hiver, quand les touristes viennent pour le ski, mais nous aurons l’occasion de visiter la région en d’autres saisons, pour d’autres activités, comme la randonnée – outre, bien sûr, le seul statut d’onsen qui justifie bien que malades et bien-portants s’y rendent pour prendre soin d’eux.
À bord de ce train, un voyageur est interloqué par une scène qu’il ne perçoit que dans les reflets de la vitre – une jeune femme qui prend soin d’un jeune homme fort malade, et elle y met beaucoup d’attention. L’aura de mystère entourant la séquence séduit notre homme, sans qu’il comprenne bien pourquoi, si ça se trouve.
Cet homme, c’est Shimamura, un dilettante entre deux âges, qui vit à Tokyo avec femme et enfants ; parce qu’il lui faut bien faire quelque chose, il est devenu, de manière autodidacte, un spécialiste du ballet occidental, qui le fascine. Mais c’est aussi un homme qui apprécie de quitter régulièrement la grande ville, pour apprécier dans la nature la beauté et la pureté – et d’autres choses aussi sans doute, car notre bon père de famille fréquente volontiers ces dames de la station thermale (ce qui n’a absolument rien de choquant, ne pas s’y méprendre).
Nous n’avons pas besoin d’en savoir davantage – même si des traits de personnalité seront progressivement esquissés, qui en font un homme parfois arrogant, mais sans doute bien moins cynique qu’il le prétend, en même temps, un esthète aussi, un homme en quête de pureté, porté à la contemplation et à l’auto-analyse de ses sentiments, et, fait sans doute significatif, récurrent dans la littérature japonaise d’alors, un intellectuel déchiré entre tradition et modernité, Japon et Occident – ce en quoi il peut être un écho de Kawabata lui-même, fin connaisseur de la littérature occidentale et dont l’approche de la littérature japonaise s’affichait moderniste, mais en qui le sentiment passionnel du Japon traditionnel a sans doute toujours été présent, même sur un mode éventuellement douloureux (ce qui a pu expliquer son positionnement politique dans les années 1940, quand il a soutenu le militarisme ultranationaliste ? Mieux vaut ne pas trop m’avancer sur ce terrain, je n’en sais rien, au fond).
Au-delà, qu’importe ? Shimamura sera notre point de vue, et nous nous pencherons sur ses amours au fil de trois voyages à la même station, en trois saisons différentes, et pas forcément dans un ordre linéaire, printemps, automne et hiver.
KOMAKO, (ONSEN) GEISHA
Car Shimamura entretient dans le « Pays de neige » une liaison compliquée avec Komako, une geisha – inspirée donc par une certaine Matsuei bien authentique, que Kawabata avait rencontrée à Yuzawa. « Geisha » est un terme propice aux confusions… D’autant plus que le contexte du roman complique la donne, en fait ; ceci dit, il n’est jamais explicite à cet égard, car il n'en a sans doute pas besoin (a fortiori pour un lectorat japonais ?), mais tentons quand même d’en dire un mot ou deux.
Contrairement à l’image souvent répandue en Occident, une geisha n’est pas au premier chef une prostituée ; si l’institution a ses non-dits (à propos dans pareil roman d’allure elliptique), et entretient de longue date des relations éventuellement troubles avec la prostitution, il n’en reste pas moins qu’une geisha est d’abord une « dame de compagnie » ; elle se doit d’être cultivée et raffinée, à même de soutenir une conversation pointue notamment en matière artistique, et de faire elle-même la démonstration de ses talents en ces matières, en composant de la poésie, en dansant, en chantant, en jouant du shamisen (surtout ?), etc. Le statut traditionnel de la geisha n’exclut pas la possibilité pour elle d’offrir des prestations d’ordre sexuel, mais cela ne va pas de soi, cela n’a rien d’une nécessité ; et, quand c’est le cas, c’est le plus souvent dans le cadre d’une relation suivie avec un unique client, etc.
Toutefois, le statut de Komako est rendu compliqué par le fait qu’il s’agit en fait d’une onsen geisha, « onsen » désignant les stations thermales. Ces geishas d’un genre bien particulier n’avaient pas forcément grand-chose à voir avec les dames très raffinées que l’on pouvait fréquenter dans les quartiers appropriés de Kyôto ou Ôsaka – on les considérait comme se trouvant tout en bas de l’échelle des geishas, échelle obéissant à un principe hiérarchique strict semble-t-il assez typique des mentalités japonaises d’alors (voir éventuellement Le Chrysanthème et le sabre, de Ruth Benedict – avec des pincettes, hein). En fait, les concernant, le qualificatif de « prostituées » était bien plus à propos – et personne ne se leurrait à leur sujet. Il semblerait que ce soit devenu plus vrai encore après la guerre – et l’occupation américaine… Aujourd’hui, quand le terme est employé au Japon, c’est le plus souvent comme un euphémisme pour « prostituée ».
Mais le roman se situe au milieu des années 1930, à une époque où les geishas ne sont plus si nombreuses – et, même dans ce contexte, Komako n’est pas non plus une onsen geisha comme une autre. Déjà, sauf erreur, elle n’est pas une geisha itinérante, contrairement à la plupart des onsen geisha, mais est attachée à cette station précisément du « Pays de neige », même si son hébergement chez la « maîtresse de musique », d’emblée, traduit l’ambiguïté du statut du personnage. Mais, surtout, elle fait parfois preuve d’un raffinement qui la hisse régulièrement au niveau des « vraies geishas » ; ainsi, c’est une artiste accomplie, très douée pour le shamisen (même si elle a appris à jouer de cet instrument typique de manière guère orthodoxe – en lisant des partitions et en écoutant des disques ; en fait, ce « modernisme » a son importance dans le roman, indubitablement, et il entre en résonance avec la passion autodidacte de Shimamura pour le ballet occidental). Mais ce raffinement doit sans doute être relativisé à d’autres égards – Komako ivre, et cela lui arrive plus qu’à son tour, n’est sans doute pas d’une dignité exemplaire… Elle est essentiellement atypique.
UN COUPLE ÉPHÉMÈRE
Mais, justement, il serait vain de vouloir réduire le personnage de Komako à une étiquette « professionnelle » : c’est bien parce qu’elle est vivante et complexe qu’elle séduit Shimamura. Leur relation amoureuse est en fait passablement ambiguë – et, si le roman ne se montre jamais explicite, on sait néanmoins que la geisha se prostitue, cela n'a rien d'un mystère. Pour autant, les rapports entre les deux personnages ne se limitent pas à des passades tarifées – ils échangent beaucoup, même si sans doute de manière bien différente lors de chacun des trois séjours de Shimamura dans la station.
Le début du roman, après l’arrivée via le train débouchant du tunnel, ne correspond pas à la première visite de Shimamura – celle-ci, nous y reviendrons ensuite. Dès lors, nous commençons en fait avec le retour du dilettante, désireux (mais tant que ça ?) de retrouver la geisha qu’il n’avait sauf erreur guère fréquentée qu’une nuit lors de ce son précédent voyage. Ce qui introduit un biais dans la narration, car il y a de la sorte d’emblée des attentes, même si plus ou moins conscientes, de part et d’autre dans ce couple de circonstances – et des reproches qui fusent, bien vite, et autant de suppliques. La passion, au-delà de ces fantasmes de relation davantage suivie qui semblent alors lutter contre les contingences et la froideur nécessaire ou supposée de l’autre, la passion donc est probablement l’apanage de la rencontre, lors du premier séjour, à la brièveté fondamentale ; le troisième et dernier voyage, d’autant plus chargé de rancœur, conduira le couple à « finir » (avec le bémol mentionné plus haut du « roman pris en court ») comme il était destiné à finir dès le départ – dans l’échec et la ruine… sinon la folie et la mort.
Du côté de Komako ? Car, en ce qui concerne Shimamura, plus désinvolte, une forme de révélation ou illumination sera peut-être en définitive de la partie – alors que la Voie Lactée, au-dessus de la grange incendiée, semble se fondre en lui, ou le contraire. Le dilettante prend conscience de sa place dans l’univers, principe supérieur extrait de la sphère de la contingence, quand tout autour de lui, la fin de sa relation avec Komako comme l’incendie dramatique de la grange muée en cinéma, exprime en dernier recours la beauté, même triste, de l’éphémère – mono no aware ?
Mais le roman repose donc énormément sur l’ellipse et le non-dit, outre qu’il y a cette idée d’une histoire prise en marche et dont on sort alors qu’elle pourrait encore se poursuivre (même si la scène de l’incendie justifie assurément le point final). Probablement faut-il aussi y ajouter une part de comédie ? Tout cela rend plus difficile l’interprétation des sentiments de l’un et de l’autre, car ils avancent avec des masques, consciemment ou non.
Je crois que c’est un aspect du roman qui peut expliquer mon absence d’implication : pas l’ellipse à proprement parler, mais ce qui en ressort par défaut ? Le fait est qu’aucun des deux personnages ne m’a paru sympathique – Komako en fait trop, dans un registre misérabiliste et capricieux, inconstante dans sa force comme dans sa fragilité ; Shimamura n’en fait pas assez, en bon bourgeois guère porté à prendre en compte les conséquences de ses actes sur un monde extérieur qu’il s’asservit sans y penser à deux fois.
Tous deux peuvent se montrer cruels, d’ailleurs – même si le roman incite à relever cette cruauté essentiellement chez le Tokyoïte fortuné, inconséquent et qui ne s’attache pas. Cette cruauté, en d’autres circonstances, aurait pu m’aider à m’immerger dans le roman (probablement davantage que la seule beauté, et bien davantage encore que la seule pureté), mais, pour je ne sais quelle raison, cela n’a pas été le cas, hélas. Échanges plaintifs et lourds de rancœurs, et scènes de ménage plus ou moins franches, plus ou moins sensées, « va-t’en, ne t’en vas pas », par contre, ont bien fini par me sortir du roman, à la limite de l’agacement…
Mais il s’agit donc d’un avis très personnel – comme tel, je serais incapable d’en dériver une quelconque argumentation. Si cet avis témoigne d’une chose, ce n’est certainement pas de la faiblesse du roman, mais bien de mon désintérêt pour le sujet, tout personnel – et que la finesse et l’élégance de Kawabata n’ont pas suffi à m’y intéresser.
DANS L’OMBRE, YÔKO ET YUKIO
Cette histoire d’amour et de rancœur, finalement assez prosaïque au-delà du traitement formel soigné de Kawabata, se complique cependant, et d’une manière tout particulièrement elliptique, en faisant intervenir deux autres personnages dont nous ne saurons quasiment rien, et pour cause : telle est d’une certaine manière leur fonction.
Nous retournons à la très belle ouverture du roman, avec Shimamura observant dans la vitre les reflets de la jeune fille prenant soin d’un jeune homme visiblement très malade. Cette jeune fille, dont nous apprendrons par la suite qu’elle se nomme Yôko, exerce en fait sur Shimamura une fascination dont il ne fait pas mystère, y compris auprès de Komako, avec une absence de tact marquée : il s’étend volontiers, en pensée d'abord, puis également en paroles, sur le charme incroyable de son visage, mettons, ou bien de sa voix – qui le plonge même dans une sorte de transe… Mais nous ne savons donc presque rien d’elle. Dans plusieurs critiques je l’ai vue qualifiée à son tour de geisha, mais je ne crois pas que le roman l’exprime jamais, j’ai même plutôt l’impression qu’il dise le contraire ?
La seule chose que nous savons – mais c’est le genre de savoir qui relève finalement de l’ignorance –, c’est qu’elle est liée à Komako, via la « maîtresse de musique », et surtout son fils souffrant, Yukio (dont le nom même renvoie à la neige, je suppose qu'il n'y a pas de hasard). Il semblerait que Yukio et Komako aient été fiancés, mais c’est du passé, et c’est maintenant Yôko qui s’occupe du jeune malade. La relation entre les deux femmes n’en est que plus compliquée, car la jalousie, latente concernant Yukio, se reporte sur Shimamura, en même temps que les deux femmes se voient sans cesse rappeler qu’elles sont liées par la tragique destinée du malade. Dans une des scènes les plus fortes du roman (car il en est bien quelques-unes qui m’ont parlé, oui), nous voyons Yôko rejoindre Komako à la gare, où cette dernière avait accompagné Shimamura repartant pour Tokyo, et annoncer à la geisha que Yukio est sur le point de mourir – il lui faudrait venir à son chevet… Or il semblerait que Komako ne le fasse pas, et c’est un sujet qui reviendra lors de l’ultime séjour de Shimamura dans le « Pays de neige ». La fin du roman, toutefois, reviendra sur la relation entre les deux femmes, qui vaut bien sans doute, en termes de non-dits, la relation entre Komako et Shimamura.
LECTURES DIVERSES, ET MÊME CONTRADICTOIRES
Certaines interprétations, en fait, y accordent une importance toute particulière. Car Pays de neige, si elliptique, n’est pas un roman dont la signification profonde coule de source. On peut l’interpréter de bien des manières différentes, concurrentes ou même contradictoires, et la littérature critique à ce sujet a l’air conséquente – mais je n’y ai donc pas accès.
Certains éléments ont été avancés plus haut – concernant notamment la fin du roman, tardive donc, avec l’incendie de la grange (d’aucuns ont voulu y voir, dans le dernier état du roman, une allusion de Kawabata aux ravages de la guerre et de la défaite ; en 1945, l’auteur, durement affecté par la capitulation, disait « ne plus vouloir écrire que des élégies » ; cependant, le premier état de la scène de l’incendie date semble-t-il de 1940-1941, et Kawabata a avancé que cette idée était encore antérieure – une raison essentielle au remaniement du livre, qui lui paraissait bel et bien « inachevé » avant cela, car sa fin ne répondait pas vraiment à son début) ; or ce drame doit être associé avec l’illumination de Shimamura, devant le spectacle aussi intimidant que beau de la Voie Lactée.
Mais d’autres approches sont envisageables. L’une, notamment, me séduit, sans que je puisse juger de sa pertinence (il aurait fallu, pour ce faire, que je m’implique bien davantage dans ma lecture de Pays de neige) : celle qui, sur une base de roman initiatique, relève d’une certaine manière du fantastique ? À moins qu’il ne s’agisse plutôt, ou seulement, d’une allégorie ? On qualifie parfois l’œuvre de Kawabata comme étant portée sur « l’onirisme », du moins… Et l'irréalisme est sans doute de la partie dans ce roman.
L’idée serait en gros que Komako et Yôko sont deux « étapes » d’une même femme, tandis que Shimamura et Yukio sont deux « étapes » du même homme. Si nous revenons à l’introduction du roman, nul besoin de chercher midi à quatorze heures pour deviner une dimension au moins symbolique dans ce train qui débouche d'un tunnel pour arriver au « Pays de neige ». Que Shimamura observe la scène entre Yôko et Yukio dans le reflet de la vitre fait aussi sens à cet égard – et j’imagine que l’on pourrait en dire autant du jeu temporel non linéaire sur les saisons, compliquant encore la donne dans le champ si essentiel dans le roman de la remémoration ?
Peut-être Shimamura est-il Yukio qui s’extériorise, à moins ce que ne soit prendre les choses à l’envers. On pourrait à vrai dire être tenté d’en faire une lecture « biercienne », où le « héros » serait en fait mort dès le départ ? On a d'ailleurs pu faire remarquer que le roman, en plusieurs scènes, emprunte aux thèmes et procédés du théâtre nô, où la visite aux morts, voire leur présence, est un motif récurrent.
Quant à Yôko et Komako, leur caractère à la fois si proche et parfaitement irréconciliable est éclairé sous un nouveau jour, de la sorte – et ce jusqu’à la fin, dans l’incendie, où leur lien s’exprime avec une force autrement contenue jusqu’alors, dans un ballet tragique où la mort et la folie sont les deux faces d’une même pièce…
Ces idées me plaisent bien – mais elles n’épuisent certainement pas les possibilités d’interprétation du roman, sur un mode éventuellement moins outré. Éventuellement de manière très japonisante, par exemple – haiku et mono no aware, donc… Et la scène finale de l’incendie n’est pas moins propice aux interprétations divergentes que l’introduction dans le train.
COULEURS ET CONTRASTES
Mais sans doute serait-il vain de vouloir dissocier fond et forme, ici – ce qui implique le traitement très artistique d’une multitude de notions complexes, de l’amour à la mort en passant par la nature, la beauté et la pureté.
Un procédé récurrent pour la mise en scène du récit et de ces thématiques repose sur un savant jeu de contraste entre les couleurs, qui évoque la peinture. On a pu parler d’ « impressionnisme », avec sans doute les non-dits en tête, mais, dans un contexte strictement japonais, on pourrait remonter aux estampes ukiyo-e, ou « images du monde flottant », comme par exemple celles de Hiroshige, dont Montagne et mer a fourni le détail de la couverture de cette édition. Quoi qu’il en soit, ce jeu entre en résonance avec les attributs marqués des saisons japonaises qui se succèdent (au cinéma, bien plus récemment, c’est par exemple ce que Kitano Takeshi a fait avec Dolls).
Deux couleurs, cependant, doivent probablement être mises en avant, qui sont le blanc et le rouge – en tant que telles chargées de significations implicites. La neige, bien sûr, fournit un fond blanc d’importance – même quand la neige n’est pas là, la station thermale paraît ne vivre que dans l’attente du jour où elle reviendra. Les thématiques liées de la beauté et de la pureté en découlent tout naturellement, au fil de descriptions où la nature sauvage triomphe, et lave symboliquement Shimamura de la crasse tokyoïte. Mais il n’est sans doute pas innocent que Komako apparaisse tout d’abord dans un kimono d’un rouge éclatant, autrement connoté, et tranchant plus qu'aucune autre couleur sur ce blanc qui a en même temps quelque chose de morbide.
En fait, ce contraste entre le rouge et le blanc en appelle un autre, tout aussi marqué dans le roman, entre la chaleur et la froideur : on se prémunit de l’hiver rigoureux avec mille méthodes pour chauffer les pièces et ceux qui les occupent, et que Kawabata décrit avec un luxe d’attention ; mais, bien sûr, ces deux attributs de la température extérieure entrent à leur tour en résonance avec les sentiments et les comportements de Komako et Shimamura – tous deux tour à tour froids et enflammés.
L’ensemble produit par ces couleurs et ces contrastes résulte en un tableau, ou une série de tableaux, à laquelle ellipses et non-dits confèrent par défaut le mouvement.
À CÔTÉ…
Tout ne devrait alors être que beauté, sublimée par une plume toute en économie, dont l’élégance consiste à s’effacer quand il le faut. Un art proprement poétique, associé sans doute à ces haikus, de Bashô ou d’autres, que je n’ai jamais été en mesure d’apprécier, mais dont Kawabata a sans contredit su dériver un style de prose brillant, et que j’avais vraiment apprécié à la lecture des Belles endormies – tout en supposant que leur quintessence, sinon dans Pays de neige mais on l’a dit, se trouverait peut-être surtout dans ses Récits de la paume de la main.
Mais alors, pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné sur moi, ici ? Je n’en sais rien… Mais le style de l’auteur, si travaillé dans sa discrétion, ne m’a cette fois que rarement ému – la très belle scène d’introduction, ou bien Yôko et Komako assistant au départ de Shimamura tandis que Yukio agonise, ce genre de passages, oui… Mais ce sont plutôt des exceptions, en définitive – jusqu’à la conclusion de l’incendie, si souvent louée, et sur laquelle on a pu, à bon droit, disserter avec tant de finesse (hop), mais qui m’a laissé totalement… froid.
Je me suis demandé si la traduction n’y était pas un peu pour quelque chose ? Elle m’a paru un peu datée. Mais je manque trop d’éléments, ici, pour affirmer quoi que ce soit.
Je reviens sur ce que j’ai un peu hardiment avancé en début de chronique : tout au long de ma lecture, j’ai eu le sentiment de « voir » en quoi Pays de neige était un roman brillant, mais sans jamais le « ressentir ». C’est vraiment une question d’émotion – et j’y ai été sous cet angle totalement réfractaire ; sans doute est-ce que ce type d’histoire d’amour ne me parle pas de manière générale, pourtant j’aurais l’impression de pouvoir témoigner de quelques saisissants contre-exemples…
Mais l’émotion et le sens sont probablement liés dans pareille entreprise ; l’impression d’avoir intégré le roman « rationnellement » s’avère forcément trompeuse si le sentiment ne va pas de pair. Dès lors, l’intégration « à froid » des thèmes et des procédés de Kawabata est un leurre, et cette prétention bien malvenue confirme par l’absurde que je suis en fait passé totalement à côté de Pays de neige…
C’est sans doute un grand et beau roman, nombre de lecteurs autrement enthousiastes sauront utilement vous en convaincre – mais il ne m’a pas parlé.
Ce qui est anormal, peut-être, et plutôt déprimant.