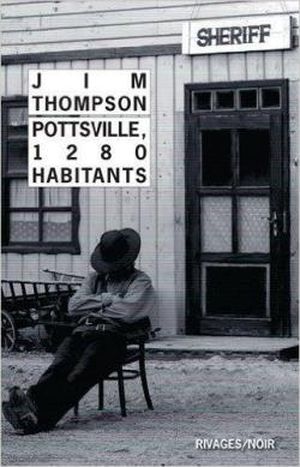Pottsville, début 1917. Les bolchéviques n’ont pas encore renversé le tsar, l’Oncle Sam ne se la joue pas encore gendarme du monde. Mais dans ce minuscule comté de l’Etat du Texas, on ne transige pas avec les valeurs sacrées de L’American way of life, à savoir la liberté d’entreprendre et le respect de la vie privée. Ou pour le dire de façon plus cynique, chacun se veut libre d’agir comme ça lui chante sans que personne ne vienne fourrer son nez dans ses petites affaires puantes. Et ça tombe bien, parce que le shérif Nick Corey est plutôt du genre accommodant. Peu lui importe au fond qu’un plouc batte sa femme comme plâtre, qu’un autre engrosse ses propres filles ou que quelques négros se fassent lyncher par-ci par-là, du moment qu’il peut palper ses 2000 dollars à l’année, s’enfiler autant de douzaines d’œufs et de côtelettes qu’il en a envie, glander de 8 à 10 heures au plumard, sans compter les siestes de l’après-midi. Sa devise, c’est laisser faire, laisser passer : difficile d’imaginer plus lâche et plus flemmard. Plus vicieux et roublard aussi, comme on s’en rendra compte assez rapidement.
Mais voilà : même lorsqu’on affiche d’excellentes dispositions pour prétendre au titre de pire lavette de l’histoire du Comté de Potts, il faut savoir garder la manière et inspirer un minimum de respect. Et quand deux proxénètes qui lui graissent la patte se mettent à se moquer ouvertement de lui, persuadés de leur impunité, Nick se dit que ça commence à bien faire. Surtout qu’aux prochaines élections, il aura, pour une fois, à affronter un concurrent solide, qui inspire confiance et présente bien, un gars bien capable de s’attirer la majorité des suffrages. Il en perd l’appétit et le sommeil, Nick, et ça, plus l’idée de voir s’envoler à tout jamais un boulot si pénard, c’est une motivation bien plus grande que les récriminations de sa chère Myra, une vraie teigne acariâtre et vindicative, qui a réussi à lui mettre le grappin dessus et à le piéger pour qu’il l’épouse tout en le cocufiant, ce que d’ailleurs il lui rend au centuple. Lassé d’être la risée de ses administrés, le voilà donc parti demander conseil à son collègue Ken Lacey, shérif du comté voisin. Et on peut dire que formidable le coup de pied au cul qu’il va recevoir au propre comme au figuré va changer son destin. Car Nick Corey va découvrir le sens de sa vie, indissociable de la mission divine qu’il estime devoir remplir.
Pottsville est certes un polar bien noir, cynique à souhait, bourré d’humour acide, écrit dans une langue d’une verdeur savoureuse. Mais ce roman est bien plus que cela. Tout en faisant le ménage autour de lui, dégommant au passage quelques emmerdeurs qui jusque-là lui pourrissaient l’existence, Nick se bricole carrément une philosophie du serial killer pour justifier son basculement dans le crime. Si au départ, tout ce qu’il veut c’est assurer la pérennité de son gagne-pain, il va bientôt prétendre avoir trouvé sa vérité. A savoir que c’est le néant monstrueux de nos existences qui nous entraîne à commettre tout un tas de saloperies. Que le libre-arbitre n’est qu’une vaste couillonnade, que nous sommes déterminés à jouer le rôle qui nous est assigné, qu’à chaque poteau autour du champ correspond un trou à combler, et qu’importe si pour ce faire il faudra sacrifier la nichée de lapins blottie au fond. Une sorte de mix improbable et explosif entre le divertissement pascalien, la notion de prédestination sans le secours de la grâce et la nécessité d’Holbach : ça dépote mais, il faut l’avouer, ça a de la gueule. Nick finit par se percevoir comme une sorte de post-christ vicelard parmi les vicelards, baiseur invétéré, manipulateur sournois, justicier de Dieu en même temps qu’assassin. A défaut de pouvoir s’en prendre aux puissants qui entubent à grande échelle, il règle leur compte à quelques white trash de son microcosme, "qui est pratiquement aussi près qu’on peut l’être du trou de balle de la création".
Thompson nous propose une vision assez désespérante du monde, dans lesquel le vice est la norme et où n’importe quel quidam un peu retors peut se parer du manteau de la justice divine pour justifier ses crimes. Ce que Nick accomplit dans son bled perdu, menant ses petites combines pour son petit profit, d’autres pourritures l’ont entrepris à grande échelle en ce début du XXe siècle, et de manière diablement plus efficace, assassins de haut vol, meneurs de guerres ou marchands de canons. En chantant des Te Deum, dans chaque camp. Mais ça, c’est une autre histoire.