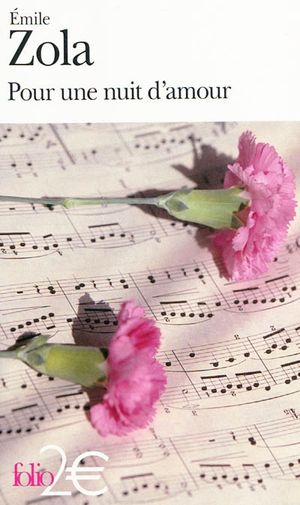Avec "Pour une nuit d'amour", ce n'est pas la première fois qu'Emile Zola traite du crime passionnel. Déjà, avec le magistral "Thérèse Raquin" dans lequel il explore l'adultère toxique jusqu'au meurtre, l'auteur naturaliste s'attachait à démontrer au lecteur combien l'amour comporte de manipulation et de noirceur dès l'instant qu'il est vécu dans le vice.
Thérèse, jeune marquise tout juste sortie de son couvent, fille unique d'un couple vieillissant, illustre bien à elle seule le précepte "ne vous fiez pas aux apparences". Sous le teint de rose et les manières de dame sont tapies des tares psychologiques en inadéquation totale avec sa position sociale mais peut-être le fruit d'un affadissement de la "race" (dans le sens littéraire du terme). Belle et fortunée, il ne lui est pas difficile de séduire les hommes, parmi lesquels le brave Julien, et d'exercer sur eux sa toute-puissance.
"Pour une nuit d'amour" est le récit de l'asservissement de la volonté par la passion amoureuse, et de l'injustice sociale qui, à en croire Zola, protégerait toujours les fortunés quels que soient leurs crimes.
Un court roman (ou une longue nouvelle) noir comme Zola sait si bien en écrire, illustré de descriptions précises et artistiques qui enveloppent le lecteur d'une atmosphère malsaine et fascinante à souhait.