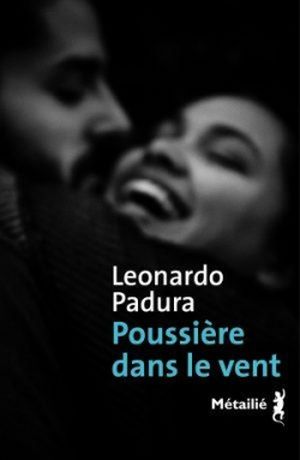Comme souvent chez Padura, ce livre se découvre comme un kaléidoscope, où s’entre croisent cubains, de la petite et grande histoire, Cuba et ses mythes, la Havane, plus particulièrement un quartier et une maison (Fontanar).
Mais aussi tous les lieux d’exil de près ou de loin d’un groupe d’ami.es, dit le ‘clan’, presque une famille, dont les trajectoires ancrées ou déracinées, charrient leur mode de vie comme ‘un escargot et sa coquille’.
Ce livre raconte avec de nombreux allers retours, l’éparpillement du clan, et en contraste, l’enfermement mental et physique de ce pays, soumis à un idéal en décomposition, où s’habituer à exister avec rien, fût aussi celui de s’habituer à ne croire en rien, où travailler coûte plus que de ne pas travailler, ‘où la parano pousse naturellement’, et où ce ‘qui n’est pas illégal est interdit’.
Cette île ‘sans lait ni viande, au plus grand bienfait du cholestérol’, où les vieux des années 50 pestaient sur le dentifrice russe, et leurs lames de rasoir qui ne rasaient pas’…
Cette île où avoir un diplôme coûte pas comme aux EU, ‘une couille et la moitié d’une autre’ mais où plus de la moitié de ces diplômés se sont extirpés ailleurs…Est-ce ainsi, que même à demi mort de faim, ils se comportent comme ‘des êtres supérieurs’, s’arqueboutant à ‘être ce qu’ils sont et à refuser de cesser de l’être’.
‘Poussière dans le vent’ suit dans la citation, ‘Rien qu’une goutte d’eau dans une mer sans fin’.
Ce roman est aussi prolifique qu’obsédant, sa puissance tient à son humanité.