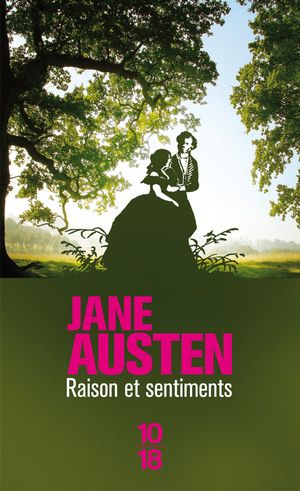« Il n’avait pas une mauvaise nature, à moins qu’on ne qualifie ainsi la sécheresse de cœur unie à pas mal d’égoïsme ; mais il était considéré, en général, comme un homme respectable, car il se conduisait correctement dans les circonstances ordinaires de la vie ».
Sense and Sensibility, Jane Austen, 1811.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tandis que Marianne gisait pâle sur son lit, le visage baigné de larmes, Elinor regardait ce triste spectacle, où se mêlaient l’incompréhension et la douleur, le chagrin et l’impuissance.
Combien de John Willoughby nos siècles depuis celui de Jane Austen avaient-ils vu passer ?
Beaucoup trop sans doute.
Aujourd’hui est un vendredi du mois de juillet. Un magnifique mois de juillet. Les guerres napoléoniennes sont finies, le temps des médaillons et des belles boucles ornant les fronts des jeunes gens est révolu mais hélas, il subsiste toujours un tas de John Willoughby.
Pendant toute la traversée du roman, le lecteur peut s’interroger sur la fin qui attend les pauvres sœurs Dashwood, Marianne et Elinor : finiront-elles de la même manière que Jane et Cassandra Austen ? (c’est-à-dire célibataires pour l’éternité, triste et fréquent destin du XIXe siècle anglais).
Pour reprendre les mots d’une certaine Marina Rollman qui commenta un jour le roman dans une de ses chroniques sur France Inter : « Il me reste encore 50 pages à lire mais comme c’est parti, j’ai l’impression qu’elles l’ont un petit peu dans l’os, les sœurs Dashwood ».
Et il est vrai qu’on peut se faire du mouron, si vous me passez l’expression car si les affaires des Dashwood semblent bien s’engager au départ - Edward Ferrars compte fleurette à Elinor, tandis que le grand amour semble avoir percé le cœur de Willoughby devant la beauté rayonnante de Marianne - celles-ci se dégradent sérieusement par la suite lorsque l’on apprend que ce bougre d’Edward est déjà fiancé depuis quatre longues années à une autre femme, tandis que Willoughby se détache brutalement de sa tendre amoureuse du jour au lendemain sans explication en feignant une cruelle incompréhension de la situation, le classique : "Ah mais il y a eu un malentendu, hein. Je croyais qu'on était juste amis".
Enfin comme à l'époque les gens savaient écrire, cela donne quelque chose dans ce style :
« […] Si j’ai eu le malheur de faire croire que je ressentais quelque chose de plus que ce que je voulais exprimer, je dois me reprocher de n’avoir pas été assez retenu dans l’expression de cette estime ».
Ah c’est la meilleure de l’année celle-là.
Heureusement, Jane Austen devait être une auteure pleine de bonté et de miséricorde pour ses lecteurs et, à l’inverse de beaucoup d’écrivains français, la noble dame choisit d’achever ses romans dans la gaieté et dans la joie, souvent par d’heureux mariages et non dans la pauvreté et la solitude (petite dédicace à Gustave Flaubert, Zola et tant d’autres…).
Grâce à son esprit et son sens des formules pleines d’ironie et de finesse, mon enfance fut parsemée des éclats de rire de ma mère, au détour d’une phrase assassine lancée avec la justesse et l’efficacité du plus redoutable des archers.
Elinor incarne cette résignation intelligente face aux circonstances de la vie qui étouffe dignement son affliction devant la distance et l’annonce des fiançailles de l’homme qu’elle aime avec une autre, tandis que Marianne ne sait ni taire son amour dévorant ni son chagrin maladif : on notera d’ailleurs la différence de destin qui attendra les sœur Dashwood, puisque seule Elinor parviendra à épouser l’homme qu’elle aime. Jane Austen présente ainsi la vie de Marianne après le mariage de sa sœur :
« Marianne Dashwood était née pour un destin extraordinaire ; il devait lui être donné de découvrir la fausseté de ses propres opinions et de contredire, par sa conduite, ses maximes les plus favorites. Elle devait renier une affection formée à un âge aussi avancé que dix-sept ans, et, sans un sentiment plus fort qu’une profonde estime et une vive amitié, donner volontairement sa main à un autre. Et cet autre, qui, comme elle, avait souffert d’un amour malheureux, avait été jugé par elle, deux ans auparavant, trop âgé pour se marier et tout juste bon à soigner ses rhumatismes ! ».
Cette fin dût en faire soupirer plus d’un mais qui sommes-nous pour nous en offusquer ? Notre époque a sans doute vu passer des unions – bien réelles celles-là- bien plus malheureuses que celle de Marianne et du Colonel Brandon. Par ailleurs, dans cette bulle de la petite Gentry anglaise sous George III, pouvait-on espérer mieux pour un tel personnage ? Non, bien évidemment, nous souffle Jane Austen assise à son bureau, la plume levée, d’un air serein.
Le bon sens anglais n’étant jamais pris en défaut, Marianne finit par abandonner tout son cœur à son mari, pour son plus grand bonheur et les deux ménages vécurent, chacun dans leur domaine, dans la paix et l’harmonie.
Qu’il en soit ainsi. [Pour être honnête, je pense que nous touchons ici une des limites du roman mais comme j’ai horreur de noircir le tableau - surtout lorsque celui-ci se veut aussi heureux que possible, je ne m’attarderai pas sur mon scepticisme quant à la réalité de tels sentiments].
Sachez enfin que de nombreuses adaptations relativement connues existent du roman mais je vous en laisse la primeur car il s’agit là d’autre chose. Je crois en avoir vu plusieurs, dont celle de 1995 dotée d’un prestigieux casting (Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman,Greg Wise…). Cette adaptation d’Ang Lee acheva de rendre célèbre l’œuvre auprès d’un nouveau public.
Je ne saurais que trop la conseiller à ceux qui ont l’âme romantique. Quant à ceux qui ont l’âme aussi rêche que du papier de verre n°7, je vous invite à retourner à Fortnite.
Et si ma foi, vous n’êtes pas trop sirupeux et que le papier de verre ne vous dit rien, vous pouvez toujours lire le roman. ■