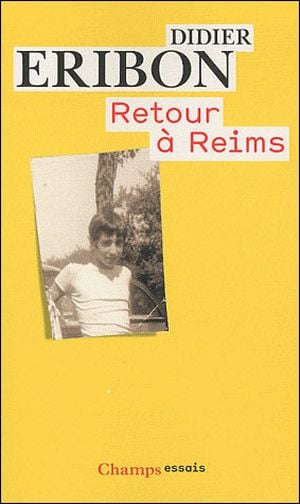Derrière ce titre "Retour à Reims" qui pourrait s'apparenter à un simple retour géographique d'un lieu délaissé par l'auteur, se cache un tout autre retour. Retour n'a pas de sens physique ici (même si il a eu lieu) mais c'est un retour intellectuel du point de vue sociologique qu'a choisi Didier Eribon pour une introspection de son parcours afin d'en tirer les conclusions et les théories possibles.
Lorsqu'on parle de parcours dans ce livre, il n'est pas que scolaire ou professionnel (bien que des gros paragraphes y soient consacrés). Il est aussi psychologique, sexuelle, philosophique et bien entendu politique.
Le sociologue va tisser une sorte d'arbre généalogique de ses parents et de ses grands parents en analysant socio-politiquement leurs parcours respectifs afin de mieux appréhender son parcours à lui. Le but n'étant pas de présenter son parcours comme unique et spécial mais bien sûr de le relier à une vision macro de la société et d'en tirer les conclusions et les analyses qui en conviennent.
Issu de classe populaire, d'un père ouvrier qui vote communiste, d'une mère au foyer qui deviendra par la suite ouvrière par nécessité, la famille est l'archétype de la famille ouvrière communiste de l'après guerre.
À travers, une plume simple qui n'ôte aucunement la complexité du problème, Didier Eribon va expliquer comment il va rejeter sa famille biologique. Cette dernière lui servira de boussole mais dans l'autre sens, il veut devenir ce que ses parents ne sont pas. Alors que les garçons de l'époque se doivent d'être "athlète", Didier Eribon se rêve "esthète" en raison de son homoséxualité qui commence à apparaître.
Et je fus, à n'en pas douter, un "transfuge" dont le souci, plus ou moins permanent et plus ou moins conscient, aura été de mettre à distance sa classe d'origine, d'échapper au milieu social de son enfance et de son adolescence.
La vie de ce sociologue est un paradoxe permanent. Lui qui, dans le même moment, se délecte de philosophie marxiste et notamment trotskiste rejette totalement sa famille ouvrière alors que tout son militantisme et sa pensée philosophique repose sur la défense des classes ouvrières. L'originaire des classes populaires cultivera donc ce paradoxe. Par la culture, la philosophie et la politique il essaiera de chercher à produire une distinction de son groupe social d'origine. Dans certains passages il explique comment toutes ses habitudes changent quand il bascule d'un "monde" à l'autre. Le langage est par exemple quelque chose de fondamental selon l'endroit où l'on se trouve.
À côté de toutes ces explications de parcours, Didier Eribon par les théories socio-philosophiques notamment bourdieusiennes et foucaldiennes (celles de Pierre Bourdieu et Michel Foucault) va analyser les classes populaires de l'époque. Le racisme omniprésent malgré le vote communiste, des explications sociologiques de la transformation du vote communiste au vote FN qu'il explique notamment par la volonté d'un groupe de s'affirmer d'ailleurs en tant que "groupe visible et revendicateur" par le vote FN qui permet de relayer une certaine parole raciste des masses populaires présente déjà à l'époque où le PCF faisait 20-30%.
Il démontre aussi comment, scolairement, son origine sociale fut un problème dans ses directions universitaires. Puisque ce dernier ne possédait pas le capital social et informatif du système scolaire et universitaire, ou même la connaissance des "bons chemins" pour parvenir à la vie intellectuel philosophique (notamment parisienne) qu'il rêvait tant.
Didier Eribon va aussi analyser très intelligemment son parcours sexuel en tant que gay. Il explique que son engagement marxiste était là encore une contradiction profonde avec sa sexualité. La doctrine marxiste de l'époque rejettait la défense des sexualités différentes en raison que ce n'était qu'un divertissement petit-bourgeois dans le but de faire oublier le réel problème : le sort de la classe ouvrière. À l'heure, de la convergence des luttes cette analyse a une résonance particulière.
«Au fond, j’étais marqué par deux verdicts sociaux : un verdict de classe et un verdict sexuel. On n’échappe jamais aux sentences ainsi rendues. Et je porte en moi la marque de l’un et de l’autre. Mais parce qu’ils entrèrent en conflit l’un avec l’autre à un moment de ma vie, je dus me façonner moi-même en jouant de l’un contre l’autre».
Sa sexualité qu'il refuse d'expliquer par la psychanalyse (dont il exprime souvent des critiques, notamment la psychanalyse lacanienne), en effet on cherche toujours une explication psychanalytique à l'homosexualité mais jamais à l'hétérosexualité, preuve aussi de l’hétéro-normativité très présent dans l'inconscient social et dans la pensée intellectuelle.
Ce livre sociologique qui se lit comme un roman est l'illustration typique du retour du "transfuge de classe" ayant subi le paradoxe permanent des 2 identités antagonistes qui se sont affrontées dans son être. Combat qui doit durer encore à l'intérieur de Didier Eribon.
Le livre pose parfois des questions tranchantes, est-ce que Didier Eribon sans son homosexualité se serait pourfendu dans une masculinité exacerbée? Est-ce qu'il aurait voté FN comme son frère si il n'avait pas pu partir de Reims? Aurait-il eu la même relation avec son père? Serait-il devenu cet intellectuel de gauche critique? Même si avec ce dernier on peut malheureusement parler de "non relation", tant la mort de son père ne l'a pas affecté.
Ce livre exprime parfois du regret. Le regret de ne pas parfois avoir pu aider cette famille de classe populaire qui comme lui a subi "les verdicts" de la société que connaissent malheureusement les dominés.
Un ouvrage majeur et indispensable pour connaître la pensée et l'histoire de ce sociologue qui est atypique mais révélatrice des problèmes de l'inégalité et de la démocratie française et même plus loin des sociétés occidentales.
La preuve même que les déterminismes sociologiques existent mais qui paradoxalement peuvent parfois miraculeusement peuvent être renversées.
Rien ne nous attachait, ne nous rattachait l’un à l’autre. Du mois le croyais-je, ou avais-je tant souhaité le croire, puisque je pensais qu’on pouvait vivre sa vie à l’écart de sa famille et s’inventer soi-même en tournant le dos à son passé et à ceux qui l’avaient peuplé.