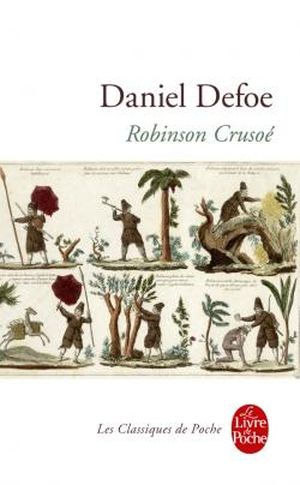Les cinqs points, bien sûr, pour le côté novateur à cette époque d'un si long roman, qui plus est à la première personne, d'un héros tout ordinaire. Certaines introspections de Robinson, lorsqu'il est sur son île, sont très plaisantes et arrivent même à passer la barrière du livre pour faire réfléchir le lecteur. La survie, physique mais surtout mentale, d'un homme seul pendant près de 30 ans sur une île dont il ignore jusqu'à la position est digne d'intérêt, sa réadaptation à la société est également très intéressante.
Pour autant, cette lecture me fut pénible. Car pour Robinson, la vie est simple. Robinson est dans son bon droit, pour tout. Guidé par la divine Providence, Robinson fait partie de ceux qui plient le monde à leur pensée sans jamais avoir envisagé qu'il en soit autrement. Pour Robinson, les indigènes sont des animaux, les non-chrétiens sont des monstres et les femmes sont des ventres. Je n'arrive pas à balayer toutes ces réflexions et ces propos nauséabonds d'un revers de main, au prétexte que ce serait "d'époque". La vérité, c'est que Robinson est un sale con.
Quasiment 30 ans sur une île, à douter de tout sauf de Dieu, à finalement avoir trouvé la plénitude et le bonheur qui seraient complètes s'il avait de la compagnie, et à la première occasion le voilà qui se barre massacrer des indigènes sans le moindre état d'âme. Que lui faut-il, pour apprendre ? Que lui aurait-il fallu, pour arriver à la sagesse d'un prince exilé Sibérien, qui refuse lui de revenir aux frasques du monde car il sait avoir trouvé la paix dans son exil ? Quelle cohérence, même, dans les réflexions de Robinson, stoïque et laborieux 30 années sur son île, se refaisant colonisateur, orgueilleux et indolent pour les 30 suivantes ? La première partie du roman, celle passée à la postérité, n'était donc qu'une vaste hypocrisie ?