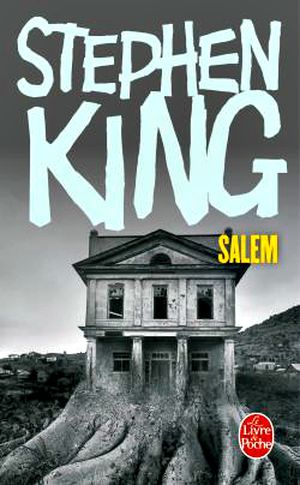En 1975, Stephen King a 28 ans, et il vient d'achever son second roman, Salem. Il n'est alors qu'un jeune auteur dont la seule gloire est un bon réseau de magazines prêt à publier ses nouvelles, et un succès commercial surprise avec Carrie, une œuvre qu'il juge médiocre, mais qui lui ouvre les portes d'une carrière qui sera florissante. Mais pour le moment, il est encore timide. Il faut que sa femme l'aiguillonne pour qu'il se lance dans de grands projets. C'est qu'un roman prend plus longtemps qu'une nouvelle, même avec son rythme d'écriture effréné. Il lui faut un concept sûr pour le convaincre de s'engager dans la construction d'un récit de vaste ampleur. Il s'en tiendra donc, simplement, à une reprise du mythe du vampire, appliqué à la lettre, mais dans un contexte contemporain et américain. Une sorte de reprise dramatique des codes pulp qui l'ont fait frissonner enfant.
Le style du King de l'époque est encore très grandiloquent. On l'entend parfois écrire dans les descriptions trop fleuries, et les personnages ont une façon de s'exprimer peu naturelle, encore alourdie par la version française. Sa relation ambigüe vis-a-vis de la religion chrétienne est présente, et pas très subtile. Son protagoniste est un peu trop ouvertement un avatar de lui-même pour que la romance ne soient pas gênante. Par ailleurs, son défaut le plus connu s'impose déjà : ses fins bâclées. Mais ses forces se bâtissent également. Son soucis du détail donne au tableau qu'il fait de la ville un réalisme qui ne rend que plus perturbant l'intrusion du surnaturel. King peint cent portraits de gens ordinaires, attachants, répugnants ou médiocres, mais furieusement crédibles. De même, Salem est dotée d'une histoire, d'une géographie, d'un climat, d'une ambiance... Tout pour en faire plus qu'un décor, mais bien une composante du récit lui-même
Cette normalité de petit village paisible du Maine va lui servir à établir sa vision du vampire. Le Dracula local n'est jamais qu'un pastiche efficace mais classique. Les contaminés, cependant, forment une toute nouvelle variante du concept. Insidieusement privés de leur humanité, ils ne leur reste que des bribes dévoyées de ce qui fut leur esprit. Réduits à des parodies d'eux mêmes, oscillant entre idiotie animale et ruse sournoise, ils s'emparent peu à peu de la ville, révélant son coeur sombre et corrompu. L'horreur, chez King, vient de la révélation d'un mal qui était déjà présent, et qui dévore son hôte.
C'est la première fois que King vise à inspirer la terreur dans un roman. Pour cela, il fait preuve d'une certaine maestria en maniant des concepts simples, mais très efficaces. Les vampires errent autour des fenêtres de leurs proches, et un coup d'oeil malheureux suffit à plonger la victime en transe hypnotique, permettant au vampire d'entrer et de se nourrir. L'idée est très efficace, car elle joue sur plusieurs plans. La peur du noir nocturne, au-delà du foyer. La paranoïa de perdre sa volonté sur un simple regard. La trahison d'un être aimé transformé en prédateur ricanant. Et cela permet de présenter la destruction tranquille de la ville, sans enchainer les scènes trop descriptives, juste en suggérant. La vague s'étend, la petite civilisation campagnarde s'effondre en silence, et presque personne n'ose accepter l'idée que quelque chose de surnaturel pourrait être en train d'arriver, de peur de passer pour un fou. Les habitants sont coincés, sachant qu'ils sont en danger, mais n'en sachant pas la cause, et refusant de fuir sur la seule foi de signes inquiétants, mais incompréhensibles. Tout comme les deux enfants perdus dans la forêt, entendant des brindilles craquer derrière eux, mais refusant de courir, de peur que le bruit devienne encore plus menaçant.
Salem n'est pas ce que Stephen King a fait de mieux. Mais on y trouve les esquisses de beaucoup de ce qui fera son succès. Un monde vivant. Des personnages tous très humains. Et une compréhension parfaite de ce qui peut tenir éveillé, certaines nuits où on tend trop l'oreille.