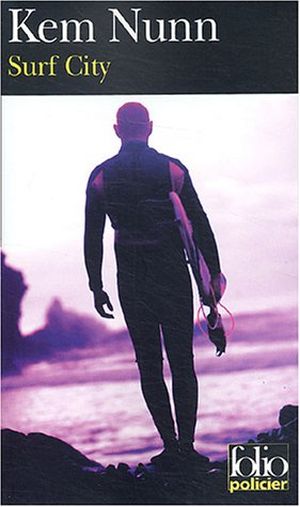« Lorsque l'étranger vint s'enquérir de lui, Ike Tucker était en train d'ajuster la chaîne de la Knuckle. C'était une journée ensoleillée, et derrière la station Texaco la terre était chaude sous ses pieds. Le soleil lui tombait droit sur la tête et dansait dans le métal poli. »
Une fois n'est pas coutume, je ne produis pas un résumé sommaire du roman, cela ne me semblant pas très judicieux. Aussi me contenterai-je du strict nécessaire.
Ike Tucker abandonne son existence morne au bord du désert, autant dire au bord de nulle part. Un vaste espace minéral balayé par les vents. Partagé entre une moto qu'il bichonne sans oser la chevaucher et une famille d'adoption le considérant comme un moins que rien, rien ne le retient sur place. Dépourvu de toute attache, il espère remonter la piste laissée par sa sœur partie tenter sa chance ailleurs. À Huntington Beach.
Entre les déferlantes glacées et la plage hantée par les insouciantes ingénues, entre surfeurs affûtés et bikers massifs, Ike se cherche une place. Il s'incruste, s'entête malgré les déconvenues, persévère à rechercher sa sœur disparue. Et ce qui semblait être un roman noir se mue en roman d'apprentissage.
Histoire classique du petit gars montant à la ville, avec un minimum de bagage, vrai candide découvrant un milieu qu'il ne connaît pas. On ne peut pas dire que Kem Nunn fasse dans l'originalité. Pourtant, Surf City se distingue par, disons son style, à défaut d'un terme plus adéquat. Mélange de désenchantement – on visite l'envers du décor du rêve américain – et de dialogues ancrés dans le registre familier, celui de la rue, le roman de Kem Nunn se fiche comme d'une guigne des intrigues rodées, calibrées pour cartonner. Il prend son temps pour poser le cadre, déroule son récit avec nonchalance, se focalisant sur les personnages. Les rêves brisés de Hound Adams et Preston Marsh. La patience maternelle de Barbara. Sa résignation aussi. La présence pesante des disparus. Du passé. Comme un boulet rivé à la cheville.
L'insouciance, la liberté, la jeunesse, le fun chantés par les Beach Boys semblent évaporés. Tropisme des années 1960 relégué au rang d'imagerie mythique. L'insouciance est plombée par la drogue, la jeunesse rejoue dans une parodie de liberté le rêve de ses aînés et le fun fleure la désespérance.
Reste l'océan – un personnage à part entière du roman – et les vagues. Reste le surf.
« Ce qu'il faisait n'était pas fractionné en plusieurs séquences : ramer, prendre les vagues, se mettre debout. Tout à coup ce n'était plus qu'un acte unique, une fluide série de mouvements, un seul mouvement, même. Tout se mélangeait jusqu'à n'être plus qu'un : les oiseaux, les marsouins, les algues, reflétant le soleil à travers l'eau, une seule et même chose dont il faisait partie. Il ne se branchait pas seulement à la source, il était la source. »