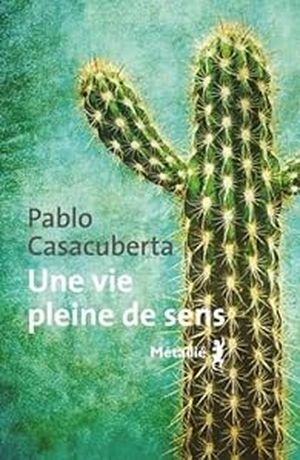La présentation qu’il fait de lui-même le rend immédiatement sympathique : le narrateur est un type ordinaire, sans ambition démesurée. Il doit travailler dur pour terminer ses études de médecine. Il a cependant un but étudier les synapses afin de comprendre leur fonctionnement et en déduire leur rôle sur nos prises de décision. Sa rencontre plutôt orageuse avec Déborah aboutira malgré tout par un mariage et à la naissance d’un fils. Mais la vie de famille est régentée par le père de la mariée, qui s’immisce dans tout, y compris la carrière professionnelle du narrateur, salarié d’un labo de recherche en neurophysiologie. Il incitera son gendre à écrire un livre qui fait un parallèle entre ses travaux de recherche et ce qui fait son quotidien de juif athée. L’ouvrage a peu de succès malgré les efforts immenses de l’éditeur, une relation du beau-père …
Peu à peu le couple se perd et notre héros se retrouve seul, viré de chez lui, avec des ressources précaires. Son éditeur lui propose un curieux marché : une rédaction posthume d’un livre de développement personnel !
Ce qui apparait dans le développement comme une approche un peu condescendante du genre, devient avec l’évolution du personnage un vrai roman de développement personnel, avec de longues explications théoriques puisant leurs inspirations dans le Talmud, mises en parallèle avec la propre expérience du narrateur. C’est là que j’ai lâché l’affaire, malgré mon intérêt pour les aventures assez drôles de cet homme porté sur l’autodérision et le suspens qu’avait créé sa descente aux enfers (qui m’a rappelé les premières romans de Douglas Kennedy).
Il en reste un roman dont l’ironie fait mouche, avec une belle dérision autour du monde de l’édition, une critique acerbe de la psychanalyse et des personnages suffisamment odieux pour être sympathiques.